L’écrivain allemand Reinhard Jirgl, auteur d’une dizaine de romans et de plusieurs pièces de théâtre, est né à Berlin-Est en 1953. Le silence est son troisième roman traduit en français, aux éditions Quidam (comme ses deux précédents romans traduits en français, Les inachevés, 2007, Renégat : Roman du temps nerveux, 2010). Difficile, et surtout inutile, de résumer ce roman total et magistral. Retenons seulement que l’intrigue se construit autour d’un personnage, Georg Adam, et de deux lignées, la lignée Baeske, de Basse-Lusace, et la lignée Schneidereit, de Prusse-Orientale, qui traversent le XXe siècle, cet « ogre » qui sans vergogne dévore ses enfants.
Reinhard Jirgl, Le silence. Trad. de l’allemand par Martine Rémon. Quidam éditeur, 611 p., 25 €

Reinhard Jirgl © Annette Pohnert
C’est Henriette, l’épouse aimée – décédée – de Georg Adam, qui fait le lien entre ces deux lignées, grâce à la rencontre de deux hommes : le frère de sa (future) mère et son (futur) père donc, sur le champ de bataille de la Somme en 1916. Ces lignées naissent dans le sang et dans la boue, qui marquent inéluctablement la descendance. Le silence se nourrit d’événements familiaux souvent dramatiques, s’articulant à l’histoire de l’Allemagne du XXe siècle. Le délitement familial double le délitement historique dans une forme narrative implosive. Un album photographique, qui contient cent clichés de famille, ordonnés de manière aléatoire, doit être remis par Georg Adam à son fils Henry, qui s’apprête à partir pour les États-Unis où il a obtenu une chaire de maître de conférences en littérature et civilisation allemandes. Mais, avant son départ, il veut dire adieu à Max, le chien de son père, et est donc contraint de voir aussi ce dernier, avec qui les relations sont pour le moins compliquées.
Dans une polyphonie remarquablement maîtrisée, les histoires ressurgissent, gravitent autour de ce lieu fictif, Thalov, dont les hommes sont expropriés par le régime nazi, puis par le régime communiste, et ensuite par le régime démocratique, expropriation contre laquelle il faut se battre sans relâche. Jirgl fait surgir des voix qui ne se répondent jamais véritablement, mais qui emportent le lecteur dans un flux de narration bouleversant, le conduisant à établir lui-même des liens entre les personnages, les événements et les désastres de l’Histoire, et à mettre au jour, tel un archéologue, ces secrets qui sapent inlassablement l’édifice familial.
Le silence est un roman total et embrasse le XXe siècle et ses affres, dans une histoire familiale aussi bouleversée que bouleversante. Il est porté par une langue qui saccage tout sur son passage, l’orthographe, la ponctuation, nos habitudes de lecture, les poncifs d’écriture. La langue de Jirgl est une langue qui s’entend, mais aussi une langue qui se voit ; et lire Jirgl est une expérience de lecture unique, qui engage le corps, une expérience visuelle, rendue possible aussi grâce au travail remarquable de Martine Rémon, sa traductrice. Le travail graphique n’est jamais illustration, il est pensée, il est système, et c’est la très grande force de l’œuvre de Jirgl. Sa lecture s’éprouve physiquement, fait appel à des niveaux d’interprétation différents, interpelle le lecteur dans les tréfonds de son être, joue avec ses réactions possibles et ses associations d’idées, en sollicitant sa vue et en enrichissant sa lecture de différentes strates d’interprétation. Et parfois cela ne va pas sans humour, d’ailleurs, ni sans cynisme, par exemple cet « ex-poux » qui s’embourbe dans une aventure extraconjugale, « cette affaire-grotesque avec l’étudiante », et qui sous l’œil de l’épouse apparaît ainsi : « Il n’Y résista pas longtemps & revint à la maison pénétré=de-repentir. À moi dès lors les-restes-de-ses-Lendemains-Galants : ses cheveux gris roux teints de petites mèches, alors que son corps était entièrement rasé, de sorte qu’en se déshabillant, sa peau de bébé cadum mais légèrement poussiéreuse dans les plis & les ridules lui donnait un air de Porky Pig vieilli : tout le ridicule de la-jeunesse en badigeon sur un corps délabré. – ! Tu veux que je te dise à quoi tu ? ressembles : tu=es à ! mourir de rire. »
Jirgl met au jour les langues bureaucratiques, idéologiques, institutionnelles, sociales, pour les ridiculiser et les anéantir, et c’est toute la puissance esthétique et politique de ce roman. Le silence offre des variations autour du silence, de toutes sortes de silences d’ailleurs, qui sont justement remplis par les bruits du monde, par le vacarme de l’Histoire et des histoires, dans une expérience linguistique et esthétique novatrice et renversante. Nous avons donc décidé, une fois n’est pas coutume, d’ouvrir l’entretien avec l’auteur par une question posée à sa traductrice, Martine Rémon.
Est-ce que traduire Reinhard Jirgl, travail pour lequel vous avez été récompensée par plusieurs prix, est une expérience extrême ? Quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer pour rendre compte de cette langue ?
Ma rencontre avec l’œuvre de Reinhard Jirgl remonte à plus de dix ans et l’on peut dire que ma « vraie » vocation de traductrice est née à ce moment-là. Au printemps 2003, à la parution de Die Unvollendeten (Les inachevés), l’éditeur Carl Hanser avait mis en ligne un extrait correspondant au début du roman. Ce fut mon premier contact « visuel » avec l’écriture de cet auteur. Mon sentiment immédiat fut un mélange de surprise, d’interpellation et de curiosité devant cette orthographe pour le moins singulière. La plupart des recensions allemandes parlaient d’une similitude avec Arno Schmidt, un auteur « rare » que je venais de découvrir dans les traductions de Jean-Claude Hémery (Scènes de la vie d’un faune, Julliard, 1962) et de Claude Riehl (Roses et Poireau, Maurice Nadeau, 1994), dont une nouvelle, « Les émigrants », aborde la même période historique. Le fragment mis en ligne me révélait pourtant autre chose, et ce sentiment d’« il y a là quelque chose de différent, de jamais vu/lu » se confirma par la lecture du roman dans son intégralité quelques mois plus tard. En refermant le livre, j’étais totalement sous le coup de l’émotion littéraire de ces lectures qui vous marquent pour le restant de vos jours.
C’est certainement le choc littéraire qui m’a fait m’asseoir un jour de novembre 2003 devant mon clavier pour tenter de transposer en français cet auteur réputé a priori intraduisible. Je traduisais alors pour mon plaisir, pour le bonheur que procurent les mots, en pure dilettante. Or, plus j’avançais dans mon travail, plus j’avais la conviction que ce n’était pas insurmontable, que ma traduction était « honorable », mais il fallait pour cela l’avis d’un traducteur chevronné. Seul Claude Riehl pouvait à mon sens se prononcer sur la qualité de ma production, me dire si je me fourvoyais et perdais mon temps. Contacté début 2004, il accepta de lire mes ébauches. Quelque temps plus tard, il m’écrivait en retour, me renvoyant le passage corrigé et annoté, accompagné de ses félicitations et encouragements, en précisant que maintenant que Jirgl avait trouvé sa traductrice, il restait à trouver l’éditeur prêt à se lancer dans l’aventure (risquée). Ce fut finalement Quidam qui accepta de relever le défi. Depuis, j’ai lu tous les romans de Reinhard Jirgl. Mon intention est de poursuivre la transposition en français de cette écriture singulière. Aux trois romans parus à ce jour chez Quidam, il convient d’ajouter l’œuvre de théâtre et de jeunesse de Reinhard Jirgl, Klitemnestre Hermafrodite & ‟Mamma Pappa Zommbi’’, pour laquelle la Maison Antoine Vitez m’a accordé une bourse de traduction l’an passé.
Quant aux principales difficultés : dès le départ, il fut très clair pour moi que je devrais respecter les systèmes symboliques différenciés introduits dans le texte, qu’il me faudrait suer sang et eau comme n’importe quel traducteur impliqué physiquement dans son texte, trouver une traduction précise et inventive, suffisamment fidèle pour ouvrir le cœur et suffisamment infidèle pour séduire l’esprit. Les obstacles visuels (antéposition des signes de ponctuation, les cinq formes d’écriture différentes du mot « et », l’introduction de signes mathématiques, qui font que certains lecteurs renoncent au bout de quelques pages parce qu’ils lisent avec les codes de lecture classiques) n’en sont pas en réalité. La lecture à voix haute confirme d’ailleurs la fluidité des phrases. Des passages ont été particulièrement problématiques, pas tant au niveau du rendu visuel que de l’effort de trouvailles à fournir. Certaines pages ont été terrifiantes à traduire, et j’ai plusieurs fois failli renoncer et rendre mon tablier. Or, c’eût été m’inscrire en faux contre ces deux adages que j’affectionne particulièrement : « per ardua ad astra » (« par l’effort atteignons les étoiles ») et « ne traduis que ce qui te passionne ».
L’écriture de Reinhard Jirgl est un véritable corps-à-corps avec les mots. Depuis de nombreuses années, je vis avec, dans, et parfois contre ces textes, il m’a fallu trouver un soc similaire pour « retourner la terre du champ de la langue d’à côté » quand Reinhard Jirgl laboure ses souvenirs et ses mots, les chausse-trappes lexicales étant comme des pierres où le métal accroche, jette parfois des étincelles, quand ces pierres n’abîment pas carrément la lame… Il me faut sans cesse tricoter sur mesure, manier la truelle métaphorique, court-circuiter les tableaux sémantiques, apprivoiser l’intraduisible par effleurement et attouchement, afin de rendre la tonalité de cette langue insolite. Alors, oui, traduire Reinhard Jirgl est une expérience extrême, c’est une aventure au-delà de la contrée de l’orthographe, dans des parages où il faut oser certaines incorrections pour apporter du sang neuf à la langue. L’auteur l’a fait bien avant moi, je n’en suis que le relais : ce sont les grands textes qui font les grandes traductions.
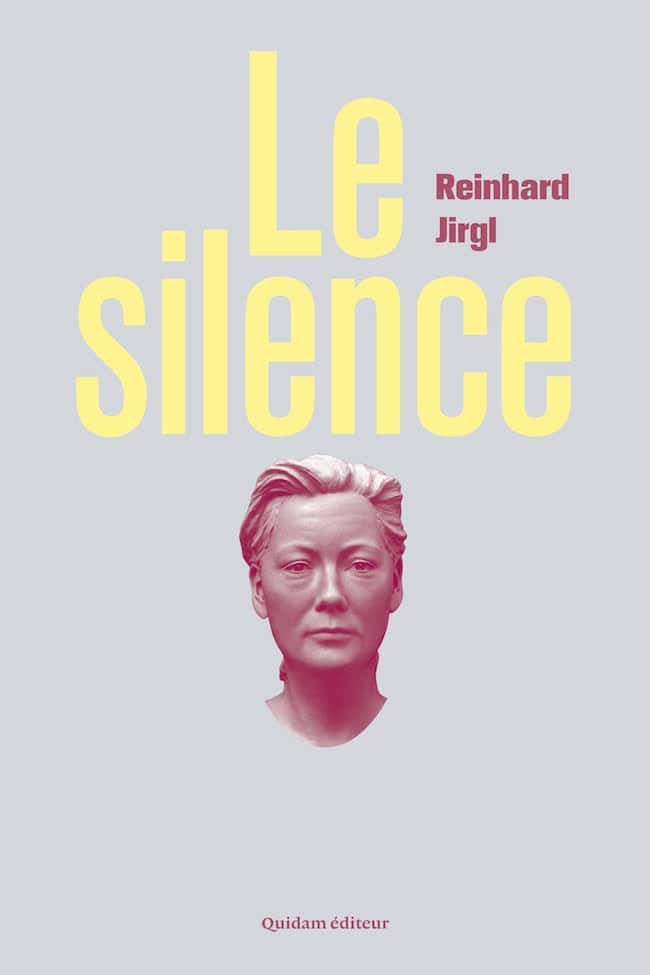
Entretien avec Reinhard Jirgl
Votre écriture est ancrée dans une histoire, dans un siècle. Peut-on parler d’une obsession du XXe siècle tel que vous le décrivez dans Le silence, « un ogre qui de ses dents de fer dévore ses enfants à la hâte & sans qu’on puisse le stopper. Comme si le Siècle s’était effrayé de ses propres créations ».
La fureur du changement est pour moi le grand drame du XXe siècle, l’emprise des sciences sociales et des sciences technologiques sur la nature. La littérature est bien sûr au centre de toutes ces évolutions, elle ne peut pas les ordonner mais elle peut s’en trouver influencée. C’est ainsi que se crée un style approprié, pensez par exemple à Döblin et à ses techniques de montage. Il ne faut pas s’arrêter là mais il faut au contraire réfléchir dans la littérature même à la critique de ce style pour savoir de quelle manière la littérature fait partie intégrante de cette évolution.
Vous dédiez ce livre « à l’avenir ». Comment la littérature s’inscrit-elle dans cette élaboration du temps, temps de l’histoire et temps du lecteur ?
Le livre est en effet dédié à l’avenir, c’est une citation d’un des personnages principaux du roman, qu’il faut entendre dans un sens cynique. Ce qui est « dédié à l’avenir », c’est pour lui la vieillesse. La vieillesse est bien sûr notre avenir à tous, et l’avenir de la jeunesse aussi. En tant que médecin, il porte un regard rétrospectif et peut dédier à l’avenir ce qu’il dit.
Le travail dans Le silence est colossal, tant du point de vue de la forme que de la construction de l’intrigue. Quel est le point de départ de l’écriture ?
Le fil rouge du livre, de l’intrigue, c’est l’album photographique qui existe véritablement avec ses cent photographies classées non pas en suivant la chronologie, mais selon un ordre inhérent à la famille. Cet album est comme un témoin dans les relais, qui passe d’une génération à une autre. Il ne s’agit pas de photos artistiques, mais de souvenirs. À cet album s’ajoutent les documents qui concernent le personnage principal et son rôle dans la Première Guerre mondiale. Sur une petite fiche, pas plus grande qu’un ticket de caisse de supermarché, sont inscrites toutes ses participations aux batailles de la Première Guerre, qui a eu des conséquences tragiques sur son existence. Il s’agit pour moi d’un effet caractéristique du XXe siècle, qui est donc le point de départ de mon écriture. Ces documents m’ont inspiré pour l’écriture du Silence car ils constituent des obstacles qui ordonnent et régulent le flux de la narration.
Quelle place l’élaboration de la généalogie a-t-elle prise dans la construction du roman ?
Dans un sens général, la généalogie est un symbole du savoir, de la connaissance des contextes, qu’il s’agisse d’une famille ou de l’Histoire. Je pense à Foucault et à son travail sur la généalogie et sur l’archéologie. L’archéologie, ce sont les pièces trouvées, par exemple l’album de photographies, ces objets inconnus, enterrés, qu’il faut déterrer, mettre au jour, comme lors de fouilles. Ma tâche consiste alors à les ordonner, à les intégrer dans un système sur la famille, sur l’Histoire, ou dans le meilleur des cas à découvrir de nouvelles choses, un nouveau système. Et si l’on y parvient, on établit une transition vers la généalogie grâce à un système d’attribution qui intègre ce que j’ai trouvé à l’intérieur d’une histoire. La continuité de génération en génération, ou au contraire une rupture, me permet de créer une nouvelle succession, une nouvelle généalogie. Un exemple que je trouve intéressant, pour rester dans le domaine de la photographie, est celui de ce photographe de la fin du XIXe siècle qui a fait des photos de famille sur une génération et qui les a projetées les unes sur les autres, pour détecter ce qui est typique dans la famille [Francis Galton, photographe anglais qui est à l’origine de la photographie composite, et dont les travaux ont été poursuivis par le photographe français Arthur Batut]. Il en résulte une condensation des histoires de famille dans un visage qui n’existe pas. C’est votre question qui m’y fait penser, Freud en parle dans L’interprétation des rêves.
Doit-on passer par l’histoire familiale pour dire la violence du siècle dernier ?
Vous connaissez la phrase d’Engels qui dit que la famille est la plus petite cellule de l’État. Cette phrase peut être poursuivie ainsi : la famille peut être considérée comme le plus petit décor, comme la plus petite cellule de l’Histoire et de la généalogie. La famille est bien sûr un espace protecteur contre le déchaînement de la bourgeoisie et nous savons, par nos observations ou nos expériences, qu’au XXe siècle cet espace protégé explose. Elle est désormais comme une maison sans murs, grande ouverte à l’irruption de la violence. Toutes ces formes de la vie bourgeoise se sont perdues bien sûr, la violence du XXe siècle n’a désormais plus aucun filtre, l’enfance est aussi perdue, et avec elle la possibilité de transmettre des expériences.
Mais pouvait-il y avoir dans ce milieu bourgeois une violence inhérente à la famille ?
Oui, j’évoque ici les conséquences de cette violence. Le processus d’éducation des enfants par les aînés traduit la prise d’influence des supérieurs sur les inférieurs, et naturellement la ruse des inférieurs, le mensonge nécessaire pour se défendre contre cette prise de pouvoir des supérieurs, mais aussi leur soumission. Si on veut le dire d’une manière plus euphorique, ce sont les circonstances ordonnées, et cet ordre, qui a sa violence inhérente, s’est perdu. Cela est lié à mes yeux au développement, dans la première moitié du XXe siècle, de l’idée de la guerre totale, et de l’idée du travail total, dont nous souffrons aujourd’hui encore.
Vous posez également la question de l’héritage, tant par le renouvellement des formes et de la langue, que par les histoires que vous racontez, dans Le silence. La question de la paternité est essentielle dans le roman dans son entier. « – ! Les pères – ils sont aussi ridicules qu’ils sont redoutablement féconds. Les pères ne méritent même ! pas notre mépris.-» (p. 129). Que pourriez-vous dire de la paternité ?
La question de la paternité se lit à deux niveaux, le niveau biologique et le niveau politique. La paternité au sens bourgeois se dissout dans la perte des relations de domination, et avec l’augmentation de la violence. Cela concerne d’ailleurs toutes les classes sociales et pas uniquement la bourgeoisie. Si je devais donner mon avis, je dirais que je n’ai rien contre l’idée que l’humanité, dans son ensemble, s’éteigne tout doucement, je pense que nous le méritons, nous avons tenu le coup si longtemps. Mais il ne faut pas trop y compter. Je m’intéresse, dans l’écriture et dans la vie, aux ruptures dans la généalogie que constituent l’inceste, les enfants illégitimes, cet héritage incroyable de modèles de violence. Mon savoir s’arrête là, je ne vois aucune issue. Je décris ces processus mais je ne peux pas proposer de solutions.
Comment la violence modèle l’écriture, la langue, pour être vivante et incarnée dans la lecture, violence criante qui se déploie aussi dans la graphie ? (p. 197 : « Tombereaux de terre déversés dans sa bouche (des obus-tombés-à-proximité ou est-ce un autre soldat qui refuse d’entendre le cri originel de la peur MAMAN poussé par son camarade) Un dernier regard hors de la boue mitraillée Des murs de feu montant en flèche L’éclat des couleurs fondamentales puis noir le regard de cerise de la jeune-fille-du-rêve-présente : l’odeur d’amandes amères qui déjà irrite les yeux Souffle éraillé Toux – !!! GAAAZ »
Vous citez un extrait d’une scène particulièrement violente de la Première Guerre mondiale, une attaque au gaz. Cette scène permet de démontrer l’utilisation de la langue en tant que médium mimétique. On peut se référer ici à Walter Benjamin et à ses écrits sur le processus mimétique à l’œuvre dans l’écriture. Il s’agit, par rapport à la réalité sensible des corps, d’une approche de la ressemblance non sensible dans et par l’écriture. Si l’on reste dans l’imaginaire de l’écrit, on peut dire que les signes des écoles d’écriture de la Renaissance et du Baroque appartiennent aussi à ce domaine. De cette idée qu’on peut utiliser la fonction mimétique du langage pour la narration découle ma technique d’écriture, que je décrirais moi-même comme une « écriture préparée ». C’est un niveau de texte qui est autonome, et qui n’a rien à voir avec l’illustration.
Quelle importance accordez-vous à la voix dans votre écriture ?
Pour être précis, mes textes ne consistent qu’en voix. Ce sont des monologues intérieurs, ce sont les voix des narrateurs qui se parlent à eux-mêmes, ce sont des textes qui ne s’adressent à personne, c’est ce murmure éternel du langage qui cherche ses corps. Dans une certaine mesure, on peut y voir une opposition avec ma manière de penser car les choses qui se montrent dans l’écriture elle-même, les signaux corporels, eux, restent muets. On peut dire que le caractère sensible de l’écriture se retire dans le silence.
Vous sollicitez aussi la vue du lecteur par la description des photographies qui ouvre chaque chapitre, l’insertion de documents, mais aussi les bouleversements graphiques de mots, la ponctuation aléatoire qui donne au texte un rythme qui lui est propre et que le lecteur doit épouser. Quelle importance attribuez-vous au regard du lecteur ?
Il faut considérer la perturbation de la lecture comme un enrichissement, comme une méthode de mon « écriture préparée », qui apparaît d’abord comme un obstacle. Si l’on veut percevoir cette écriture et continuer la lecture et la réflexion, on peut penser à ce que dit Barthes dans Le plaisir du texte à propos du texte qui est un défi. Le plaisir nécessite que l’autre soit non seulement d’accord mais qu’il soit aussi partie prenante, donc l’autre est à imaginer concrètement. Mais cela reflète également la solitude de celui qui écrit et qui termine ce parcours littéraire et ce parcours du plaisir sans rien savoir de son aboutissement. Cela correspond à la solitude des photographies par rapport à leur objet. La photographie peut être considérée comme une mort arrêtée, et, vous le savez, les premiers clichés étaient des photos de cadavres car le temps d’exposition était très long et les cadavres, par définition, ne bougent pas. Mais c’est dans ce décalage de la vie arrêtée que naissent ces moments qui font une photo-graphie, à la différence de photo-gène. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi ces photographies pour quantifier le texte, mais absolument pas pour le décrire.
La lecture est ralentie, achoppe. Elle est parfois freinée par l’inventivité de la langue, qui peut désarçonner mais qui en même temps, par des effets graphiques, appelle à autre chose, suscite différents niveaux de lecture et rend donc la lecture du roman extrêmement riche. Je pense par exemple au « Fühturs-malheurs » qui n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres.
Je n’ai pas la moindre idée du lecteur mais j’ai un souhait : avoir un lecteur sans préjugés, curieux, naïf au sens positif du terme. Je ne peux rien savoir du Lecteur, avec un grand L, qui n’existe pas. Cela d’ailleurs abaisserait la subjectivité d’un lecteur, d’un être humain, dans une catégorie du marché, raison pour laquelle je refuse absolument cette idée.
Quand vous écrivez, vous ne pensez pas à votre lecteur ?
Non, jamais.
Le travail sur la langue est prodigieux et se situe aux antipodes de la langue du fils, Henry, que l’on peut considérer comme un contre-modèle (« Dans son récit, il n’omettait aucun verbe auxiliaire, mon estudiantin de ‟fils”. Premier-de-la-classe, il n’économisait pas non plus sur le datif, c’est tout juste si je n’entendais pas les virgules, les oublier ou les postsynchronyser eût été impardonnable pour lui. Il changeait la langue allemande en des structures saccadées, avec mesquinerie, méticuleusement & en ergoteur, ça faisait un bruit de forge de nains de jardin & ça sentait la colle & le courant de faible intensité d’un train électrique. Et le =Tout de surcroît sur ce ton protecteur du Contente-toi de m’écouter. Je suis ton guide. Je t’emmène. Fais-moi confiance, car je sais ce que je dis. ») Comment cette langue naît-elle ? Jaillit-elle ainsi, dans sa forme, ou travaillez-vous à partir d’une langue plus classique ?
Le langage d’Henry, en dehors de son contenu – et c’est ainsi que cela a été pensé –, le langage d’Henry tel qu’il est décrit là est le langage de la normalité, un langage soumis à l’ordre, ce qui revient à dire pour moi que c’est un langage non préparé, un langage sauvage. Il se présente face à son père car il est professeur de germanistique et parle de sa salle de cours. Il faut penser à la page comme à un espace tridimensionnel : la page est en effet comme une scène de théâtre, et « l’écriture préparée » prend comme objet d’observation des êtres humains et des choses qui ont chacun des propriétés particulières. Le langage d’Henry, qui est normé, est la matière qu’il s’agit maintenant de mettre en forme car mon idée est de considérer le langage comme un médium d’art qu’il faut travailler comme le corps du danseur, le marbre du sculpteur ou la toile du peintre. Ce que j’entends par « écriture préparée » fait référence au piano préparé : la préparation fait entendre des sons qu’on ne peut pas entendre normalement. Elle découle de notre manière de vivre qui ne peut plus être représentée par les signes classiques du langage.
Pourquoi est-il nécessaire d’après vous de renouveler radicalement la langue et du même coup la forme romanesque ?
La littérature n’a jamais changé le monde, mais le monde a toujours changé la littérature. Il faut évidemment distinguer le langage scientifique du langage littéraire. La littérature fait face à un système complètement abouti de langage, comme un aimant, et la puissance de l’écrivain, ce sont les bouts de fer qu’il place en fonction de cet aimant. De cet effet de l’attraction et de l’approche du langage naît la poésie, et ma tâche consiste à extraire de ces tensions mon propre langage. Chaque écrivain qui pense et qui réfléchit sur le langage peut trouver son propre langage. J’ai très peu inventé, j’ai surtout retrouvé des choses.
L’ensemble du roman semble signer une lutte acharnée contre les « Idéo=Logues » (p. 225). Vous écrivez : « pour tenir en=échec…les masses il faut que chaque nouveau triomphe surpasse le précédent, sans quoi les victoires sonnent comme des défaites. Or, si les-masses ne peuvent plus hurler&pousser des cris de joie, elles perçoivent très vite Le Silence la vacuité au cœur du-Triomphe, comparable au vide… » En quoi esthétique et politique se rejoignent-elles ?
La vie sociale s’organise autour de deux pôles : gouverner et être gouverné. Dans ce contexte, le mensonge a une fonction importante. Le fait que nous, dans notre vie, nous subissions le mensonge de la part de toutes sortes de personnes ne devrait pas nous affliger. Ce qui m’agace en revanche, c’est quand le menteur ne se donne aucun mal. Cela veut dire qu’il y a le bon mensonge – on pourrait l’appeler une correction plaisante de la réalité, presque une utopie – et le mauvais mensonge, qui est exactement le contraire, une véritable diffamation de celui à qui l’on ment. Foucault, dans Qu’est-ce que la critique ?, a répondu à cette question de gouverner ou de ne pas être gouverné. Il ne s’agit pas de ne pas gouverner du tout mais de ne pas se laisser gouverner par de mauvais mensonges. La base fondamentale de notre existence est d’être gouverné par de bons mensonges. La vérité n’existe pas, il n’y a que des vérités construites. Comme le disait Nietzsche, la vérité est une erreur qui a tellement persisté qu’elle ne peut plus être évacuée du monde. Avec ces vérités construites, on peut tout à fait travailler.
Vous évoquez dans un entretien combien les femmes en temps de guerre sont habiles à déployer toutes sortes de ruses.
Oui. La violence est classiquement attribuée à l’homme, mais ce n’est pas la seule façon d’exercer le pouvoir, il y en a d’autres. Et bien sûr les stratégies de ceux ou celles qui sont soumis, les femmes, ou certaines couches sociales, doivent être différentes de la violence ouvertement exercée. Par exemple, mais j’ose à peine le dire, les armes de la femme. Dans la bourgeoisie, c’est l’administration de la fortune. Et il y a aussi la puissance du sexe. Il n’y a que des hommes stupides pour penser qu’ils conquièrent les femmes, c’est la femme qui décide, qui accepte. Il faut donc distinguer clairement puissance et domination. En tant qu’écrivain, je dois travailler avec le pouvoir du lecteur et de l’éditeur. La question de la domination s’exercerait de façon violente si on m’interdisait par exemple l’écriture préparée. Plus une société peut s’auto-suggérer des interdictions, plus elle a des chances de survivre. L’échec des dictatures à l’Est s’explique par le fait que l’État n’avait plus la capacité d’imposer ses interdictions. En RDA, plus on allait vers l’abîme, plus les frontières se sont fermées, et la casserole a débordé. C’est un exemple de domination qui meurt par ses propres moyens de domination. Et cela a un rapport bien sûr avec le rôle des femmes dans mon livre.
Il y a quantité de moments où l’on rit en lisant Le silence et on ne le dit pas assez. J’ai, pour ma part, ri à de nombreuses reprises, certes d’un rire parfois un peu décalé…
Que vous ayez ri me fait très plaisir. Il est difficile de parler de l’humour en général. Je pense que vous voulez évoquer l’humour du catastrophique. Quand j’étais enfant, j’ai assisté à un accident terrible, un motocycliste a heurté un tramway et a été décapité sur le champ. Sa tête, dans un casque jaune, a roulé sur la route, et à côté de moi une jeune fille s’est mise à rire. Chaque catastrophe a son humour propre, la terreur et l’humour se rejoignent. Il y a aussi des formes plus simples d’humour.
Et un certain cynisme ?
Le cynisme est parfois le sel d’une situation.






![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





