Vladislav Bajac retrace la vie de Mehmed Pacha Sokollu, Serbe, né chrétien en 1505 en Bosnie-Herzégovine, et enlevé à l’âge de dix-huit ans pour devenir janissaire à la cour ottomane. Jonglant avec l’histoire et les idées, Hammam Balkania se lit comme une parodie des controverses qui ensanglantent l’histoire serbe depuis longtemps, quand chacun revendique une origine « originale ».
Vladislav Bajac, Hammam Balkania. Trad. du serbe par Gojko Lukić, Éditions Galaade, 350 p., 24 €.
Connaissez-vous Ivo Andrić ? Sûrement. Né en en 1892 en Bosnie-Herzégovine, il a vécu, enfant, à Visegrad dont il a immortalisé le pont sur la Drina dans un roman du même nom, construit par un des plus grands vizirs de l’Empire ottoman, Mehmed Pacha Sokollu. L’un des fils spirituels d’Ivo Andrić se nomme Vladislav Bajac, il est né quelque soixante ans plus tard, en 1954, et il a entrepris d’écrire une autre histoire de ce vizir serbe, en se plaçant sous le signe de son aîné, mais en prolongeant ce pont jusqu’à nous, sous des auspices inattendus, davantage, dirions-nous, déconstructivistes et conceptuels.
Épris de poésie, de littérature et de rock and roll, d’histoire et d’histoire des idées, Vladislav Bajac a créé une maison d’édition nommée Geopoetika, c’est dire si, dans son esprit, la question de la géographie et de la terre est liée à celle de la langue, son pouvoir, ou plutôt, son rôle de réservoir : réservoir de l’enfance, des origines, des premiers sons entendus dans la vie, que chacun transporte avec soi jusqu’à la mort. Geopoetika publie de nombreux écrivains contemporains, dont la plupart sont de grands humanistes et voyageurs de notre temps : Orhan Pamuk, Umberto Eco, Alberto Manguel, António Lobo Antunes, mais aussi Soljenitsyne, Bob Dylan et Leonard Cohen… C’est important : beaucoup sont des interlocuteurs que Bajac invite en chair et en os dans son Hammam Balkania.
Le fil narratif de ce drôle d’engin romanesque est double. D’une part, l’auteur raconte l’histoire de Mehmed Pacha Sokollu, Serbe, né Bajica Sokolović en 1505, en Bosnie-Herzégovine, et enlevé à l’âge de dix-huit ans par le gouverneur chargé de repérer les garçons les plus doués pour devenir janissaires à la cour ottomane. Les chapitres qui lui sont consacrés sont indiqués par des lettres de l’alphabet latin : A, B, C… D’autre part, l’auteur nous invite à participer à toutes les réflexions que lui inspire cette histoire de Mehmed Pacha, y compris ses échanges avec ses amis artistes et intellectuels, de brèves analyses du sens d’un mot, des conclusions inattendues, voire incongrues, qu’il tire de tel fait ou tel chiffre : ce soliloque à variable ajustée est également scindé en chapitres brefs, alternés avec les autres, mais indiqués par des lettres de l’alphabet cyrillique serbe. Dans la version originale, ces chapitres-ci étaient écrits en cyrillique serbe, l’autre alphabet d’un peuple habitué à lire les deux graphies, Vladislav Bajac jouant de toutes les combinatoires possibles, dont la combinatoire linguistique.
Car Bajac, que l’on ne sache ouvertement oulipien, est un amoureux des chiffres et un écrivain facétieux. L’alternance entre les lettres latines et cyrilliques serbes n’est pas stricte, de même que son roman ne démarre pas immédiatement, mais après une série de hoquets intitulés « Avant le début », « La fin », « Le début même », « Après le début », qui ont leur équivalent à la fin : faut-il y voir une concession à l’esprit du temps qui voit de nombreux écrivains mettre en scène leurs hésitations, leurs doutes, ou simplement leur travail en train de se faire ? Une parodie des controverses qui ensanglantent l’histoire serbe depuis si longtemps, quand chacun revendique une origine « originale », sans cesse démentie et contredite par un autre qui détient une origine encore plus « originale » ? Chez Vladislav Bajac, il y a là quelque chose de swiftien, de tragi-comique, d’auto-dérisoire, qui touchera jusqu’aux lecteurs français ayant vu l’éclatement de la Yougoslavie dans le sang, les génocides et les guerres.
La vie de Mehmed Pacha est fascinante. Celui qui deviendra un des lieutenants les plus proches de Soliman le Magnifique a été arraché à sa famille, converti à l’islam, et formé à l’art de la guerre et de la conquête, laquelle l’a renvoyé plusieurs fois sur sa terre natale. Cet impôt du sang était une forme de méritocratie impériale ou, pour le dire avec l’auteur, une forme d’esclavage impérial : « Ce qu’on lui proposait, en fait, c’était d’être un esclave parfait. » Le sort semblera cruel au lecteur d’aujourd’hui, mais Bajac, auteur de haïkus, est le romancier le moins lyrique que l’on puisse imaginer. Son style et sa plume excluent le pathos : le lecteur ne doit pas s’attendre à la moindre scène de séparation déchirante, la moindre description sensuelle de la terre serbe que le jeune novice en théologie chrétienne quitte, contraint et forcé. L’écrivain procède avec une forme de détachement et de douce froideur remarquables, çà et là surprenantes, sans doute salutaires quand on connaît le déchirement lié à la question de l’identité dans la région des Balkans. « Sa venue en Turquie était voulue. S’il était conduit à l’étranger ce n’était pas pour disparaître, mais pour devenir quelque chose. […] Il ne savait pas que le corps peut lire aussi bien que l’esprit, ce que son corps était justement en train de faire pour le protéger de la nouveauté : relire son enfance, sa langue, sa foi, ses parents, ses frères et sœurs, sa cellule monacale, et sceller tout cela dans les recoins les plus enfouis de sa chair, préparant de la sorte à une période de sommeil – aussi longue qu’elle dût être – les messages distillés par sa langue maternelle. »

Mehmed Sokollu
Bajac n’est pas un conteur qui enjolive pour séduire le lecteur et donner de la chair aux personnages, aux lieux ou aux paysages. Il raconte en réfléchissant, c’est-à-dire en méditant, accompagnant les faits qui jalonnent la vie fabuleuse de Mehmed Pacha de son interprétation de penseur, de toutes les digressions dont il a envie, à l’intérieur des chapitres biographiques, et, bien sûr, dans les chapitres alternés. Ce faisant, il dessine le parcours d’une vie suivant ses traits principaux, ses grandes lignes, comme une trajectoire effilée, parfaite, sans couleurs, ni parfums, ni saisons, ni nature. Le parti-pris, à la fois anti-esthétisant et anti-roman-historique, donne naissance à un roman passionnant mais dépassionné, objectif car intellectuel et réflexif, mais subjectif car souvent, le lecteur pénètre dans la conscience du personnage principal. Au fond, il semble que ce qui intrigue et fascine Bajac est la résignation, la sagesse, la prudentia avec lesquelles Mehmed Pacha accepte d’être défait de tout ce qui le constitue en son cœur – une résignation d’apparence qui choquera le lecteur de 2016, c’est donc bon signe. Répondant aux questions de ses camarades à l’esprit mutin, enrôlés comme lui dans l’armée ottomane, Mehmed Pacha répond : « Quel genre de rébellion ? Elle ne pouvait certainement pas être ouverte, mais intériorisée, clandestine. […] Bien sûr ils étaient libres de continuer ainsi, mi-secrètement, mi-ouvertement, à contester la foi promise au prophète Mahomet, mais ils devaient savoir que le danger d’être trahis […] il évoqua une possibilité… celle d’une dualité dans la foi. » Faut-il dire à quel point ces questions de conversion, de fidélité et de foi sont actuelles et stimulantes, même, ou plutôt surtout déplacées à une époque et dans un empire si éloignés ? Une des grandes vertus du texte de Bajac est de les mettre en scène avec une pleine liberté, à plat, dépouillées, autant que faire se peut, d’émotivité, d’affects, d’idées préconçues.
Abolit-il pour autant le sentiment, la nostalgie, l’attachement ? Non, et ce sont sans doute les passages et les réflexions les plus marquantes, sur le cœur du cœur de ce qu’il faut bien appeler l’identité. Bajica/Mehmed, dont toute la vie est liée à l’armée ottomane, donc aux expéditions et aux pillages, s’appuie sur l’amitié de Joseph/Yussuf, architecte et constructeur de fortifications, né à Kayseri, au cœur de l’Empire ottoman, et non pas aux confins, comme lui. Leur complicité est l’occasion d’échanges sur l’empire, sa plasticité, sa mobilité, la relativité des notions de centre, de périphérie… Mehmed/Bajica survit aussi parce que son talent et ses consécrations successives (il a le titre d’aga, puis de pacha, puis est nommé beylerbey de Roumélie…) lui permettent de faire venir et de convertir sa famille (sauf sa mère, car « il fallait qu’une partie des Sokolovic restât dans leur patrie », pense-t-elle). Les expéditions militaires sont l’occasion de retrouver sa terre et ré-entendre sa langue maternelle : Vladislav Bajac parle à cette occasion de « joie assoupie », expression saisissante qui prolonge l’image de l’identité originale en sommeil.
C’est ainsi qu’au moment où Mehmed prépare l’expédition contre la Hongrie, il envoie des missives rédigées en serbe à toute la noblesse serbe : « C’était la première fois qu’un Ottoman si haut placé s’adressait au nom de l’Empire sans intermédiaire, et dans sa langue […] un peuple embourbé depuis des décennies dans les mensonges et les promesses, séduisantes mais irréalisables, que ne cessaient de leur faire à leur tour de rôle les Hongrois, les Autrichiens, les Latins et les Russes. […] même un mensonge était plus flatteur dans sa propre langue. » Le sérasker (chef de l’armée) n’écrit pas en serbe par cynisme et désir de soumission, puisqu’il s’adresse aux siens, mais presque malgré lui : c’est ainsi que le félicite Soliman le Magnifique : « Tu as fait des Serbes nos alliés, et tu as inquiété nos ennemis, beau coup double. »
Bajac ne récuse pas la notion d’empire, il ne récuse surtout pas l’idée d’être deux, double, bi-, de marcher, de croître et de s’épanouir avec deux prophètes, deux langues, deux allégeances. Après tout, il a placé son roman, dès la première ligne du prologue, sous le signe d’Épicure, pour conclure ces pages, non pas sur l’hédonisme, mais sur « la pérennité du relativisme éthique ».
Le livre atteint des sommets de drôlerie triste et fataliste quand Bajac évoque la Yougoslavie, petit empire qui fut celui de son enfance. Les lecteurs âgés de plus de quarante ans se souviennent de cette entité qui semblait aller de soi, menée par un Tito réputé plus indépendant que ses homologues au sein du bloc soviétique. « Quand on considère certains phénomènes sous un nouveau jour, remarque Vladislav Bajac, il arrive qu’ils acquièrent d’autres formes, d’autres qualités, et que ce qui s’y rattache change aussi. Vus sous un éclairage inédit, même les Yougoslaves deviennent possibles. Il est pourtant bien plus probable qu’il ne restera de leur existence qu’un souvenir intangible, un sentiment, celui de “yougoslavité”. » « Les Yougoslaves sont, jusqu’à nouvel ordre, en hibernation. »
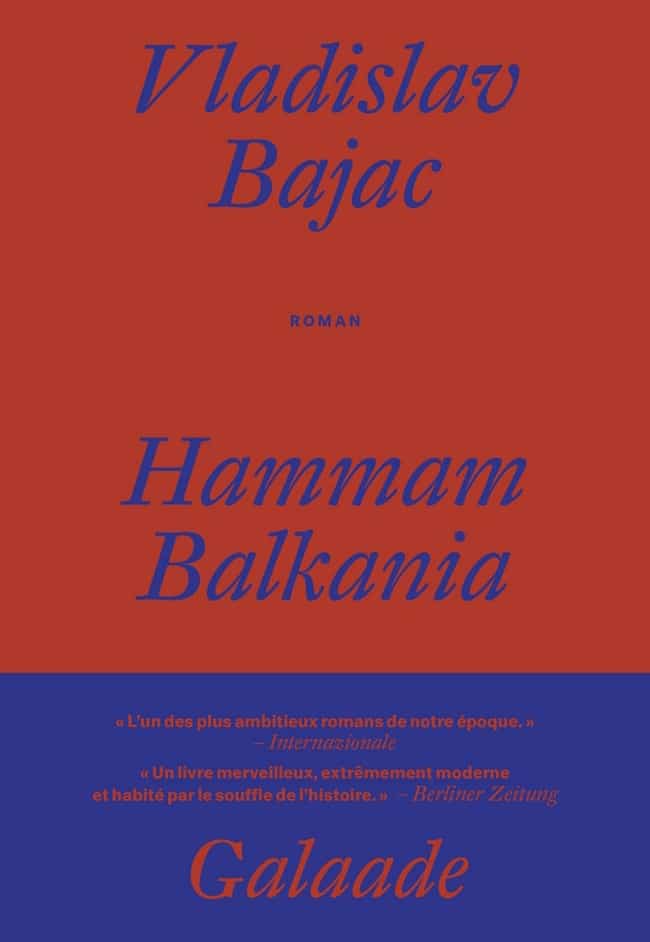
« En sommeil », « assoupie », « en hibernation » : Bajac n’est pas dupe, mais lucide, plutôt pessimiste, constatant l’alternance de conglomération et de fragmentation « de l’humus et de la pierre balkaniques », la mise en sourdine toujours précaire du conflit possible, du réveil des passions et de la haine. D’où vient alors que son livre procure un sentiment d’aération et de légèreté ? Des chapitres alternés qui sont soit des prolongations de celui d’avant ou d’après, soit des digressions gratuites, fortuites, un cheveu sur la soupe que chaque lecteur s’appropriera, ou non, qui dessinent le paysage intellectuel et esthétique dans lequel évolue Bajac : un paysage grand ouvert, mais inscrit dans la génération de l’écrivain, qui outrepasse la Serbie et l’Empire ottoman. Bajac partage les conversations qu’il a eues avec Allen Ginsberg ou le poète Kenward Elmslie sur la difficile relation entre célébrité et compétence (quand la première vient étouffer la seconde), avec James Laughlin, éditeur américain, indépendant et européanophile, créateur de New Directions, avec Orhan Pamuk et sa connaissance intime de la frontière Orient-Occident, avec d’autres, avec lui-même, avec le lecteur (« L’information n’est-elle pas de taille ? » l’alpague-t-il en direct alors qu’il explique que l’Empire ottoman reposait sur des hommes n’appartenant pas à l’ethnie ni à la religion dominantes)…
Fourre-tout ? Plutôt collage, composition élaborée, divagations, associations ou vers libres. Tout ce qu’il dit est inattendu, souvent renversé. Bajac l’éditeur s’exprime plusieurs fois, réfléchissant notamment sur l’importance accordée aux chiffres de vente et aux classements pour en souligner l’absurdité : nombre de semaines en tête des ventes, nombre d’éditions reliées, cartonnées, souples, de poche, nombre de traductions… « à vous donner le tournis ». Puis viennent les contrats d’édition, qui prévoient jusqu’à l’outre-tombe de l’écrivain : « Il est heureux que les livres survivent à leurs auteurs, mais le compte lui aussi tient bon : il suit l’écrivain dans l’au-delà et ne lui permet pas de renoncer à ses droits. Cette partie du temps post-mortem est de la mathématique béate. »
Il faut, pour apprécier cette « installation », être prêt à une lecture aventureuse et accidentée, accepter et aimer la désinvolture de Vladislav Bajac. Après tout, rien n’empêche de lire les chapitres historiques en continu, puis les autres, et dans le désordre. Il est même possible d’y voir du sens, une forme de lecture balkanisée, fragmentée et conglomérée au gré de chacun. Un comble pour un écrivain qui propose aussi une approche mathématique du monde et des phénomènes. Une mise en pratique du hasard, pourquoi ce chapitre plutôt qu’un autre ? Pourquoi l’Empire ottoman plutôt que l’Empire soviétique ? La Serbie plutôt que la Yougoslavie ? Demeure un substrat, une langue, des sons, des bruissements, des berceuses (lisez, par antithèse, page 88, la description des bruits de la guerre pour prendre la mesure de l’importance accordée par Bajac à l’ouïe). Mais aussi quelques idées fortes sur l’amitié, l’amour, le gouvernement exercé par le bouclier, bien supérieur à celui que l’on exerce par le glaive, la douceur moite du hammam où l’on se fouette « à en devenir idiot », car « ici se rencontrent la kabbale, le zen, le soufisme, l’ascèse orthodoxe, l’effacement catholique de la peur du péché, l’islam artistique… ».












