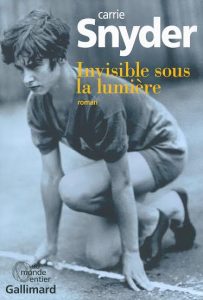 La proximité des Jeux olympiques de Rio ne manquera pas de donner un éclat particulier au roman canadien Invisible sous la lumière, inspiré par les championnes de course à pied des Jeux d’Amsterdam en 1928. Carrie Snyder sait faire partager sa passion de courir grâce à un personnage de fiction à présent centenaire qui revit son siècle d’émotions intenses, de la ferme familiale à la ville de Toronto, de la guerre des hommes au sort des femmes, des médailles aux tourments.
La proximité des Jeux olympiques de Rio ne manquera pas de donner un éclat particulier au roman canadien Invisible sous la lumière, inspiré par les championnes de course à pied des Jeux d’Amsterdam en 1928. Carrie Snyder sait faire partager sa passion de courir grâce à un personnage de fiction à présent centenaire qui revit son siècle d’émotions intenses, de la ferme familiale à la ville de Toronto, de la guerre des hommes au sort des femmes, des médailles aux tourments.
Carrie Snyder, Invisible sous la lumière. Trad. de l’anglais (Canada) par Karine Lalechère. Gallimard, Du monde entier, 351 p., 23,50 €.
« Alors je cours. Je cours sans répit, comme si aujourd’hui encore j’avais le temps et la motivation, comme si – avant que ne se déroule le fil de mon silence- j’allais enfin saisir ce qui m’échappe. » Ainsi s’achève le court prologue d’Aganetha Smart qui toute sa vie a cherché à atteindre un point fixe à l’horizon, c’est-à-dire un dépassement de soi, une plénitude et une reconnaissance. L’auteur, Carrie Snyder, joue de la veine testamentaire avec son héroïne indépendante, entêtée, désormais à la merci de son fauteuil roulant qui cahote et s’embourbe, qui cogne et s’arrête, qui repart et qui roule, à l’image des accrocs de sa mémoire.
Née en 1908, Aganetha, qui porte élégance et intelligence en patronyme, a traversé le siècle à longues foulées, prête à voler sur les pistes et les cendrées, prête à gagner. Car dans l’ombre projetée de l’athlète, il y a les silhouettes des « Matchless Six », cette équipe féminine canadienne non seulement admise aux Jeux pour la première fois mais ramenant d’Amsterdam récompenses et médaille d’or. Le roman de Carrie Snyder, sobre, décanté, peut se lire comme un hommage à l’athlétisme au féminin, mais aussi comme le parcours des pionnières au fil des cent dernières années.
Tout commence et finit sur la terre d’une ferme, à New Arran dans l’Ontario. Les souvenirs anciens restent vivaces dans la mémoire de la vieille dame, donnant l’évocation d’une vie familiale simple et rude, les récoltes, la cuisine potagère, mais aussi l’osmose avec les défunts du cimetière lorsque tisanes et simples n’ont pas calmé les fièvres. On feuillette l’Almanach du Paysan, on brode, on attend les nouvelles de la guerre en Europe, où le frère va mourir au front, tandis que la petite Aganetha court pour le plaisir dans les champs et halliers, elle court vite et par nécessité lorsqu’elle est messagère envoyée en urgence. C’est le temps du parfum des lilas et des pétales de rose, de l’huile de foie de morue comme des vieilles recettes au lait caillé. Celui aussi des faiseuses d’anges. Toute la ruralité, l’isolement en ce début de siècle habitent parents et fratrie en autarcie quasi paisible, au bord des courtes notices des stèles funéraires. Mais les premières griseries de la vitesse et les encouragements d’un entraîneur vont changer le cours de la vie d’une petite paysanne. Avec le premier départ en train crachant sa noire fumée de charbon, c’est le passage de la ferme à l’usine, de la famille au club, de la terre à la ville.
Chaque volet comporte son arrière plan, ses notations historiques liées à la course et aux filles : 1926, les coupes à la garçonne lancées par Zelda Fitzgerald et les flappers, mais pas de vêtements de sport en magasin pour elles, et seulement deux tours de piste – huit cents mètres – enfin autorisés pour les femmes aux Jeux olympiques d’Amsterdam, et il faut attendre 1984 pour le premier marathon féminin aux Jeux de Los Angeles. Émulation, tactique, amitié, tout s’enchaîne, Carrie Snyder rend bien le tourbillon qui mêle entrainement et emploi dans une chocolaterie, effort et vertige sur un fond d’illusions : « Je pense que je n’aurai qu’à courir, courir, courir, ce qui m’est naturel, même quand c’est dur, douloureux et austère. Je pourrais faire un autre tour sur-le-champ. Je pourrais courir jusqu’au coucher du soleil, comme je le disais. Je suis inépuisable, je le sais. » Athlète prometteuse, Aganetha court, nage, se qualifie, elle a le dossard 692, c’est le podium d’Amsterdam à vingt ans et le God Save the King. Le rythme du récit épouse l’accélération de la performance, cette ligne droite vers le point à l’horizon.

Carrie Snyder © Hannah Yoon
Carrie Snyder évite les écueils de la nostalgie autobiographique grâce à un personnage inventé comme « dernière survivante de l’équipe olympique canadienne de 1928 », qui cristallise sans atermoiements sentimentaux les vies de six championnes, tout en inscrivant habilement sa trame narrative dans le prétexte du tournage d’un biopic d’Aganetha Smart entrepris par deux jeunes gens, venus la sortir de sa maison de retraite. La boucle est bouclée lorsqu’ils la conduisent au cimetière familier et sur les terres de la ferme. Les sautes de mémoire de la centenaire célibataire font merveille pour faire le tri des épisodes marquants, pour clore inopinément et procéder à ce travail de coupe qui ramène toujours à l’essentiel : la course. Pour autant, Carrie Snyder ne néglige pas les à-côtés qui versent dans l’intemporel : une idylle avec un champion, les méfaits de la gloire sulfureuse qui brouillent la piste, la tentation de l’argent facile grâce au mannequinat et à la publicité, la compétition toujours plus exigeante lorsqu’arrivent de jeunes recrues.
Sans parler de l’insertion difficile dans le monde du travail, ingrate à l’usine auprès des autres femmes, discriminante ailleurs face à la priorité donnée aux hommes. Ainsi la loupe de la course permet-elle la traversée d’un siècle incarné par une fille adulée en 1928, insensible au Jeudi noir de 1929, oubliée à 22 ans. La vie d’Aganetha est un combat, une solitude armée : « Quand je cours, je suis à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de mon corps. La douleur physique est toujours présente, même quand je me sens voler, libre et lointaine. » Aucune place aux regrets, mais la tentation de la vitesse : une course gagnée c’est un prétendant perdu, mais qu’importe sur l’instant puisque prime toujours l’envie de la victoire.
Voici un beau roman sur la culture physique et l’éphémère. Un étonnement demeure quant à la traduction du titre : alors que l’original affiche clairement le genre, Girl Runner, la transposition s’éloigne du propos, gomme cette histoire de fille, cette trajectoire de course, au profit d’une équivalence et d’un faible oxymore. Et pourtant, qui oserait dire que la vie des femmes n’est pas une discipline et une course de fond ?












