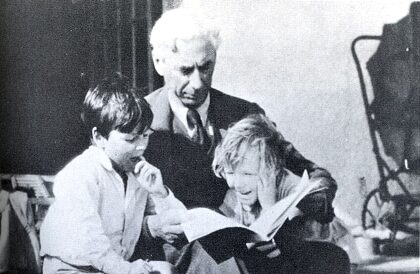L’idée que la valeur morale de nos actions et notre bonheur puissent dépendre du hasard choque nos conceptions contemporaines fondées sur le devoir et la responsabilité, mais elle était familière aux Anciens. Dans ce livre classique, Martha Nussbaum montre, aussi bien à partir des poètes tragiques que des philosophes, que la vulnérabilité fait partie intégrante de la vie éthique chez les Grecs, et soutient que nous ferions bien de nous inspirer d’eux. Mais si le bien est si fragile, qu’en reste-t-il ?
Martha C. Nussbaum, La Fragilité du bien : Fortune et éthique dans la tragédie et la philosophie grecques. Trad. de l’américain par Gérard Colonna d’Istria et Roland Frapet, avec Jacques Dadet, Jean-Pierre Guillot et Pierre Présumey. L’Éclat, 704 p., 35 €
Nous nous assurons contre la maladie, le vol, les accidents de toutes sortes, nous faisons tout pour ne pas subir le chômage, les krachs boursiers, les catastrophes, les guerres, le réchauffement climatique et les politiciens supposés nous guérir de tous ces maux. Pour nous, le bonheur c’est la sécurité. Il n’y a aucune raison de penser que les Grecs anciens subissaient moins les aléas de la fortune – ils n’avaient ni les attentats ni Donald Trump, mais ils avaient les nuées de sauterelles et les Barbares – mais au moins ne faisaient-ils pas résider le bonheur dans l’absence de risque. Pour eux, le bien consistait dans l’eudaimonia, le bonheur conquis contre le hasard, mais aussi avec lui. Ils auraient parfaitement admis l’existence de cas de ce que Bernard Williams, dans son livre éponyme (Cambridge University Press, 1981 ; Puf, 1994) a appelé la « fortune morale », dans lesquels, bien que l’agent ne soit pas responsable de ce qui est arrivé, il est malgré tout blâmable parce que les choses ont mal tourné, ou louable parce que les choses ont bien tourné. Si le chauffeur d’un poids lourd écrase un enfant qui se jette sous ses roues, il se blâmera lui-même, bien qu’il n’ait commis aucune faute de conduite. Ou encore si Gauguin quitte femme et enfants pour aller peindre en Polynésie, nous jugeons sa conduite pardonnable parce qu’il a produit des chefs-d’œuvre. Mais l’aurions-nous excusé s’il n’avait livré que des croûtes ? Nous savons bien que le bonheur dépend pour une large part de la chance et du hasard, mais nous sommes réticents à faire dépendre nos jugements moraux de la fortune. Selon Martha Nussbaum, c’est parce que nous sommes des kantiens impénitents, qui associent la moralité au devoir, à l’intention et à l’obligation, que nous ne sommes pas capables de voir le rôle que joue la fortune dans la recherche et la possession du bonheur. L’éthique grecque, au contraire, lui donne une place centrale.
Nussbaum entend montrer dans La Fragilité du bien (1986) que les Grecs ont été sensibles à des aspects majeurs de la vie humaine qui résistent à toute planification : les valeurs que les agents poursuivent entrent souvent en conflit, leurs plans sont déjoués par des événements externes qui échappent à leur contrôle, et leurs plans rationnels entrent sans cesse en conflit avec leurs désirs. L’originalité de son livre ne tient pas seulement à la manière dont elle explore ces thèmes de manière systématique chez les philosophes, principalement chez Platon (dans la République et le Phèdre) et Aristote (dans l’Éthique à Nicomaque), mais aussi à la façon dont elle les rapproche des textes tragiques, chez Eschyle, dans l’Antigone de Sophocle et dans l’Hécube d’Euripide, selon une méthode qu’elle reprendra plus tard dans Love’s Knowledge (Oxford University Press, 1992 ; La Connaissance de l’amour, Cerf, 2007), où poésie et littérature dialoguent et échangent leurs problèmes. Nussbaum soutient que la poésie et la tragédie – et la littérature en général – peuvent quelquefois, non seulement permettre d’atteindre la connaissance pratique, mais aussi être constitutives de cette connaissance. Ainsi, l’Agamemnon d’Eschyle montre comment un homme de bien peut être conduit à faire des actions mauvaises ; le conflit entre Antigone et Créon vient de leur incapacité à comprendre que l’admission d’une pluralité de valeurs fait partie de la vie bonne. Nussbaum soutient que Platon, dans le Banquet et la République, développa une théorie morale visant à rendre la vertu invulnérable à la fortune, pour y renoncer dans le Phèdre, et qu’Aristote développa une théorie morale qui intègre parfaitement la part du hasard dans la vie humaine, dans le raisonnement pratique et dans la poursuite de la vertu. Martha Nussbaum développe en particulier l’idée que l’akrasia, l’absence de contrôle de soi, est constitutive de la vie éthique chez Aristote.
Même si les lectures des poètes par Nussbaum sont très stimulantes, on peut se demander si elles ne coulent pas un peu trop de source. Platon a-t-il vraiment centré, comme elle le soutient, son éthique sur la fortune morale ? Dans la plupart des dialogues, Socrate insiste sur le fait que le bien consiste dans la connaissance, laquelle dépend du logos, qui exclut la chance. Quand elle discute le thème du « sauver les apparences » chez Aristote, Nussbaum soutient que celui-ci entend restreindre les vérités auxquelles nous avons accès à celles qui relèvent de notre schème conceptuel, et exclure celles qui pourraient relever d’une réalité métaphysique externe à ce schème. Elle attribue au Stagirite une forme de ce que Putnam appelle le « réalisme interne » (p. 588). C’est une bizarre conception du réalisme d’Aristote, qui le « kantise » à l’excès. Les hellénistes et les spécialistes de philosophie grecque froncent toujours le sourcil quand on reconstruit un peu trop les doctrines des Anciens, et ils n’ont pas manqué de le faire ici. Ce qui les fait tiquer dans la lecture par Nussbaum de Platon et d’Aristote, et dans son insistance sur le fait qu’il admettent la fragilité du bien et le conflit des valeurs, c’est que cette idée ne colle pas vraiment avec les doctrines les plus connues de ces philosophes, qui sont le plus souvent considérées comme des formes (bien que différentes) de réalisme moral : si le bien est à ce point soumis à la chance, comment peut-il orienter notre vie éthique, et comment peut-il s’incarner dans des vertus stables ? Une chose est d’être sensible au rôle de la fortune dans la vie morale, autre chose est de suspendre la vie morale tout entière à l’influence de la fortune. Nussbaum a parfaitement raison de mettre l’accent sur le premier point, et de souligner les passages dans lesquels Aristote – comme, si on la suit, nombre de poètes tragiques – soutient que la vie morale dépend essentiellement du hasard. Mais le fait que la pratique soit par nature indéfinie et que nos meilleurs efforts pour atteindre le bien ne soient pas à l’abri du désastre implique-t-il que le bien soit le produit de la fortune et même « constitué » par lui (pp. 392, 420) ? L’apprentissage de la vertu et l’acquisition du savoir pratique et du jugement, même s’ils s’exercent dans la contingence et s’ils sont fragiles, ont une robustesse et une stabilité qui visent à échapper aux aléas de la fortune, et non pas à vivre avec elle.
Nussbaum, dans la préface de l’édition de 2001 de son livre (reprise ici et complétée par une préface spécifique à l’édition française), s’emploie à redresser l’image un peu existentialiste que son livre avait pu suggérer, celle d’une vie éthique qui échapperait à la raison, en soutenant une conception plus stoïcienne des émotions, défendue dans son livre La Thérapie du désir, (Princeton University Press, 2009), et en prenant ses distances avec l’aristotélisme qui dominait encore sa pensée dans La Fragilité du bien et La Connaissance de l’amour. Elle rapproche les thèmes stoïciens qu’elle a défendus depuis ces livres d’une position plus cosmopolitique et plus kantienne, faisant plus de place à la volonté humaine capable de résister aux passions et de promouvoir la raison. Si elle éprouve le besoin de rectifier ainsi le tir, c’est que ce livre et une partie de son œuvre ultérieure ont été considérés comme emblématiques d’un rejet de l’éthique systématique et théorique, de type kantien et utilitariste en particulier, et comme favorables à une éthique « particulariste », fondée non plus sur des principes et des règles, des valeurs objectives et abstraites, mais sur une appréhension de situations particulières et concrètes, attentive à la « vulnérabilité » et à la « sollicitude » (« care ») envers autrui et envers les faibles, les minorités ethniques, sexuelles, bref une éthique « à visage humain » et non pas impérative et impersonnelle.
En France, ces thèmes sont devenus familiers. Il n’y a plus un livre sur la morale qui ne nous dise que la vraie morale se moque de la morale, que la vie est tragique, « inquiète », et que nous sommes tous des victimes. Au sein de l’éthique anglo-saxonne, ces thèmes ont été déclinés de manière assez variée. Chez des auteurs comme Bernard Williams, ils ont pris la forme d’un scepticisme quant à la possibilité de fournir encore de grandes théories éthiques. Chez des néo-intuitionnistes comme David Wiggins ou John McDowell, ils sont associés à l’idée que nous saisissons les valeurs morales à travers une forme de perception singulière et immédiate. Des penseurs féministes comme Judith Butler et Carol Gilligan les relient à l’idée que l’être féminin est par définition vulnérable, et y trouvent le modèle de toute éthique. Chez des penseurs post-foucaldiens comme Giorgio Agamben, ces thèmes sont associés à une critique des pouvoirs et des normes, qui précarisent les populations. Des auteurs comme Stanley Cavell et Cora Diamond ont soutenu que l’éthique doit porter sur les êtres humains et sur la « vie ordinaire », version américaine de l’Heimat heideggérien. Tous ces auteurs ne disent pas la même chose, mais ils rejettent tous les conceptions monistes du bien et l’idée qu’il puisse y avoir une théorie éthique fondée sur des valeurs et des prescriptions. Renouvelant sans le savoir la leçon d’« inquiétude » de Gide, ils se refusent à affirmer et à juger, et placent toute l’éthique dans le sentiment. Ils ne cessent de dénoncer les pouvoirs et les crimes, mais refusent d’envisager en quoi le bien moral ou politique pourrait consister. Derrière toutes ces éthiques de la fragilité, il y a une confusion de base : le fait que les valeurs et les prescriptions soient très difficiles à appliquer dans la vie réelle n’implique pas qu’il n’y ait ni valeurs ni normes.
Nussbaum se défend d’avoir, par ses écrits et par ce livre en particulier, inspiré ces éthiques si anti-moralisatrices, mais en fait si moralisantes et si gnangnan. Elle insiste sur le fait que l’éthique a besoin de théories et de raisons, pas d’un recours systématique aux émotions. Elle rejette le particularisme, le refus de toute norme par l’éthique de la vulnérabilité. Dans un essai violent et salutaire contre sa partenaire en féminisme Judith Butler, elle a récusé le « quiétisme » de cette dernière et l’a traitée de « professeur de parodie »1. Mais elle est bien obligée d’admettre qu’elle a elle-même flirté avec ce quiétisme.