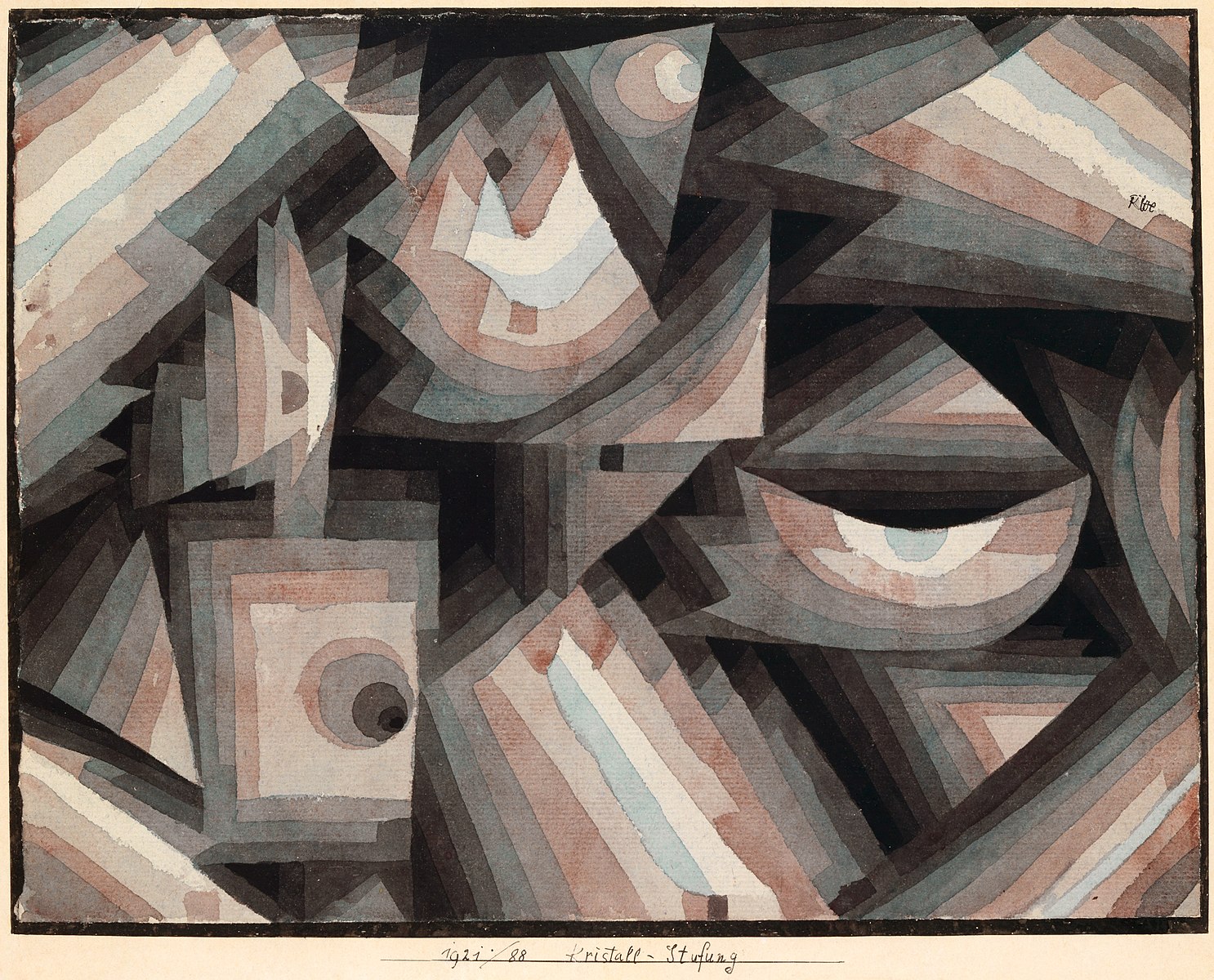Notre collaborateur Maurice Mourier a répondu aux questions d’En attendant Nadeau au sujet de son dernier ouvrage, Par une forêt obscure.
Maurice Mourier, Par une forêt obscure. L’Ogre, 270 p., 20 €
Ce livre n’est pas ce qu’il semble être. Spontanément, on le prend pour une énième autobiographie. Et pourtant, tout en lui s’insurge contre cette entreprise. En fait, c’est tout autre chose.
Dans mon esprit, ce n‘est pas une autobiographie. C’est très net. Je confesse d’emblée que j’ai une haine assez profonde pour les autobiographies ou, plutôt, pour les récits de vies. Ce qui n’est pas la même chose. Je considère, par exemple, que Les Confessions sont une extraordinaire autobiographie mais que ce n’est pas un récit de vie dans la mesure où Rousseau n’arrête pas de mentir. Et il ment volontairement, non pas parce qu’on ment toujours dans ce qu’on dit, dans ce qu’on fait, mais parce que le mensonge est une manière de se dire, de proprement se raconter. Pour moi, c’est exactement pareil. Je ne souhaite pas mentir, mais je veux absolument que ce livre qui, en effet, utilise des éléments de ma propre existence apparaisse pour ce qu’il est : c’est-à-dire une reconstitution d’autant plus inexacte, partielle, que beaucoup des événements que vivent les enfants relèvent d’une inconscience partielle. Il faut donc qu’il se crée dans le livre une distance significative entre la narration et le personnage, même si celui-ci entretient des liens très profonds avec le narrateur.
Mais il n’y a pas d’égalité entre l’existence réelle et la façon dont on la raconte
Non. D’autant moins que les souvenirs utilisés remontent, à la fin du livre, à l’âge de six ou sept ans, mais qu’il y en a d’autres qui appartiennent à la toute petite enfance, puisqu’il y a deux chapitres de flash-back, essentiels pour la psychologie de l’enfant, avec son père absent et sa mère omniprésente, quand il a deux ou trois ans, des souvenirs très forts, mais enfouis dans une des strates les plus reculées de son existence. Et le livre, dans sa continuité, tient compte de l’immense quantité de temps qui a passé entre les événements qui se sont, peut-être, déroulés et les moments où ils sont évoqués. Il y a une distance forte entre le narrateur et le personnage dont il est l’ancêtre. Et cette distance doit se marquer, à l’évidence, par des procédés littéraires.
Une histoire véritable est-elle toujours une histoire vraie ?
Je ne sais pas. À tel point que j’ai envisagé de donner deux suites – que je n’écrirai probablement jamais – à ce livre. Une, sous forme de poème en prose, portant sur le personnage central de la grand-mère, ce que je ressens aujourd’hui à son égard, un être avec qui j’ai des rapports proprement lyriques, poétiques. Une autre aurait consisté à écrire une recension, une « histoire véritable de Mère-grand », avec un travail de recherches fouillé à partir des carnets de mon père, qui notait tout ce qui lui arrivait tous les jours. Je ne les ai jamais ouverts. Et ils contiennent, j’en suis sûr, des éléments factuels qui me prouveraient que certaines des choses que je raconte sont fausses, pour la chronologie et, peut-être, totalement.
Il y a par exemple, dans Par une forêt obscure, un passage fantasmatique qui me paraît essentiel : l’éclipse de soleil qui précède dans le livre la catastrophe de la fin de la guerre, lorsque la DCA allemande canarde les avions alliés. C’est la première irruption de la violence dans la vie de l’enfant, puis on découvre les arrestations dans la Résistance, la torture, un incendie, l’arrivée des Américains… Tout est lié à l’éclipse, à ce phénomène extraordinaire qui fait dériver, qui transforme l’ordre naturel des choses et qui apparaît comme la répétition générale de ce qui se passe ensuite. Eh bien, cette éclipse, je ne sais pas si elle a eu lieu en 1944, si elle existe tout simplement. Et je n’ai pas vérifié, je n’ai pas voulu vérifier, surtout pas ! Donc, tout ce qui arrive au petit garçon m’est en quelque sorte arrivé, émane de ma propre mémoire. Mais je ne crois pas que ma mémoire propre, singulière, justifie le terme d’« autobiographie ». L’autobiographie relève d’un travail conscient, organisé, qui doit avoir des appuis plus précis. Tout cela manque ici volontairement. Ce n’est pas une autobiographie, c’est la reconstitution par un adulte de quelque chose qui s’est probablement passé et qui entretient des rapports profonds avec sa propre existence mais qu’il ne peut pas – qu’il ne veut pas – authentifier. C’est une autobiographie un peu décalée.
Un de mes amis cinéastes m’a fait une remarque que je trouve juste : c’est un livre de cinéma parce que le narrateur est en amorce légère derrière le récit, c’est-à-dire qu’on le voit toujours et qu’on ne le voit pas. L’amorce légère… Effectivement, c’est une position particulière où le narrateur est présent et absent à la fois, effacé et présent, innommé. C’est une ombre, un fantôme, un fantasme… Plus encore que l’enfant, chose étrange finalement, car logiquement ce devrait être l’enfant qui relève du fantasme rétrospectif. Ici, les proportions s’inversent, bizarrement.
Ce qui compte, ce ne sont pas les détails intimes qui constituent le livre mais la distance qui s’instaure entre ce que le livre semble être et ce en quoi il se transforme. Au-delà de la distance temporelle qui travaille le récit, on est frappé par une distance d’ordre proprement poétique. Tout le récit s’adresse à un « tu » qui, étrangement, se fait très discret.
Par une forêt obscure fait partie de mes quelques livres qui semblent s’être écrits tout seuls. Je n’y ai rencontré aucune difficulté – alors que j’en rencontre souvent beaucoup. C’est particulièrement vrai lorsque je dois inventer une histoire, développer une trame, établir des rapports entre les personnages. Cela n’a rien d’évident pour moi et je ne me mets pas dans une histoire très facilement. Je ne me raconte d’ailleurs pas d’histoires et je n’aime pas tellement celles que l’on me raconte. Il y a des livres que j’écris en étant très conscient, et d’autres que je produis dans une sorte d’état second, comme en lévitation. Très vite, il m’a semblé évident d’utiliser le « tu » pour désigner ce personnage d’enfant qui réapparaît dans la conscience de quelqu’un d’autre, bien des années plus tard. La forme de l’adresse – qui n’est pas systématique – souligne ce qui les sépare. Il y a entre eux des brumes successives, des étages de brumes, un flou. Cette forme d’énonciation m’a paru absolument nécessaire. Dès que je m’en suis rendu compte, tout est allé tout seul, comme une grande fête d’écriture, sans difficultés, très vite.
C’est un procédé éprouvé. Pourtant, il semble flottant, n’arrête pas la lecture, ne fait pas obstacle. Il rencontre au contraire celui par lequel, à l’intérieur du récit, on s’adresse à l’enfant. On glisse dans le livre qui entremêle des strates narratives ; des tiroirs s’ouvrent dans le récit, des temporalités se déplacent, des discours se chevauchent.
C’est vrai, l’enfance est loin. Ce n’est pas seulement la distance entre le narrateur et l’enfant car, par le truchement du personnage central de la grand-mère, la distance temporelle énorme entre eux s’exagère encore. La grand-mère – Mère-grand – vit dans le passé, le sien, celui de sa famille, de son fils et de son époux dévorés par la guerre de 14. Elle passe son temps à raconter ce passé, son enfance protestante, sa vie en Algérie, son emploi au ministère des Pensions à Paris – comme veuve de guerre obligée de s’expatrier (l’Algérie était son pays), de travailler… Ainsi, dans le livre, le passé semble très réel, très présent en même temps qu’incroyablement distant. L’enfant vit dans une atmosphère de mort – non pas au sens macabre, mais dans une relation avec les morts. Avec l’Occupation, la grand-mère vit donc une période qui réactive son passé, des références anciennes, guerrières, une douleur. On recule ainsi dans le temps de manière vertigineuse. Cette dilution temporelle, cet entremêlement, réfléchissent, dissimulent les épisodes répétitifs d’une guerre éternelle qu’elle abhorre. Progressivement, ces morts dont elle parle tout le temps semblent beaucoup plus vivants que les personnages qui entourent l’enfant. Il me semble évident que la dimension poétique profonde du livre se loge là, d’abord. Ce petit garçon vit poétiquement. Bien que le monde physique soit extraordinairement prégnant, il ne vit pas dans le réel. Certes, il est dans la réalité, mais elle se double, se triple, se quadruple en permanence de pans du passé qui se muent en son propre présent. Il y a là quelque chose d’essentiel pour moi : faire sentir cette réalité de l’absence, du passé absent qui est en vérité plus présent que le présent même. Et c’est ce qui confère au livre je crois, sa dimension fantasmatique, proprement poétique.
Le récit s’ordonne selon un régime de tensions. Il y a d’un côté un rapport féerique au monde et de l’autre une hyper-précision descriptive. Le livre est un peu paradoxal à cet égard. Ce qui compte n’est pas le souvenir des expériences mais ce qui se joue de littéraire à partir d’elles. On peut ainsi lire le livre comme une collection de souvenirs d’enfance durant la guerre mais également comme une déclaration poétique très forte.
C’est exactement ça. C’est si vrai qu’un des moments clefs du livre, très bref, est celui où l’enfant – non pas avec sa grand-mère, qui ne fabrique pas des histoires mais les raconte, en conteuse enchanteresse des Mille et Une Nuits – compose avec sa mère un petit conte. C’est dans ce moment précis qu’il découvre ce qu’est la littérature. Il apprend alors comment on construit des histoires, des fictions, qu’on peut faire quelque chose de sa fantaisie, transposer le réel dans un univers féerique. La mère est d’ailleurs toujours perçue comme une fée – parce qu’elle est absente, qu’elle offre des cadeaux, qu’elle est très jolie, qu’elle apparaît coiffée d’une voilette ou nimbée d’un nuage de parfum autour d’elle. La fée initie le petit garçon à ce que c’est de transposer la vérité du monde. La réalité est ici au fond terrible – toute la suite du livre le démontre –, c’est la guerre, le malheur, la réalité de l’horreur des combats, la peur omniprésente. À cette ambiance terrifiante s’ajoute la présence d’un réfugié sans papiers que la grand-mère cache et qui les plonge dans un danger permanent. Ce sentiment est excessivement prégnant dans tout le livre, mais l’enfant découvre qu’à partir de la réalité sordide du monde on peut inventer, trouver une capacité en soi à flotter au-dessus du monde et à re-fabriquer un conte à partir d’un réel terrifiant. Reconnaître cet éveil singulier aux pouvoirs de la fable et du conte me semble capital pour comprendre que c’est un livre sur la création littéraire, la création d’un monde littéraire.
Quel cadeau ! C’est de là que vient probablement l’impression paradoxale que beaucoup de joie habite le récit.
Je pense que, de toute façon, la joie est liée à l’évocation du passé. La grand-mère, en racontant toutes ces histoires, offre à l’enfant un autre monde. Un monde plein de bonheur, de joie, étonnamment décalé. Dans sa bouche, le passé est héroïsé, il atteint des proportions mythiques, presque magiques. L’enfant vit dans la réalité, dans le monde de tous les jours, en même temps que dans ce monde mythique perdu. C’est une étrange égalité, un écart subtil. L’enfant apparaît toujours décalé, au-dedans et en dehors du monde. Ainsi, comme un antidote, la réalité dangereuse, inconfortable, est recréée le soir, dans les longues veillées, par un personnage qui raconte le monde tel qu’il devrait être. On vit ici sur deux niveaux. Le livre demeure réaliste par ses détails – j’y tiens car cela fait partie intégrante de mon écriture, cette attention aux détails de la description, à l’acuité visuelle –, et il se heurte pourtant à ce besoin constant de se détacher du réel, de le refuser, de le transcender en quelque sorte, de le métamorphoser en tout cas. Le contrecarrer m’est nécessaire, jusque dans mon existence même. J’ai toujours vécu sur deux plans, profondément.

Maurice Mourier © Éditions de L’Ogre
On est frappé de l’omniprésence des choses les plus élémentaires – les plantes, les animaux, le temps qu’il fait, le passage des saisons. Cela semble relever d’un rapport terrien très fort qui recoupe cette volonté de contrecarrer le monde.
J’ai lu récemment dans une interview de Woody Allen quelque chose qui m’a plu. On lui demande pourquoi il situe toujours ses films à Manhattan, dans le même cadre. Il répond simplement : « Je me méfie toujours de l’overdose de réalité. » Cela me paraît très fort. Dans le monde actuel, dans la littérature actuelle, on éprouve une overdose de réalité. C’est-à-dire qu’on nous raconte des histoires qui arrivent à des gens dans l’existence banale. C’est ça le récit de vie qui me pose problème, et qui me pousse à affirmer énergiquement mon refus de l’idée d’une adéquation nécessaire entre ce qui est et ce que l’on raconte. On monte en épingle les choses de tous les jours alors que, pour moi, la littérature consiste justement à s’en évader, à s’en séparer, à s’en disjoindre. C’est un moyen de refuser le réel, de l’oublier aussi, un peu. Et je préfère qu’on me raconte une histoire, une vraie même, mais à condition que l’imagination y joue un rôle capital, plutôt que de me raconter la trivialité quotidienne. C’est l’imagination « maîtresse d’erreur et de fausseté » qui me paraît la clef véritable de la littérature.
Cela contrevient décidément à l’autobiographie. Si on ne peut inventer sa vie, on ne peut la raconter…
Oui, parce que ce qui m’intéresse en art c’est l’imaginaire. C’est à partir d’éléments que je puise en partie dans un passé très largement reconstitué et fantasmé, le mien, que j’imagine autre chose. Je ne peux pas le raconter et je ne le veux pas. Si j’avais puisé dans mes archives, j’aurais fait un livre beaucoup plus sérieux, solide, qui aurait essayé de dire la vérité. Mais le truc, c’est que je m’en fous de la vérité ! On l’a lue mille fois déjà. On a lu mille fois des histoires de Résistance, d’enfance dans la guerre, de juifs cachés… Ce n’est pas ce qui m’intéresse. Je pars de ça, de cette matière presque vraie, et je me fabrique un personnage imaginaire d’enfant, lui-même soutenu, surplombé, porté par des personnages imaginaires de femmes. Finalement, la vérité n’a pas d’importance, c’est ce qu’on subit. Mais quand on écrit un livre, ce n’est pas pour subir, c’est pour s’envoler.
La vérité est à combattre à toute force donc. La littérature consiste à inventer des filtres qui permettent d’en sortir.
Des filtres et des philtres. On a besoin de filtrer le vrai, parce qu’il est finalement assez abominable, et de créer des élixirs qui permettent de vivre dans un certain type de charme, d’envoûtement. Ce n’est pas un hasard si l’une de mes lectures favorites demeure Marie de France, avec Tristan et Iseult, ce merveilleux récit où un garçon et une fille, à partir d’une inscription sur un bout de bois, sont ensorcelés par leur histoire. Il y a dans certains récits ou poèmes du Moyen Âge une puissance d’abstraction poétique que je ne retrouve nulle part aujourd’hui et que, modestement, j’essaie de toucher un peu. Je pense aussi à Villon, l’un de mes poètes préférés. Voilà une autobiographie réussie. Tout y est faux ! Depuis le début, le « petit testament », tout est inventé. Il y raconte sa vie en la re-fabriquant intégralement. Il y a dans ces textes la capacité de voir au-dessous du monde – au-dessus ou à côté, comme on voudra – un autre monde, celui du fantasme. C’est quelque chose qu’on a perdu, ou à peu près. Et ça me gêne.
Ce livre me semble, d’une façon dissimulée – si dissimulée qu’on peut ne pas le voir –, une somme d’enjeux poétiques et intimes qui s’intriquent en profondeur. On parle de plusieurs plans…
C’est un livre assez compliqué en réalité. Il parle de la guerre perçue par un enfant, à une hauteur inhabituelle. Il s’emploie à montrer ce qu’a pu être l’atmosphère irréaliste de la période 1940-1944. Ces moments où le temps s’est arrêté, comme si la France était coupée de son histoire. L’apprentissage du petit garçon se situe dans cet arrêt, dans ce no man’s land, ce no time’s land. Je pense que, depuis mon enfance, toute ma vie, j’ai été obsédé par le désir de ne pas être là, d’être ailleurs. Ce besoin profond explique peut-être que je me sois accroché à cette histoire-là. Le monde que je décris était un ailleurs, quelque chose qui certes avait les aspects de la quotidienneté mais où tout semblait suspendu, et puis, tout s’est accéléré. Le livre, qui à la fin se développe très rapidement, de manière plus saccadée, porte sur cette accélération de l’histoire, cette reprise, cet emportement.
C’est pourquoi la fin est un vrai roman de guerre.
Oui assurément. Seulement cette guerre est duplice. C’est la guerre réelle, affreuse, et c’est aussi cette occasion de suspens du temps. Cela demeure très réel et très impalpable. Et le petit garçon se rend compte à la fin – ou au moins le narrateur s’en rend compte pour lui – que ça ne se reproduira plus jamais.
C’est un tour de force d’écrire un livre nostalgique sans nostalgie. Par une forêt obscure est un livre sur la déception.
Il n’y a pas de nostalgie dans ce livre parce que c’est fini. Tout simplement. Par exemple, dans l’épisode où le petit garçon retrouve André juste après la guerre et où il réalise que ce juif sans papiers qu’ils avaient caché est retourné à la médiocrité de tout le monde ; il n’est déçu que par cette inadéquation entre ce qu’on sent et ce qui est. Entre cet homme traqué et le petit garçon, les rapports se fondent sur autre chose que le langage Il y a la simple coalescence de deux existences inquiètes. Ils se reconnaissent, affectivement. La déception de l’enfant explose lorsqu’il se rend compte que sa vie est finie. Il a huit ans et sa vie est finie. Cette vie-là en tout cas ; que l’exaltation, c’est terminé. Son existence, qui était une sorte de rêve ou de cauchemar permanent, va céder la place à la vérité, la vraie vie, celle de tout le monde. Il sait qu’il ne connaîtra plus jamais cette folie, cette flamme, issues de ces moments tragiques. C’est frappant dans une scène importante à la fin du récit : avec sa mère, le petit garçon passe une nuit dans la maison de ses parents qui est fermée habituellement, et les Allemands en fuite arrivent et envahissent la maison. Ils sont sur les escaliers à regarder l’affolement des soldats, c’est irréel, ça va passer, comme un rêve.
C’est finalement un livre sur la lucidité.
Gagnée, oui. Mais c’est pénible le gain de la lucidité ! C’est ce que porte la fin du livre lorsque la poésie s’amoindrit et que ça ressemble finalement au merdoiement de la vie normale.
On peut le lire en regard – comme un reflet – du Miroir mité, comme si les enjeux du premier texte se réverbéraient dans celui-ci, à quarante ans de distance.
Ce ne sont pas les livres que je préfère. En fait, certains m’inquiètent moins. Mais ce n’est pas conscient, pas vraiment. Le décor en est assez proche, voire identique ; là aussi un enfant évolue dans le milieu clos d’une maison, les mêmes personnages féminins le traversent. Cet enfant-là vit lui aussi dans un univers fantasmatique, le réel y est déjà, pour lui, le support de rêveries, de mélancolies ou de contes bleus. Il y a un rapport évident entre ces deux textes. L’un moins abouti évidemment, mais qui pose en filigrane des jalons qu’inconsciemment j’ai essayé de développer dans Par une forêt obscure. Il y a des échos entre ces deux livres, qui ont leurs différences bien sûr ; ils se rencontrent assez doucement. Je n’ai pas senti en écrivant qu’il y allait avoir comme une boucle. Mais elle est là, présente. C’est compliqué. C’était impossible de l’écrire avant. Il fallait que ce livre arrive tard, qu’il puisse s’écrire aussi bien, aussi facilement, dans ce sentiment de joie d’écrire.
Propos recueillis par Hugo Pradelle