Sous la direction d’Arnaud Huftier, Alma éditeur entreprend l’édition intégrale des contes, récits et romans de Jean Ray, parfois publiés dans des versions incomplètes ou édulcorées et plus disponibles pour beaucoup d’entre eux. Cette réédition comprendra dix volumes jusqu’en novembre 2018. Elle débute avec deux textes majeurs du fantastique, bien différents dans leur genre et leur ton, Les contes du whisky (1925), récits brefs, âpres et oralisants, et La cité de l’indicible peur (1943), roman à l’ironie pince-sans-rire. Leur point commun, outre l’humour grinçant et la force de personnages brossés en quelques traits, tient à l’omniprésence de la peur, sujet et moteur de la fiction.
Jean Ray, Les contes du whisky. Alma éditeur, 281 p., 18 €
La cité de l’indicible peur. Alma éditeur, 251 p., 18 €
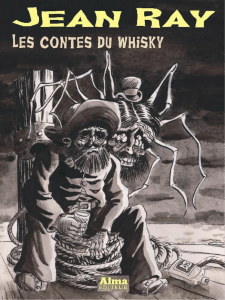 Le liquide éponyme, « ce ruissellement d’or, cette merveilleuse prière du soleil qui égrène son silencieux chapelet de pépites du comptoir au sable fin des dalles », donne son unité aux Contes du whisky. Dans la taverne portuaire du Site enchanteur, il permet à de pauvres hères de se réchauffer autour d’un verre où il délie les langues qui se mettent ainsi à parler toutes seules, en des dialogues quasiment autonomes, détachés des personnages qui les profèrent, marins, miséreux, voleurs ou assassins. Libérées par la bouteille « lumineuse, riche, pure et accueillante », des voix frustes, truculentes et saccadées dévident histoires, secrets et angoisses. Car à l’extérieur du bar chaleureux rôde le fog, « jaune, gras, lent et majestueux ». Combiné à l’ivresse, il modifie suffisamment les perceptions pour que les peurs prennent vie. « Marchons plus vite », dit un personnage, « je sens le fog qui est sur nos talons, car moi je l’entends, oui, j’entends le brouillard ! Cela commence par une plainte lointaine, un appel de souffrance perdue pour des millions d’oreilles, et puis il vient sur vous avec un bruit mat d’eaux lourdes et vous en avez pour des heures à entendre de fines petites voix aigrelettes vous insulter derrière les portes closes, des râles sourds monter des encoignures sombre… »
Le liquide éponyme, « ce ruissellement d’or, cette merveilleuse prière du soleil qui égrène son silencieux chapelet de pépites du comptoir au sable fin des dalles », donne son unité aux Contes du whisky. Dans la taverne portuaire du Site enchanteur, il permet à de pauvres hères de se réchauffer autour d’un verre où il délie les langues qui se mettent ainsi à parler toutes seules, en des dialogues quasiment autonomes, détachés des personnages qui les profèrent, marins, miséreux, voleurs ou assassins. Libérées par la bouteille « lumineuse, riche, pure et accueillante », des voix frustes, truculentes et saccadées dévident histoires, secrets et angoisses. Car à l’extérieur du bar chaleureux rôde le fog, « jaune, gras, lent et majestueux ». Combiné à l’ivresse, il modifie suffisamment les perceptions pour que les peurs prennent vie. « Marchons plus vite », dit un personnage, « je sens le fog qui est sur nos talons, car moi je l’entends, oui, j’entends le brouillard ! Cela commence par une plainte lointaine, un appel de souffrance perdue pour des millions d’oreilles, et puis il vient sur vous avec un bruit mat d’eaux lourdes et vous en avez pour des heures à entendre de fines petites voix aigrelettes vous insulter derrière les portes closes, des râles sourds monter des encoignures sombre… »
Au fil des contes, la terreur s’incarne dans l’inconnaissable, obscurité ou brouillard, contamine des corps qui se transforment en araignée, entrent en lutte avec eux-mêmes, deviennent incontrôlables, en particulier à travers leurs mains, indépendantes, séparées du corps et donc aussi du contrôle de la raison. Mains qui implorent souvent et qui, quand elles sont dédaignées, blessent ou tuent. Main sortant de la nuit tempétueuse pour menacer (« Une main… »), main révoltée contre son propriétaire (« Joshuah Güllick prêteur sur gages »), main qu’on cache (« Irish whisky »), mains qui étranglent dans le noir (« La nuit de Camberwell »), main coupée seule preuve de l’horreur (« Dans les marais de Fenn »), main coupée encore, porteuse de malédiction, dans « La dette de Gumpelmeyer », une des nouvelles moins connues rassemblées à la suite des Contes du whisky.
Grâce à une forme originale, avant-gardiste par son oralité et son tempo haché, Les contes du whisky disent brutalement la dureté d’existences privées de perspectives, marquées par un sentiment d’absurdité, des vies qui ne peuvent trouver sens et éclat que dans l’instantanéité de l’ivresse. « – Tu diras : “Quand demain ou la semaine prochaine on me repêchera sur la plage de Southend ou de Sheerness, parmi les algues, les crabes morts et la boue jaune – on me jettera vite dans un trou à l’extrême bout du cimetière et jamais un petit enfant en pleurs n’y mettra un bouquet de fleurs ou un brin de lierre – et plus tard il n’y aura jamais quelqu’un pour penser à moi, avec une larme ou un regret. C’est très dur, votre Seigneurie.” – Oh ! Hildesheim, nous serons de si pauvres morts ! aucun souvenir ne voudra de nous. »
L’anxiété peut devenir si forte que le protagoniste du « Crocodile » en meurt littéralement. Le rythme des récits tangue comme le pont d’un bateau, un alcool fort, et la vie quand elle échappe, et vire par moments à un antisémitisme instinctif et virulent qui choque. Celui-ci peut correspondre au milieu social inculte des personnages, mais il exprime aussi, à travers la récurrence de l’usurier puni par le fantastique – qu’il soit d’ailleurs juif, « Joshuah Güllick » ou superlativement chrétien, « Gilchrist » dans « Irish Whisky », « Pilgrim » dans « Le saumon de Poppelreitter » – une telle obsession de la dette qu’elle se transforme en angoisse existentielle.
On ne peut s’empêcher de rapprocher cette insistance sur la figure du créancier impitoyable de la biographie de l’auteur : Les contes du whisky sont écrits en 1923 et en 1924, quand Jean Ray dirige la revue L’Ami du livre, où, pour attirer des écrivains célèbres de l’époque, dont Pierre Mac Orlan, Francis Carco et Maurice Renard, il rétribue généreusement les articles. Trop généreusement, puisqu’il est arrêté le 8 mars 1926 pour malversation financière et passe presque trois ans en prison. La peur qui s’exprime dans des récits à la cadence convulsive à la fois propre à l’ivresse et à la fuite – et c’est le génie de Jean Ray d’avoir rapproché les deux –, la noirceur désespérée des contes avait donc une base bien réelle.
Conformément à son titre, la terreur est aussi au cœur de La cité de l’indicible peur – dans laquelle on ne trouve d’ailleurs aucun antisémitisme, alors que le livre est publié dans la Belgique occupée de 1943. La « cité » est une petite ville endormie, Ingersham, située dans une Angleterre ressemblant beaucoup à la Flandre, avec sa « Grand-Place », ses « salle[s] à manger hollandaise[s] », ses « bahuts flamands ». La petite bourgeoisie routinière qui l’habite paraît surtout préoccupée de sa quiétude et des plaisirs de la table.
Pourtant, ce cadre d’un prosaïsme presque absolu (où l’on comprend « Galatée » dans le sens de « Galantine ») cache de nombreux secrets que va révéler malgré lui un rond-de-cuir en retraite de la police, Sigma Triggs. Comme dans la série de ses Harry Dickson, Jean Ray manifeste dans ce roman son goût pour les personnages ordinaires, triviaux, et cependant subtilement tordus, bizarres, jouant à la fois sur le comique et l’inquiétude. On oscille sans cesse entre le ridicule et l’effroi. Comme les habitants d’Ingersham ne peuvent croire à la simplicité apparente de Triggs et voient en lui un habile détective venu les démasquer, leurs craintes prennent le dessus.
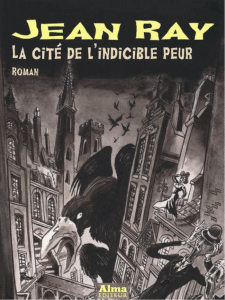 De cause et de forme diverses, les peurs individuelles et collectives finissent par s’amalgamer en une masse presque tangible que chacun habille de ses démons : « Triggs eut une dernière vision de la Grand-Place, vide à présent, et soudain elle lui parut avoir un visage énorme, hagard, tordu par une épouvante livide ». Plusieurs personnages meurent de peur : la leur ou celle des autres. Personne n’est à l’abri, ni les auditeurs d’histoire, ni ceux qui les racontent. Cette défiance face aux apparences finit par contaminer la narration du roman lui-même : si tous les crimes reçoivent en définitive des explications rationnelles, celles-ci paraissent trop simples pour convaincre. Les multiples coïncidences, qui pourraient sembler des artifices, restant, elles, inexpliquées, minent les justifications raisonnables. À la fin du roman, la peur semble bien exister en soi, en-deçà de la logique et en dépit d’elle.
De cause et de forme diverses, les peurs individuelles et collectives finissent par s’amalgamer en une masse presque tangible que chacun habille de ses démons : « Triggs eut une dernière vision de la Grand-Place, vide à présent, et soudain elle lui parut avoir un visage énorme, hagard, tordu par une épouvante livide ». Plusieurs personnages meurent de peur : la leur ou celle des autres. Personne n’est à l’abri, ni les auditeurs d’histoire, ni ceux qui les racontent. Cette défiance face aux apparences finit par contaminer la narration du roman lui-même : si tous les crimes reçoivent en définitive des explications rationnelles, celles-ci paraissent trop simples pour convaincre. Les multiples coïncidences, qui pourraient sembler des artifices, restant, elles, inexpliquées, minent les justifications raisonnables. À la fin du roman, la peur semble bien exister en soi, en-deçà de la logique et en dépit d’elle.
Les contes du whisky et La cité de l’indicible peur illustrent de deux façons différentes la capacité du fantastique à exprimer « l’indicible » : les sentiments de terreur, de culpabilité, de sa propre insuffisance à surmonter les difficultés du monde et de la vie, mais Jean Ray arrive magistralement à mêler cela à ce qui permet aussi de lutter contre ces angoisses : l’humour, la verve, l’imagination, les histoires. Et le whisky.












