Une maladie foudroyante extermine quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la population mondiale. La civilisation s’effondre. Vingt ans plus tard, les rescapés tentent de survivre dans une société préindustrielle. À partir de cet argument classique de roman post-apocalyptique, Emily St. John Mandel écrit un livre qui ne l’est pas, mêlant sous les apparences de la simplicité des questionnements sur le sens d’une vie, sur notre société, sur l’importance de l’art. Les parties consacrées au monde d’avant la catastrophe sont d’ailleurs plus longues que celles traitant de la nouvelle ère. Sans doute parce que Station Eleven énonce un postulat inverse de celui dont on a l’habitude : notre civilisation est suffisamment forte pour renaître telle quelle de ses cendres. Cette originalité, combinée à une langue aussi dépouillée qu’évocatrice, explique certainement le succès considérable du roman aux États-Unis.
Emily St. John Mandel, Station Eleven. Trad. de l’anglais (Canada) par Gérard de Chergé. Rivages, 480 p., 22 €

Emily St. John Mandel © Philippe MATSAS/Opale/Leemage/Editions Payot Rivages
L’action se concentre sur un élément central qui en représente à la fois le point de départ et le cœur : un soir d’hiver à Toronto, l’acteur Arthur Leander, célèbre mais vieillissant, meurt sur scène en jouant Le roi Lear. Ce même soir, l’épidémie se déclare en Amérique du Nord, si bien que cette mort constitue, pour les personnages qui y sont liés, le dernier événement de l’ancienne civilisation, de la même manière que la mort du roi Arthur marquait la fin d’un monde. En outre, le nom d’Arthur Leander contient celui de Lear. Comme ce dernier divisait son royaume entre ses filles, Arthur a follement partagé sa vie entre ses trois ex-épouses. Deux d’entre elles, Miranda la brune et Elisabeth la blonde, représentent des pôles opposés par ce qu’elles incarnent. Pour la première, l’intériorité, ainsi que la constance, le cap fixé par l’art, qui ancre sans limiter. Pour la seconde, l’apparence, et les fausses vérités d’une religion déboussolant autant qu’elle enferme. L’une porte le prénom d’un personnage shakespearien, l’exilée de La tempête, être de fiction et de magie, tandis que l’autre renvoie à la reine modèle de la froideur du pouvoir et de l’Église, sous laquelle vécut Shakespeare. Le roman, construit de manière très fine et complexe en allers-retours incessants entre les périodes ante et post-cataclysmique, penchera clairement d’un côté plutôt que de l’autre.
Le motif de l’apocalypse, par ses vertus de tabula rasa, permet de mettre en lumière au milieu du vide créé ce qui pour l’auteur fonde l’humain. C’était la relation filiale pour Cormac McCarthy dans La route, c’était le rejet de la société industrielle et le retour à la terre pour René Barjavel dans Ravage. Dans Station Eleven, montrer l’importance de l’art semble bien plus fondamental que décrire l’effondrement de la civilisation ou la violence dans un monde sans loi. Un autre personnage, Kirsten Raymonde, incarne la prépondérance de l’art. Enfant-actrice, elle jouait le rôle muet d’une hallucination dans Le roi Lear ; après l’apocalypse, elle continue à jouer Shakespeare au sein de la « Symphonie itinérante », une troupe qui parcourt le Midwest en carriole pour donner concertos et représentations aux quelques communautés humaines qui se sont reconstituées. Comme cela, elle donne sens à sa vie ; le théâtre nomade lui semble la meilleure existence possible dans un monde effondré. L’art apparaît également sous d’autres formes, non hiérarchisées. La devise de la Symphonie itinérante, « Survivre ne suffit pas », vient de la série télévisée Star Trek, chère au cœur de Kirsten et de son ami August. Mais surtout une bande dessinée joue un rôle central dans le roman, comme un pendant de Shakespeare et du Roi Lear.
Kirsten conserve précieusement deux fascicules de ce qui est le plus souvent appelé « roman graphique », soulignant ainsi l’analogie avec le livre qu’on tient dans les mains, un comics intitulé Dr Eleven, dont le tome 1 se nomme également Station Eleven. Les échos s’accumulent : dans un univers de science-fiction, la bande dessinée décrit une société de survivants, exilés de la Terre qui éprouvent la nostalgie du monde dont ils ont été privés. En outre, l’auteure de la bande dessinée travaille un moment comme secrétaire, comme l’a fait Emily St. John Mandel, et elle vient d’une île qui ressemble beaucoup à celle d’où est originaire la romancière. Cependant, plus qu’une véritable mise en abyme, Emily St. John Mandel instaure un subtil jeu de reflets entre son histoire et aussi bien Le roi Lear que Station Eleven. Les fascicules circulent de main en main, agissant comme un révélateur : il y a les personnages qui en voient la beauté et ceux qui les négligent, ceux qui comprennent ce que l’art peut offrir, et ceux qui se laissent enfermer dans les apparences.
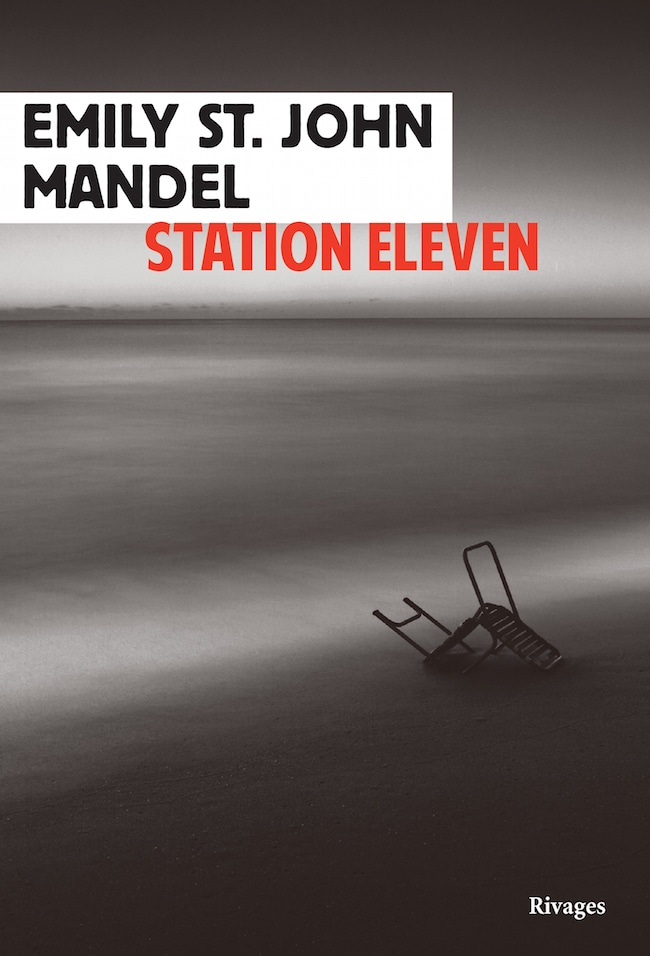
Les topoï du roman post-apocalyptique – découverte incrédule de la catastrophe, désagrégation foudroyante de la civilisation, exploration des ruines, secte millénariste, sauvagerie – sont aussi présents. Mais bien souvent le ton du récit se fait élégiaque, notamment quand Kirsten et August fouillent des maisons abandonnées. Kirsten, qui n’avait que huit ans au moment du cataclysme, cherche à se souvenir, pose des questions aux plus âgés. Clark Thompson, le meilleur ami d’Arthur, va vouer sa vie à la mémoire de la civilisation alors que, jeune homme, il avait abandonné ses études de théâtre pour devenir consultant. Le thème du destin, du choix et de la crainte de s’être fourvoyé, des changements de vie, va concerner la plupart des personnages. Ainsi, Jeevan Chaudhary, ex-paparazzi et journaliste people, entame une formation d’infirmier urgentiste : en tentant de réanimer Arthur, il aura la confirmation qu’il a trouvé sa voie et, ainsi que Kirsten, il la suivra malgré la pandémie. « Il atteignit Allan Gardens Park, situé plus ou moins à mi-parcours, et c’est là qu’une joie incongrue le prit par surprise. Arthur est mort, se dit-il, tu n’as pas pu le sauver, et il n’y a pas de quoi être heureux. Et pourtant si : il exultait, car il s’était demandé toute sa vie quel métier il pourrait bien exercer et il était maintenant certain – absolument certain – de vouloir devenir secouriste paramédical. Dans les moments où d’autres ne pouvaient que regarder, impuissants, il voulait être celui qui intervient. Il éprouva le désir absurde de courir dans le parc. Celui-ci était rendu étranger par la tempête : neige et ombres mêlées, silhouettes noires des arbres, reflet subaquatique du dôme en verre d’une serre. »
Tout au long du roman, l’écriture d’Emily St. John Mandel reste d’une grande sobriété, tout en retenue, mais elle arrive souvent à créer une atmosphère rêveuse et poétique qui n’est pas sans rappeler celle des pièces de Shakespeare. La diversité qui caractérise le livre, mêlant au corps du récit différentes formes textuelles – lettres, extraits d’interview, dialogues de Dr Eleven –, évoquant des œuvres d’art aussi bien nobles que populaires, les Concertos brandebourgeois comme Calvin et Hobbes, fait également écho à la liberté des drames shakespeariens.
Sans bons sentiments et sans manichéisme – les méchants peuvent, eux aussi, être émus par une pièce de théâtre ou une bande dessinée, et ils se trouvent bien plus souvent tués par les gentils que l’inverse –, Station Eleven montre que l’art est bien plus utile et notre monde bien plus beau qu’on ne le croit généralement. Abolissant la frontière entre science-fiction et littérature générale, Emily St. John Mandel signe, avec douceur, un très beau roman sur les armes pour combattre la cruauté du monde.












