Paracelse, de son vrai nom Theophrast Bombast von Hohenheim, né en Suisse en 1493, est l’un des personnages les plus controversés de la Renaissance. En médecine, il fut un précurseur souvent génial, posant avant l’heure les bases de l’homéopathie et devançant Mesmer dans l’utilisation d’une thérapeutique magnétique. Mais s’il est l’homme de son temps, avide de découvertes, il est aussi le continuateur d’une tradition plus secrète de l’Occident, cheminant en quelque sorte sous le boisseau des doctrines officielles.
Ainsi parlait Paracelse. Dits et maximes de vie choisis et traduits de l’alémanique par Lucien Braun. Édition bilingue. Arfuyen, 155 p., 13 €
Qui était Paracelse ? On croit le connaître, mais il reste énigmatique. Ses biographes le décrivent comme un être malingre dans sa jeunesse, presque rachitique. Ayant perdu sa mère en bas âge, peut-être à la naissance, il fut élevé par son père, médecin, qui lui apprit très tôt à reconnaître les plantes médicinales directement dans le « grand livre de la nature » lors de leurs randonnées. Quand celui-ci fut nommé à Villach, en Carinthie (Autriche), pour enseigner à l’École des Mines et étudier les procédés de transformation du minerai en plomb, Paracelse l’accompagna et fut tout naturellement le témoin privilégié de ses recherches, tout en suivant ses cours dans cette institution. Cette expérience directe forgea en lui la conviction que les minéraux constituent une matière vivante et que, comme les plantes et les extraits d’organes, ils peuvent être utiles à la guérison des maladies, idée révolutionnaire à son époque.
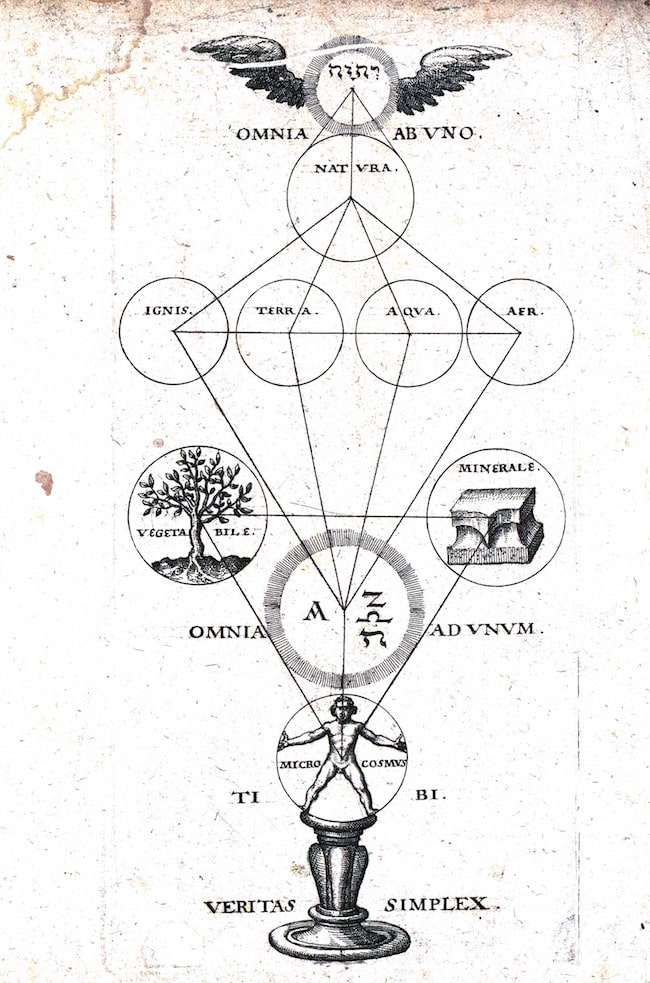
Il quitta la maison paternelle à l’âge de dix-sept ans pour entrer au collège de Bâle. On a prétendu – mais c’est improbable – qu’il aurait été le disciple de Jean Trithème, ce bénédictin épris de Kabbale et de « magie naturelle » – il avait constitué à l’abbaye de Spanheim une bibliothèque de plus de deux mille manuscrits que les intellectuels de sa génération, dont Reuchlin, venaient consulter régulièrement. Paracelse va alors voyager dans toute l’Europe, rencontrant aussi bien la plus haute aristocratie que les marginaux, les nomades, les paysans, voire les sorciers, auprès desquels il recueillera maints secrets et remèdes de médecine populaire. Il n’est pas impossible que ces voyages aient été facilités par son appartenance à une société secrète, ce qui était assez courant en son temps, mais nous n’en savons rien, le propre d’une société secrète véritable étant précisément d’être secrète. Certains de ses voyages peuvent d’ailleurs s’expliquer par le fait qu’il s’était engagé comme chirurgien militaire successivement dans plusieurs armées, hollandaise, danoise, vénitienne, cette dernière étant chargée de défendre Rhodes et les Chevaliers de Saint-Jean, ordre auquel avait été affilié son oncle, Georges de Hohenheim.
Le voici à Bâle, grâce à l’amitié d’Érasme; il est nommé médecin municipal et chargé de cours à l’université. Son premier geste provocateur consiste, outre sa tenue vestimentaire des plus négligées, à enseigner en allemand plutôt qu’en latin, au grand dam de ses pairs qu’une telle attitude, contraire aux usages, scandalisait. Il fit mieux : ses élèves ayant allumé un feu pour célébrer la Saint-Jean, il y jeta le Canon de médecine d’Avicenne, peut-être aussi des écrits de Galien, en haranguant la foule et en proférant des insultes contre la médecine officielle. Il fut chassé de la ville et reprit sa vie errante, Colmar, Nuremberg, Saint-Gall… Il viendra mourir à Salzbourg à l’âge de quarante-huit ans.
Son œuvre est à l’image du personnage et ne peut laisser indifférent. Elle est foisonnante, traversée d’intuitions géniales qu’il a souvent vérifiées par la pratique du laboratoire où il prépare ses remèdes ; puis soudain, dans ses écrits, il part dans de longues digressions, se met à fulminer, non sans panache, contre ses confrères : « Vous êtes docteurs à la manière de vos simples qui sont pourris, malades, bons à jeter et véreux », écrit-il dans son Paragranum. Cependant, cette œuvre a une profonde cohérence. On ne peut rien comprendre à Paracelse si l’on oublie qu’il s’appuie sur quatre piliers essentiels, selon lui, à l’exercice de la médecine : la philosophie, l’astronomie (incluant l’astrologie), l’alchimie et la vertu, concepts auxquels il donne un sens particulier et qui impliquent une discipline de vie. L’art suprême de la médecine pour Paracelse est de savoir lire les signes, déchiffrer les « signatures » dont les choses sont revêtues, de la moindre plante ou du moindre minéral jusqu’aux plus lointaines étoiles. C’est aussi de préparer soi-même ses remèdes, de les soumettre à l’épreuve du feu dans le secret du laboratoire, plutôt que de s’appuyer sur des théories non vérifiées.

Longtemps, les livres que nous connaissions en français étaient traduits du latin et constituaient donc la traduction d’une traduction, car Paracelse écrivait en alémanique, dialecte allemand dans lequel il tenait à s’exprimer, à la fois par fierté et par défi. Il a fallu attendre Bernard Gorceix, avec la publication des Œuvres médicales aux Presses universitaires de France pour que l’on dispose enfin d’une traduction directe, de l’alémanique au français. C’est de la même initiative que relève Ainsi parlait Paracelse, publié par les éditions Arfuyen : d’un côté le texte en alémanique, de l’autre la traduction française de Lucien Braun.
Le grand intérêt de ce nouveau livre, c’est qu’il procède d’un choix effectué dans l’ensemble des textes publiés en allemand, édition Sudhoff et édition Goldammer. Il nous offre une lecture transversale de l’œuvre de Paracelse sous la forme de fragments qui ont l’avantage de mieux fixer la pensée et nous entraînent dans une méditation adaptée à notre temps. Tout choix implique une orientation, mais celle-ci peut s’avérer précieuse dans le cas de Paracelse dont le style, très imagé, souvent répétitif et riche en néologismes, est susceptible de déconcerter les lecteurs d’aujourd’hui. L’éditeur et le traducteur mettent en exergue du livre cette magnifique devise de Paracelse : « Qu’il se garde d’appartenir à un autre celui qui peut n’être qu’à soi. » En effet, ce médecin ne reconnaît comme maître que la nature elle-même, dans son incessante créativité au cœur des minéraux, des plantes, des astres et des hommes. Même le temps est vivant pour Paracelse, construisant et détruisant à chaque instant, et toute thérapeutique doit en tenir compte.
Le livre met bien en évidence les quatre piliers sur lesquels prend appui son enseignement. Le médecin doit être un philosophe : « La nature diffère-t-elle de la philosophie, la philosophie est-elle autre chose que la connaissance de l’invisible nature ? » Il doit être un alchimiste, dans le sens précis qu’il donne à ce terme : « Est alchimiste, par conséquent, celui qui conduit au terme voulu par la nature ce que celle-ci produit dans l’intérêt des hommes. » La connaissance de l’astronomie et de l’astrologie, qui sont indissociables pour Paracelse, est nécessaire à l’exercice de l’art médical, car « toutes les planètes ont en l’homme leur reflet, leur signature ». Enfin, la vertu, qui consiste essentiellement à parfaire son art, à s’élever contre les fausses doctrines et à aimer les malades plus que soi-même. La clef de l’édifice paracelsien réside dans l’art de reconnaître les signatures : « Rien n’existe dans la nature qu’elle n’ait signé, et grâce à ces signes nous pouvons connaître ce que renferment les êtres ainsi signés. »
Ces dits et maximes de vie raviront ceux qui connaissent déjà ce « médecin maudit », comme constituant un résumé de son œuvre ; les autres découvriront l’un des auteurs les plus singuliers de la Renaissance, dont Jung disait avec admiration qu’il était un précurseur.










![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

