Ces deux impressionnants volumes collectifs, dirigés par Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, se distinguent des entreprises antérieures d’histoire intellectuelle à la fois par leur souci d’explorer tous les secteurs de la vie culturelle française sur les deux derniers siècles et par leur méthode, qui s’attache à ses conditions matérielles et sociales. Ils cherchent à éviter les jugements de déploration pour prendre un point de vue objectif sur cette longue période. Mais le peut-on vraiment ?
Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, dir., La vie intellectuelle en France, vol. I, Des lendemains de la Révolution à 1914, 655 p. ; vol II, De 1914 à nos jours, 915 p. Seuil, 38 € et 40 €.
Si l’on compare ces deux imposants volumes, qui totalisent plus de 1500 pages, avec le petit pamphlet de vingt pages de Jean-Claude Milner, Existe-t-il une vie intellectuelle en France ? (Verdier 2002), on sera frappé par le contraste. Milner répondait à sa question par la négative en soutenant que « le savoir et l’étude n’ont pas de place naturelle en France » et que tant que les productions de la République des Lettres reflèteront la société il ne pourra pas y avoir d’épanouissement du savoir et de la pensée. À l’inverse il faut bien que les presque 130 collaborateurs de cette titanesque entreprise pensent qu’il y a eu une vie intellectuelle en France depuis deux siècles pour avoir produit une telle somme. Milner parlait de la vie intellectuelle en tant qu’intellectuel, en adoptant le ton et le style les plus fréquents quand on traite de ces questions : celui de la déploration et du constat de déclin. C’est exactement l’attitude inverse que prennent les collaborateurs de ces volumes.
Comme Christophe Charle et Laurent Jeanpierre nous l’expliquent, leur projet se distingue de toute une catégorie familière d’essais portant sur l’ « histoire des intellectuels », de l’Affaire Dreyfus à nos jours. Il part du principe que la vie intellectuelle ne se limite pas aux prises de position d’une classe particulière d’individus supposés porter et incarner le destin des idées, parmi lesquels les écrivains, les penseurs et les philosophes se tailleraient la part du lion et jouent les premiers rôles. Elle entend englober bien d’autres acteurs : enseignants, professeurs, artistes, journalistes, personnalités politiques, militants associatifs, et tous ceux qui, en général, contribuent à ce que l’on peut appeler la vie culturelle d’une nation. Elle entend aussi traiter des conditions matérielles, historiques, politiques et institutionnelles qui rendent possible l’ensemble des activités intellectuelles. Ces livres portent donc sur bien plus que les idées, les courants intellectuels et leur devenir : ils portent aussi sur l’histoire, la sociologie, et même l’économie des activités intellectuelles, c’est-à-dire au moins autant sur ce qui forme le substrat de ces activités que sur leurs produits.
Cette histoire vise à éviter deux sortes de polarisation usuelles dans ce genre d’étude. La première est l’accent mis sur de grandes figures d’écrivains et de philosophes qui ont tendance à occuper (ou à paraître occuper) tout le terrain à une époque et à donner, par une sorte de culte de la personnalité intellectuelle, le ton à toute une génération (Hugo ou Barrès, Renan ou Bergson, Gide ou Valéry, Sartre ou Camus, Foucault ou Lévi-Strauss, etc.). La seconde est la description des courants identifiés par des « -ismes » souvent tellement généraux qu’ils ne désignent plus grand-chose (« réalisme », « naturalisme », « surréalisme », «marxisme », « existentialisme », « structuralisme », etc.). Les auteurs recherchent à la fois un grain plus fin de description socio-historique et une vision plus synoptique, ne portant pas seulement sur des individus supposés représentatifs d’un Zeitgeist, ou d’un courant, mais sur des ensembles plus vastes, à la fois dans le temps – sur une durée de deux siècles – et dans l’espace – en confrontant la culture française à ses voisines, et en étudiant la réception des œuvres européennes et extra-européennes au sein de l’espace culturel français.
L’autre objectif, qui distingue fortement cette entreprise de celle de livres déclinistes ou grognons, est sa tentative pour écarter d’entrée de jeu les jugements de valeur : la vie intellectuelle de telle ou telle époque est-elle plus riche et plus active que celle des autres époques, meilleure ou pire ? Comme le font remarquer Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, il est presque constitutif des histoires de la vie intellectuelle depuis au moins un siècle qu’elles identifient un âge d’or qui aurait été perdu, soit que les clercs aient « trahi » en faisant tomber la mystique dans la politique, en perdant leur magistère sur une génération, soit que l’exercice de l’intellect ait été capturé par une classe particulière, comme la « République des professeurs » (Thibaudet), ou encore en prenant un tournant réactionnaire par un « rappel à l’ordre » (Lindenberg). On ne peut pas parler des intellectuels sans que les magazines se lamentent régulièrement qu’on ait perdu « les grandes figures » ou les « géants » qui incarnaient le royaume des idées, qu’il n’y ait plus de Sartre, de Malraux ou de Lévi-Strauss pour porter le flambeau de la Culture Française, ou inversement qu’ils cocoricotent que tel ou tel de nos maîtres à penser se vend bien à l’étranger, témoignant de la permanence du prestige de notre Grande Nation. Ces rhétoriques du déclin ou de la grandeur retrouvée participent des mythologies auxquelles entendent résister les auteurs du volume, en essayant de montrer que les créations intellectuelles sont largement collectives, que les progrès ne sont pas nécessairement là où l’on croit, et qu’ils ne sont pas nécessairement le fait d’individus ou de courants dominants, mais souvent le produit de mutations et de glissements lents qui impliquent aussi des influences venues hors de l’hexagone.
Cette tentative pour introduire la longue durée au sein de l’histoire intellectuelle, qui était déjà la marque des importants travaux antérieurs de Christophe Charle [1], et pour changer les catégories d’analyse ordinaires est très bien venue. Elle se traduit par des découpages inédits. Tout d’abord au plan temporel, en ne considérant pas exclusivement la période qui suit l’Affaire Dreyfus, souvent tenue comme l’avènement de la classe des « intellectuels », mais en plongeant plus en arrière jusqu’à la fin de la Révolution et de l’Empire puis en allant de la Première Guerre mondiale à 1962, pour considérer finalement les cinquante dernières années. Chaque volume est introduit par une synthèse des directeurs. Ensuite chaque partie temporelle est articulée autour de quatre divisions elles-mêmes introduites par un maître d’œuvre: les « espaces publics » portant sur les conditions générales de l’exercice des activités intellectuelles et leurs supports (presse, édition, enseignement), les « savoirs et idées politiques » analysant les interactions entre les idées et les courants politiques d’une période, « esthétiques », analysant les devenirs de la création artistique, et les « échanges », portant sur les relations entre les idées en France et les autres pays ou continents.

Christophe Charle et Laurent Jeanpierre © Emmanuelle Marchadour
Il est évidemment impossible de mentionner plus que quelques auteurs. La plupart viennent de l’histoire, de la sociologie, des sciences politiques, et sont des spécialistes de leur domaine. Il y a des synthèses éclairantes (comme celle de Gisèle Sapiro qui porte sur la liberté intellectuelle des écrivains et des savants, celle d’Alain Vaillant sur le romantisme, celle de Françoise Balibar sur la République des savants, celle d’Enzo Traverso sur les idées politiques entre 1914 et 1962), mais aussi quantité d’articles portant sur des thèmes particuliers, qui sont quelquefois très courts (les livres les plus lus dans les premières décennies du XIXe siècle, la rhétorique au collège, le rire moderne, les catholiques, Rome et la vie intellectuelle française, la querelle de la nouvelle Sorbonne, etc.) ou sur des figures particulières (Germaine de Staël, la postérité de L’essai sur le don, Céline, Lyssenko, Genet, etc). Mais de manière intéressante, s’il y a des articles sur Taine et Renan, sur Bergson, Durkheim et Jaurès, il n’y en a pas de spécifique sur Barrès, sur Anatole France ni sur Sartre, Foucault, Camus ou Malraux, bien qu’il y ait divers articles sur les intellectuels après 1968 et les aléas du marxisme, comme ceux de Ludivine Bantigny ou de Razmig Keucheyan. Il est également intéressant de constater que l’article sur l’affaire Dreyfus et les intellectuels n’a que 6 pages. La littérature et la philosophie sont présentes, mais il y a des articles sur la musique, les musées, les penseurs face au cinéma, et un grand nombre d’articles sur l’édition, la presse, l’enseignement, les universités, la circulation des idées, avec le souci de ne pas reproduire ce que l’on peut trouver ailleurs. Le caractère collectif de l’entreprise donne à l’ensemble une structure globale plus kaléidoscopique que panoramique, bien qu’il y ait aussi une très forte unité.
Mais laquelle ? Ce n’est certainement pas celle que l’on trouverait dans des livres écrits sur la base d’une conception particulière de la culture française, comme les cinq volumes de L’histoire des passions françaises de Theodore Zeldin, ou le plus récent Ce pays qui aime les idées de Sudhir Hazareesingh, qui contemplent les Français avec toute la condescendance amusée dont les historiens anglophones sont capables [2], ou même les monographies sur des auteurs et des périodes particulières. Mais la question se pose, en refermant ces remarquables ouvrages collectifs, de savoir ce qu’est la vie intellectuelle qu’ils décrivent sur une si longue durée et dans un cadre en principe hexagonal. Malgré les mises au point de Christophe Charle et Laurent Jeanpierre au début et à la fin de leur entreprise, il n’y a pas de définition explicite. Il peut y avoir au moins deux conceptions assez différentes de la vie intellectuelle. La première est celle que l’on pourrait appeler minimaliste : la vie intellectuelle est l’ensemble des activités au sein d’une société qui relèvent des activités et productions de ce qu’on nomme au sens large la culture, par opposition à la civilisation matérielle et économique: sciences, savoirs, arts, littérature, philosophie, religion, idées, controverses, sans établir de hiérarchies entre ces formes d’expression de l’intelligence et de la sensibilité humaines. La seconde conception, qu’on pourrait appeler maximaliste, entend par « vie intellectuelle » les formes supposées supérieures des productions du domaine des idées, ainsi que leurs incarnations dans des courants politiques, philosophiques, littéraires, religieux et artistiques identifiés. Pour user d’un vocabulaire devenu désuet, on peut dire que ce que la conception maximaliste vise est la « vie de l’esprit » d’une époque. « Esprit » est devenu désuet parce que ce terme fait à présent référence au « spirituel » et à la religion, mais aussi à quelque incarnation hégélienne du Concept dans l’Esprit du temps.
Entre les deux guerres en France eut lieu une discussion multiforme, dont il est question à divers endroits dans ces livres, sur « le règne de l’esprit », mettant en jeu des auteurs aussi variés que Valéry, Benda, Maritain, Rolland, Duhamel ou Mounier, qui portait à la fois sur la perte du sens de ce que l’on jugeait comme la faillite de la civilisation européenne après la Première Guerre et la nécessité de remettre en avant la « primauté du spirituel ». Mais il n’est pas nécessaire d’entendre « esprit » au sens spiritualiste, voire religieux, pour user de cette catégorie. Il suffit d’admettre qu’il y a un certaine nombre de productions des cerveaux humains et des sociétés qui déterminent des ensembles relativement objectifs et cohérents que l’on appelle des idées, des représentations, des conceptions, et que ces ensembles aient leur force propre et leurs règles. C’est ce que j’appellerai la conception laïque de l’esprit. Il est assez clair que les auteurs de La vie intellectuelle en France ne sont pas des partisans de la conception maximaliste au sens du « spirituel », et je crois que beaucoup souscrivent à la conception laïque. Mais beaucoup sont plus proches de la conception minimaliste. On peut se demander aussi s’ils ne sont pas ultraminimalistes, en finissant à certains moments par réduire la vie intellectuelle à ses substrats. Dans leur souci de mettre avant tout l’accent sur les conditions matérielles, sociales, politiques, institutionnelles, juridiques, de la vie intellectuelle, un certain nombre d’essais de ces volumes donnent parfois l’impression que le contenu même des représentations, des idées, des doctrines importe moins, voire même disparaît face aux usages qu’on en fait, aux forces qui s’en emparent et en font des armes pour les combats historiques.
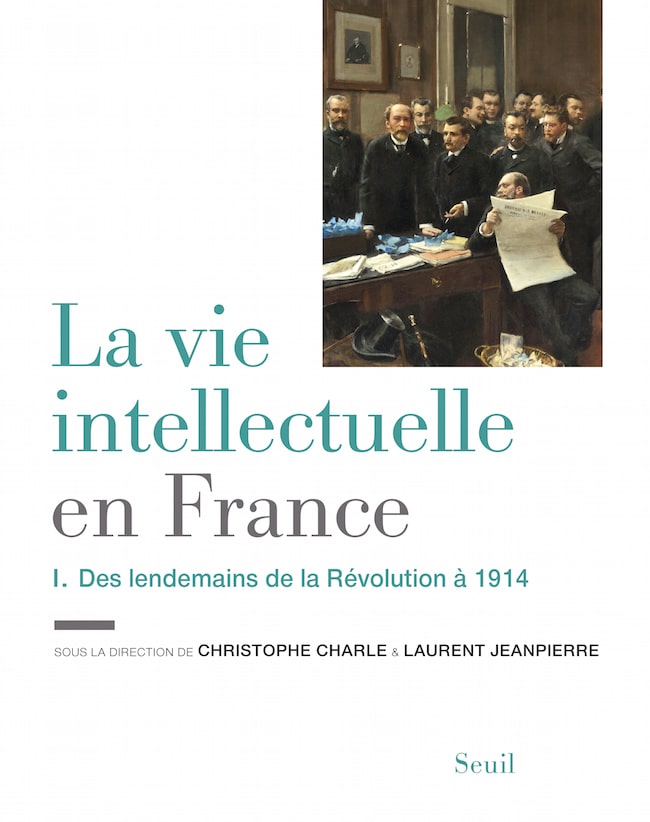
On a quelquefois l’impression, face à cette masse d’informations, de statistiques, de données sur la presse, l’édition, la sociologie et la politique qui sous-tend la vie intellectuelle française, de se trouver dans la même situation que ce visiteur d’Oxford dont parle Gilbert Ryle dans The Concept of Mind, qui, après avoir parcouru les collèges, les halls, et les bibliothèques de la ville universitaire, demande à son guide : « Oui, j’ai vu tous ces bâtiments. Mais à présent dites-moi où est l’université ? » Je gage que si l’on demandait à Christophe Charle, Laurent Jeanpierre et à leurs collaborateurs : « J’ai vu toutes ces manifestations de vie intellectuelle sur deux siècles, mais où est la vie intellectuelle ? » la question leur paraîtrait tout aussi déplacée, et encore plus si la question était : « Où est l’esprit ? » Leur réponse serait évidemment : « Mais la vie intellectuelle, c’est cela, cet ensemble de dispositifs, de dispositions, et de manifestations historiques, ce n’est pas quelque chose qui vient s’y ajouter, comme quelque vent spirituel subtil, ou quelque abstraction qu’on appellerait “idées” ou “intellect”, et qui subirait les diastoles et les systoles du cœur mental d’une nation. » Ils insisteraient sur la nécessité de cesser de voir l’Esprit de la France flotter au-dessus d’elle comme le nuage de Tchernobyl, pour examiner des mouvements plus lents, plus microscopiques, mais cumulatifs, qui s’étendent bien au-delà des oppositions traditionnelles dont use l’histoire traditionnelle et les représentations mythologiques des productions de l’esprit : droite/gauche, religion/laïcité, Lumières/ antilumières, moderne / anti-moderne. Ils entendent voir la vie intellectuelle à une autre échelle, notamment en examinant les liens entre la France et l’Europe, en l’examinant à la fois dans ses devenirs et dans son extension à tous les secteurs de la culture, qui ne sont pas nécessairement les plus « nobles » (par exemple lire l’article de Philippe Darriulat sur la chanson et le peuple).
Je ne suis pas sûr que cette réponse minimaliste serait la leur, mais, si elle l’était, on pourrait se poser quelques questions – au demeurant assez classiques et propres à toute réflexion sur l’histoire des idées et des doctrines – auxquelles ces volumes ne s’adressent pas, ou pas assez. La première est celle de savoir quelles sont les limites de la vie intellectuelle. Toute vie intellectuelle n’est pas nécessairement sociale, même si elle a besoin de conditions sociales pour vivre. Un mathématicien solitaire compte-t-il comme un participant de la vie intellectuelle ? Oui, sans doute, car il lui faut bien passer par des écoles, des revues, des associations. Mais sa production même, ses théorèmes, comment en parler dans un cadre social ? Le volume II contient un excellent court essai de Françoise Balibar sur les mathématiciens du groupe Bourbaki, mais très peu est dit ailleurs sur l’empire des mathématiques sur l’éducation et le savoir français, les différentes écoles, et l’éminence de ce pays dans ce domaine qui représente « l’honneur de l’esprit humain ». La seconde question est celle de savoir jusqu’à quel point on peut faire une histoire de la vie intellectuelle en insistant sur ses bases matérielles et institutionnelles sans spécifier quels sont les contenus mêmes des idées qui donnent lieu aux conflits, controverses, voire aux guerres.
Par exemple, dans le premier volume, un excellent article glorifie la science au XIXe siècle, et d’autres essais son rôle social, mais, quand il est question d’Auguste Comte, on a très peu d’exposés des conceptions positivistes elles-mêmes. Il y a un bon article sur le rôle de la pensée allemande chez les philosophes français, mais l’article sur l’anglomanie et l’anglophobie en France ne mentionne ni l’importance de l’école écossaise pour les idéologues, ni de celle de Stuart Mill pour Taine ou pour les libéraux français. Il y a bien des mentions de Bergson, de ses succès mondains et de son anti-scientisme, mais une histoire intellectuelle aurait pu mentionner le rôle qu’il joua dans l’introduction de la pensée évolutionniste et dans la tentative de réconciliation entre sciences et religion. La Trahison des clercs de Benda est mentionnée à plusieurs reprises comme exemple d’essai best-seller, et on dit bien qu’il a critiqué ses pairs en intellect, mais à aucun moment le contenu de ses thèses n’est évoqué, et tout ce qu’on voit dans le succès de son livre est « l’efficacité d’une mise en scène » (Vol II, p.41).
Parmi de nombreux autres exemples qui montrent que la sociologie aurait tout autant intérêt à discuter le contenu des idées plutôt que seulement le rôle des « champs » , des « stratégies », du « marché » et de « l’offre intellectuelle», il y a celui de l’article – l’un des rares portant sur la philosophie – sur « la philosophie américaine en France » : le moins que l’on puisse dire est que ses auteurs en ont une idée assez limitée, oubliant que la philosophie analytique, avant d’être devenue américaine, était une philosophie européenne et anglaise, et que sa branche américaine est loin de se limiter au pragmatisme, dont ils ont une vision elle-même rudimentaire. À force de n’examiner que les effets de réception des œuvres sans s’intéresser à ce qu’elles disent, on finit par faire le type d’histoire journalistique qu’on voulait éviter. Il était tout à fait justifié de cesser de mettre des disciplines comme la philosophie au centre du champ intellectuel dans cette histoire, mais il y a des moments où celle-ci se venge.
Une partie de ces difficultés vient du fait qu’il est impossible de discuter de la vie intellectuelle sans, à un moment quelconque, l’évaluer, juger si elle est bonne ou mauvaise, féconde ou pauvre, digne ou indigne de ce qu’on est en droit d’attendre de ce que je crois que, en dépit de toutes les réserves que l’on peut faire sur ce terme, on peut appeler la vie de l’esprit (au sens laïc évoqué). On comprend très bien le souci des directeurs de ces volumes de cesser d’adopter la posture des panégyriques, voire des hit-parades de la vie des idées, pour examiner plutôt sa tectonique des plaques. Mais pratiquer une totale abstinence axiologique et ne pas vouloir répondre aux questions lancinantes: « La vie intellectuelle en France aujourd’hui vaut-elle encore la peine d’être vécue ? Est-elle “tiède”, voire inexistante ? », c’est un peu comme si l’on voulait faire une histoire des armées françaises en faisant abstraction du fait que ces armées ont peut-être gagné pas mal de batailles et même de guerres, mais en ont perdu quasiment autant. En fait, contrairement à leur vœu, les auteurs de ces livres, dans tous les domaines – politique, art, littérature – émettent des jugements, et les suscitent, volontairement ou non, chez leurs lecteurs.
On devrait, par exemple, adopter un regard froid d’historien et de sociologue, et simplement constater, sans juger, que la psychanalyse a joué en France un rôle considérable – moindre aujourd’hui – ou que l’un des principaux titres de gloire des Français est d’avoir exporté des penseurs (même au Japon, comme nous l’explique un des articles) tels que Lacan, Badiou ou les auteurs de ce que l’on appelle la « French Theory ». Mais peut-on se dispenser de juger, et ne faut-il pas constater, comme le laisse entendre à demi-mot Laurent Jeanpierre dans l’article qu’il consacre au « post-modernisme », que ce ne sont peut-être pas les productions les plus glorieuses de la vie intellectuelle de ces deux siècles passés, en dépit de leur immense succès ? Est-ce un signe de santé intellectuelle, pour prendre un autre exemple, que la question du nazisme de Heidegger soit depuis plus de vingt ans une obsession de la « scène intellectuelle » en France ? Que, comme le documentent d’excellents essais du volume II, une bonne partie de cette vie se polarise autour d’une « lutte croissante pour l’attention médiatique » et pour la « visibilité intellectuelle » ? Dans l’esprit aussi il y a un degré zéro.

La dernière partie du second volume pose régulièrement la question du « rayonnement déclinant » (Thomas Brisson) de la culture française, dû à de multiples causes (perte de l’empire colonial, de l’influence des institutions francophones, des universités françaises, mondialisation) mais livre un bilan nuancé (la France n’a pas perdu toute influence). Mais au-delà de ces critères économico-politiques, ce qui manque, pour pouvoir porter ces jugements nécessaires, c’est une sorte de criterium de la vie intellectuelle. Se limite-t-elle au fait que telles ou telles œuvres, tels ou tels courants, telles ou telles institutions, tels ou tels groupes, sont au centre des discussions et des querelles, que tels livres sont très lus et pas d’autres ? Ces données sont des conditions du jugement, mais elles ne sont pas suffisantes, ni n’épuisent les ressources pour fournir nos jugements.
Charle évoque dans sa conclusion l’étalon de la créativité et de l’effervescence que certaines époques favorisent plus que d’autres. Je mettrais pour ma part au premier plan la capacité pour une culture de se livrer à la critique, c’est-à-dire non seulement de la produire, mais aussi de la tolérer et de construire quelque chose de nouveau à partir d’elle (c’est pourquoi des courant hypercritiques, comme la « pensée 68 » ou le « post-modernisme » sont d’entrée de jeu décevants). Qu’il n’y ait quasiment plus de grandes controverses dans le monde des idées, qu’on ne sache plus ce qu’est un argument en bonne et due forme, que toute critique, y compris d’un livre, passe immédiatement pour de la polémique et qu’on attende systématiquement qu’on vous passe de la brosse à reluire, sont des faits qui indiquent que notre culture a perdu son assise. Un autre critère serait celui de la clarté, la capacité à articuler ses idées. Si l’on lit un grand nombre de productions intellectuelles des cinquante dernières années, dans tous les domaines, on constatera, si on les compare à celles de la fin du XIXe siècle, combien elles sont confuses. On peut regretter que n’ait pas été plus suivi le conseil de Monseigneur Dupanloup : « Je demande qu’un professeur de rhétorique enseigne bien moins les tropes et les figures que la rédaction claire, intelligente, vraie, sincère, expressive, énergique de la pensée » (I ; p.122). C’est un comble que ce soit l’un des représentants de la pensée réactionnaire qui nous rappelle de telles évidences.
Si l’on compare la vie de l’esprit – n’ayons finalement pas peur de ce mot – en ce début de XXIe siècle avec celle qui eut lieu en d’autres siècles et celle qui a lieu dans d’autres pays aujourd’hui, on doit bien souscrire au jugement de Goethe cité par Christophe Charle dans son texte final : « Les Français peuvent faire tout ce qu’ils veulent, ils n’auront jamais un second XVIIIe siècle ». Ni un second XIXe siècle.
-
Voir notamment Naissance des « intellectuels » (1880-1900), Minuit, 1990, Paris fin de siècle, culture et politique, Seuil, 1998, Le Siècle de la presse (1830-1939), Seuil, 2004.
-
History of French Passions, 1977, tr. fr. Seuil 1980 ; Flammarion 2015.








![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)