Su Tong, depuis le succès d’Épouses et concubines en 1992, a été abondamment traduit en français. Il a cinquante-trois ans et Le dit du loriot, dont le titre, emprunté à un proverbe signifiant à peu près « tel est pris qui croyait prendre », semble introduire un conte plutôt qu’un roman, date de 2013.
Su Tong, Le dit du loriot. Trad. du chinois par François Sastourné. Seuil, 366 p., 22 €
En réalité, le texte de Su Tong se présente comme la chronique romanesque du quartier le plus pauvre d’une ville moyenne. L’extrême précision de la peinture des lieux, l’acuité de l’analyse psychologique des nombreux personnages, indiquent peut-être une proximité biographique entre l’auteur et le microcosme qu’il décrit. On a donc affaire, en première analyse, à l’évocation réaliste, vive et documentée, d’un coin de la Chine à partir des années 1980, soit quatre ans après la mort du Grand Timonier, quinze après le lancement de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne et son cortège de crimes et de malheurs.
Désormais, le pays va se convertir très progressivement à l’économie de marché, mais en tout cas les vieux slogans ne sont plus qu’images déchirées sur les murs et la nouvelle idéologie celle de l’argent vite gagné, honnêtement ou non peu importe.
De l’argent, personne n’en a vraiment dans ce district sordide de la rue des Cédrèles où les bicoques exiguës abritent plusieurs générations dans un climat de haine familiale recuite, mais tout le monde en rêve. Il suffit que le grand-père devenu fou qui se met à creuser fébrilement pour retrouver son âme perdue mentionne un ancien trésor enfoui pour que la fièvre de l’or saisisse tous ces pauvres gens. Le récit prend alors une tournure de Clochemerle chinois et s’engage dans une direction satirique aimable et plutôt divertissante, tant qu’il reste chez les adultes.
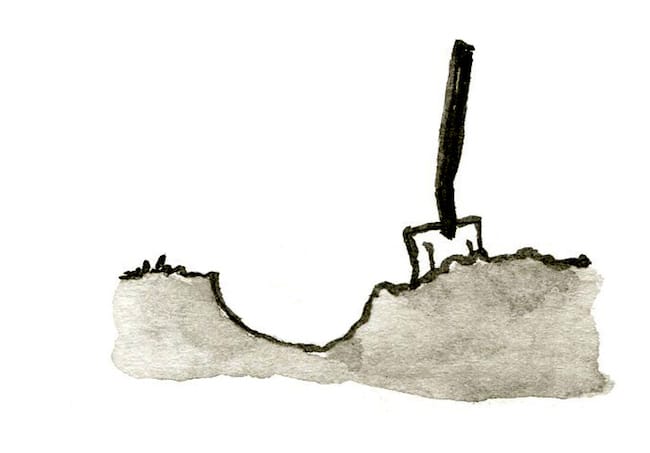
Maud Roditi pour EaN
Ce n’est pourtant qu’un leurre, ou bien une des facettes d’un récit dont le narrateur, qui a adopté d’emblée le point de vue surplombant de l’analyse critique, pince-sans-rire et détachée d’une micro-société à la dérive, voudrait bien rester jusqu’au bout « au-dessus de la mêlée ». Il y parvient du reste en partie, même si la réalité paraît rendre difficile pour lui la posture du sage bienveillant doublé d’un éthologue sagace observant une fourmilière.
Par exemple, l’asile psychiatrique local, plutôt une garderie renforcée pour déments, où la seule solution pour empêcher l’aïeul privé d’âme de forer partout des trous et de dévaster ainsi le domaine laborieusement entretenu par un jardinier misérable consiste à confier à son petit-fils, qui a le don des nœuds, la tâche de ligoter le vieil homme et de le mener en laisse comme un chien : peut-on rire d’une telle horreur ? Su Tong relève le défi et triomphe presque, changeant en scènes drolatiques, tel une sorte de Marcel Aymé chinois (le Marcel Aymé de « La traversée de Paris »), des situations intolérables.

Maud Roditi pour EaN
Cette assurance dans la traduction adoucie des effets de la misère en milieu urbain, qui induit du côté du lecteur une forme de jubilation mêlée de gêne, se met à flancher dès que les jeunes générations passent au premier plan du théâtre fictionnel. Voici trois piètres héros de cette rue d’abord presque joyeuse qui peu à peu s’assombrit. Un trio classique : deux garçons et une fille, les petits mâles d’abord complices puis devenus rivaux en présence de la demoiselle. Le premier est un balourd et un loubard, un quasi-demeuré, c’est lui l’expert en cordes qui ficelle son grand-père, sans méchanceté d’ailleurs, par devoir filial (ah ! ces vertus confucéennes, sur lesquelles le maoïsme prédateur s’était tant appuyé et qui ressurgissent, simplistes et intactes, dès que l’Ogre au livre et aux mains rouges s’est effacé).
L’autre, un beau gosse d’une famille aisée (dans le contexte : son père est boucher), n’a aucune ossature intérieure et glisse naturellement au crime redoublé : il viole la jeune fille puis, soutenu par sa famille et quelques pots de vin, fait endosser le forfait à son benêt de copain qui, incapable de se défendre, croupira quelques années en prison à sa place.
Elle, manifestement c’est à elle que le narrateur réserve l’attention la plus soutenue. D’une beauté éclatante, laissant derrière sa démarche gracieuse un parfum enivrant, orpheline élevée par le jardinier de l’asile et sa femme, son caractère est de loin le plus complexe et le plus fouillé des trois. A-t-elle dès le début un tempérament de garce, d’aguicheuse sûre de ses charmes, a-t-elle un cœur aussi sec que son comportement méprisant, calculateur et rancunier le laisserait supposer ? Le narrateur et, lui emboîtant le pas, le lecteur, s’ils suivent paresseusement cette pente, croiront, comme tant de témoins stupides des malheurs arrivés aux femmes, qu’elle l’a bien cherché. Mais n’est-elle pas d’abord une enfant meurtrie, dont tout le trésor consiste en deux lapins en cage qu’elle chérit et que le beau gosse lui tuera par perversité pure, avant de la violer ?

Maud Roditi pour EaN
Tout l’enchaînement d’un mélodrame qui enfonce une à une trois jeunes destinées dans les ténèbres (l’ex-prisonnier finira par poignarder le bellâtre ; enceinte d’une liaison avec un riche Taïwanais, la radieuse séductrice flottera comme une bête crevée au fil de la rivière qui traverse le quartier et se noiera sans susciter la moindre réaction des habitants qui l’observent : les scénarios des films japonais ou chinois nous ont habitués à ces dénouements peut-être pas si excessifs), cette accumulation de désastres prouve que, si l’intrigue du livre est attendue, son message implicite en permet une lecture politique peu réconfortante.
Car le message – heureusement non dit – est sombre. La communauté des Cédrèles n’a rien de factice. Elle repose sur un vieux fonds paysan de croyances irrationnelles, de pratiques magiques, de préjugés et – n’ayons pas peur des mots – de bruyantes sottises, qui a peut-être bien permis à la Chine crucifiée par tant d’empereurs abjects de persévérer des milliers d’années dans son être souffrant. Mais, faute d’une volonté collective réellement démocratique, ce chacun pour soi de survie dans l’asservissement de tous se révèle bien incapable d’une compassion active à l’égard de ses membres les plus fragiles. Exception : la famille restreinte, qui aide parfois pour le meilleur ou pour le pire (souvent, comme ici, afin de « sauver la face »). En dehors d’elle, point de salut.
Parmi les légions de laissés-pour-compte que cette société inégalitaire maintient sur ses marges, aucun n’est plus à plaindre que le sujet féminin auquel, si la beauté s’en mêle, seul le sort de nos prostituées du XIXe siècle semble susceptible d’échoir aujourd’hui encore. Cela, cette réalité tangible, le mélo dépourvu de pathos de Su Tong le montre par un traitement du réalisme cru dont le charme réside néanmoins dans l’indécidabilité entre romanesque du miroir promené le long d’une route et poésie de la légende, et n’en est que plus puissant.
On préférera cette lucidité amère à la complaisance d’un Mo Yan envers l’image, subversive en apparence, d’une Chine éternelle qui attend toujours en vain la vraie révolution, celle des mœurs.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)










