Jacques Yonnet, résistant, journaliste, dessinateur et romancier s’illustra d’abord, surtout, comme un Parisien. Né en 1915 aux Halles, dans le ventre de la capitale, cet homme en fut l’un des plus profonds connaisseurs. Il reste célèbre pour l’inoubliable Rue des maléfices où le quotidien d’un réseau sous l’Occupation se mêlait à toutes sortes de mythes et légendes locales. Paru en 1947, cet hapax littéraire mérite mille fois d’être (re)lu. Il ne doit cependant pas détourner l’attention de Troquets de Paris.
Jacques Yonnet, Troquets de Paris. Éditions L’Échappée, coll. « Lampe Tempête », 368 p., 22 €.
En effet, cette sélection d’articles publiés entre 1961 et 1972 dans la feuille L’Auvergnat de Paris vaut largement le détour. À première vue, un mélange rabelaisien de critiques sur les bistrots et restaurants des années 1950-1970. Le tout entrecoupé d’anecdotes historiques. L’érudition ne le cède jamais à l’empathie et la conversation se fait familière mais avec style toujours. On craint une lecture nostalgique et l’on se retrouve sidéré par la force d’évocation de ce monde tantôt populaire et trivial, tantôt d’une surnaturelle étrangeté. Alors, un recueil de critiques gastronomiques ? Non, un récit de voyage dans un continent englouti.
Jacques Yonnet nous parle d’un temps où se trouvait encore place Maubert un « marché aux mégots » tenu par les clochards locaux. Ils côtoyaient « au pied de la statue d’Étienne Dolet une famille (une tribu plutôt) de Gitans ». Autour de la place, des mystiques erraient. Beaucoup de Russes (des princesses déchues, ou qui disaient l’être). Partout, une faune ouvrière et volontiers anarchisante qui hantait des ruelles mal famées. À l’époque, « ce quartier était encore imprégné des brumes subtiles du Moyen-Âge »… Quiconque connaît le Ve arrondissement d’aujourd’hui mesure la bizarrerie d’une telle description. Chez Yonnet, tout est affaire de climat.

Plan du Quartier latin
Soucieux de rendre sensible cet aspect, l’éditeur Jacques Baujard a rassemblé les articles par quartiers : on se promène donc en bonne compagnie de la Cité à la Bourse, puis vers l’actuel XIe, le Quartier latin, etc. Dans cette cartographie, pas d’autre trésor à trouver que Paris lui-même. Cette approche joueuse montre que Yonnet sentait son territoire et en décelait les frontières invisibles. Un tel découpage se défend, même si une progression chronologique aurait fait apparaître l’évolution inéluctable de la ville au tournant des années 1960. Mettons ce refus sur le compte de l’optimisme souriant de l’éditeur !
Plus de dix ans d’écriture, des bistrots fort éloignés les uns des autres… L’ensemble paraîtrait disparate mais sa faconde le fait tenir droit. Esquissant le portrait d’un « bougnat », Yonnet sait être concis : « Auguste Bazetoux : une présence, un sourire, une poignée de main, un juliénas. » Mais évoque-t-il la rue Mouffetard, son marché et ses soixante-quatorze bistrots, et voici des phrases qui fourmillent, enflent et éclatent enfin comme un orage d’août en des descriptions hallucinées. Parfois, plus rarement, l’auteur s’autorise une note sur le parler parisien de ces décennies 1930-1970 : « Mario, sans en avoir l’air, observe les trois convives (en argot : “les borgnote en lousdé’’). » Que de pudeur dans cette parenthèse révélatrice.
Yonnet aurait pu utiliser cette langue à des fins « littéraires » comme Céline ou Queneau ou pour faire couleur locale comme Audiard. Mais à leur différence, il demeurait lié à cette « infra-ville » et à ses failles interlopes. Après tout, elles le sauvèrent sous l’Occupation. Yonnet manifeste donc un respect mâtiné de fierté que l’on retrouve chez les Roms refusant de dévoiler leur langue aux savants. D’ailleurs, ce chroniqueur détestait les sociologues… Ces récits charment aussi pour ce qu’ils taisent. Souvent, on sent, sous telle vague allusion, l’épaisseur d’un mystère. L’effet en est puissant car il laisse toute sa place à l’imagination et aux fantasmes. En vérité, Yonnet enchante surtout dans ses anecdotes comme lorsqu’il conte cette nuit fantasmagorique dans un bar de la place Dauphine, où une vieille Bretonne prend un singe apprivoisé pour un farfadet. Quel causeur il devait être ! Ses « propos de café du commerce » sembleront filandreux à certains. L’auteur digresse, c’est vrai, et beaucoup. Mais sachant toujours où il va et stylisant (avec sobriété…) il élève au rang d’art la conversation « de bistrot ».
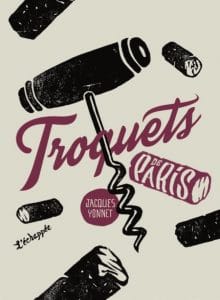 Car des cafés, bien sûr, il est beaucoup question. Espaces de socialisation d’abord, l’auteur les voit chargés d’une mission civilisatrice en mêlant des populations hétérogènes : « Un brassage de gens de toutes classes et de toutes extractions s’accomplit ici dans une ambiance de chaleur humaine que nulle fausse note ne saurait troubler ou profaner. » On relèvera toute la mystique bistrotière trahie par ce verbe. Quant au « brassage » et à la « chaleur humaine », ils caractérisent le bistrot fréquentable. Car plus encore que de la ville, on est ici entretenu d’un tissu humain. Yonnet profite souvent de ses articles pour saluer tel tenancier, rappeler le bon mot d’un client, embrasser la grand-mère d’un autre, au passage, comme ça. Cette plèbe se meut, cause et souffre. Par ses codes, sa fierté et son insoumission, elle touche à l’héroïsme des légendes. Entre l’auteur et ce peuple, il n’y avait pas de frontières. Les articles s’adressaient même aux Parisiens du passé. Parlant de la faune mouffetardienne, l’auteur se prend à saluer « nos potes du fond des âges » ! Les siècles peuvent bien s’empiler, Paris resterait donc égal ?
Car des cafés, bien sûr, il est beaucoup question. Espaces de socialisation d’abord, l’auteur les voit chargés d’une mission civilisatrice en mêlant des populations hétérogènes : « Un brassage de gens de toutes classes et de toutes extractions s’accomplit ici dans une ambiance de chaleur humaine que nulle fausse note ne saurait troubler ou profaner. » On relèvera toute la mystique bistrotière trahie par ce verbe. Quant au « brassage » et à la « chaleur humaine », ils caractérisent le bistrot fréquentable. Car plus encore que de la ville, on est ici entretenu d’un tissu humain. Yonnet profite souvent de ses articles pour saluer tel tenancier, rappeler le bon mot d’un client, embrasser la grand-mère d’un autre, au passage, comme ça. Cette plèbe se meut, cause et souffre. Par ses codes, sa fierté et son insoumission, elle touche à l’héroïsme des légendes. Entre l’auteur et ce peuple, il n’y avait pas de frontières. Les articles s’adressaient même aux Parisiens du passé. Parlant de la faune mouffetardienne, l’auteur se prend à saluer « nos potes du fond des âges » ! Les siècles peuvent bien s’empiler, Paris resterait donc égal ?
En ces temps de gentrification où les centres-villes prennent l’allure de centres commerciaux déguisés en musées, l’écart paraît grand. Le lecteur connaît « l’univers alvéolaire » que Yonnet vit apparaître, horrifié, au début des années 1970. Il disparut suffisamment tôt pour ne jamais le voir. « Nous entendons continuer de vivre dans une ville, une vraie ville, non dans un clapier, une ruche ou une termitière. »
Méfiance néanmoins car en 1964, l’écrivain évoquait déjà « le cher boui-boui à la bonne franquette des autrefois-naguère » ! Lui-même se défiait des passéismes et il aurait peu goûté les discours « déclinistes ». Alors quoi ? Refermant l’ouvrage et dérivant nuitamment dans la ville, on se sent riche de spectres. Tel pan de mur décrit par Yonnet a pris une teinte plus vive. L’esprit bat la campagne. Et soudain, au détour d’une ruelle méconnue, voici le dernier bar encore ouvert. Des rires en sortent. On entre.












