Avec ce troisième roman, Marc Graciano poursuit la trilogie entamée avec Liberté dans la montagne (2013) et Une forêt profonde et bleue (2015). Cette œuvre radicale, exigeante, peut dérouter et même rebuter : Au pays de la fille électrique débute par une scène de viol collectif, racontée in extenso sur vingt-cinq pages. Pour autant, il n’y a là aucune complaisance ; au contraire, la précision de l’écriture tend à représenter l’acte pour ce qu’il est : une violence insoutenable. Et c’est parce qu’il aura pu, dans une certaine mesure, appréhender ce qu’a subi l’héroïne que le lecteur sera à même de ressentir les pages qui suivent à leur juste mesure. Portées par une écriture extrêmement détaillée, elles se chargent d’une intensité exceptionnelle, caractéristique d’un écrivain passionnant.
Marc Graciano, Au pays de la fille électrique. José Corti, 160 p., 19 €
Le début du livre de Marc Graciano est un conte perverti, tordu : une jeune fille à l’allure de « princesse », portant « en office de serre-tête un tube de plastique souple au contenu qui devient électrique et fluorescent quand on le tortille » et qui semble bénie des fées – elle possède jeunesse, beauté, souplesse, talent artistique grâce à la danse, et même argent –, croise la route de quatre hommes qui l’enlèvent à la sortie d’une boîte de nuit et la coincent dans un hangar désert. Nulle explication, nulle justification : on ne saura rien de ces hommes, sinon leurs attitudes face à la jeune fille et leurs apparences désaccordées : un représentant de commerce, un docker, un routard, un sportif. Leur association, leurs motivations restent un mystère. On peut les voir comme quatre variations sur le thème du beauf ou, plus effrayant, comme quatre types ordinaires.
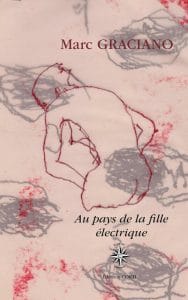 Après les vingt-cinq pages étouffantes du prologue rédigées en une seule longue phrase, tant le personnage de la jeune danseuse porte de charge dramatique, il n’y a presque plus besoin de trame narrative. On suit l’héroïne dans ce qui semble être une errance, une vie précaire, réduite à l’essentiel au fil des routes. En lui déniant toute valeur sociale, les hommes du hangar l’ont réduite à un corps, mais, devenue aphasique, elle va justement exister par ce corps qu’ils lui ont laissé. Ses gestes sont décrits avec une grande précision parce qu’ils sont devenus capitaux : elle conserve sa liberté et sa personnalité grâce à sa souplesse de danseuse. Elle lui permet de se déplacer, d’entrer dans des lieux fermés, et, si ses gestes prennent la forme de rituels, c’est qu’ils le sont vraiment. Ce qu’on pouvait prendre pour la toilette anodine d’une routarde ayant peu d’occasions de se laver prend tout son sens au bout de sept pages quand, en un geste et une ligne, le viol resurgit. Ces longues phrases, ces litanies de « et » et de « puis », au rythme à la fois cadencé et hypnotique, servent à tenir la déréliction à distance, mais créent aussi force et poésie : « puis elle alla se suspendre à l’horizontale entre deux gros rochers près de la berge, et elle procéda en s’appuyant avec le dos et les plantes des pieds sur la paroi de chacun des deux rochers, et c’était une position qui aurait été malcommode pour quiconque mais qu’elle maintint avec facilité, et elle laissa l’air doux la sécher, et elle ferma les yeux et elle laissa les rayons du soleil la réchauffer et la bronzer, et, même, elle s’endormit dans sa position acrobatique, et, à un moment, elle se réveilla brusquement et elle pencha la tête en une attitude d’écoute, comme si elle n’avait pas été seule et que quelqu’un lui parlait, et elle resta ainsi suspendue tant que les rayons du soleil frappèrent de ce côté de la rivière, ce qui dura bien deux heures ».
Après les vingt-cinq pages étouffantes du prologue rédigées en une seule longue phrase, tant le personnage de la jeune danseuse porte de charge dramatique, il n’y a presque plus besoin de trame narrative. On suit l’héroïne dans ce qui semble être une errance, une vie précaire, réduite à l’essentiel au fil des routes. En lui déniant toute valeur sociale, les hommes du hangar l’ont réduite à un corps, mais, devenue aphasique, elle va justement exister par ce corps qu’ils lui ont laissé. Ses gestes sont décrits avec une grande précision parce qu’ils sont devenus capitaux : elle conserve sa liberté et sa personnalité grâce à sa souplesse de danseuse. Elle lui permet de se déplacer, d’entrer dans des lieux fermés, et, si ses gestes prennent la forme de rituels, c’est qu’ils le sont vraiment. Ce qu’on pouvait prendre pour la toilette anodine d’une routarde ayant peu d’occasions de se laver prend tout son sens au bout de sept pages quand, en un geste et une ligne, le viol resurgit. Ces longues phrases, ces litanies de « et » et de « puis », au rythme à la fois cadencé et hypnotique, servent à tenir la déréliction à distance, mais créent aussi force et poésie : « puis elle alla se suspendre à l’horizontale entre deux gros rochers près de la berge, et elle procéda en s’appuyant avec le dos et les plantes des pieds sur la paroi de chacun des deux rochers, et c’était une position qui aurait été malcommode pour quiconque mais qu’elle maintint avec facilité, et elle laissa l’air doux la sécher, et elle ferma les yeux et elle laissa les rayons du soleil la réchauffer et la bronzer, et, même, elle s’endormit dans sa position acrobatique, et, à un moment, elle se réveilla brusquement et elle pencha la tête en une attitude d’écoute, comme si elle n’avait pas été seule et que quelqu’un lui parlait, et elle resta ainsi suspendue tant que les rayons du soleil frappèrent de ce côté de la rivière, ce qui dura bien deux heures ».
Privée de son existence sociale, la jeune fille gagne paradoxalement une liberté qui s’empare du roman tout entier : celui-ci colle au personnage, au gré de sa marche obstinée, dans ses efforts quotidiens pour trouver de quoi manger, dormir et se laver, à travers ses rencontres. Aux franges consuméristes du monde moderne, buvette, « minimarket », « icetea », Snickers et Nutella, se mêle la nature, qui devient un des moyens pour la fille de se reconquérir. Grâce à l’eau sous toutes ses formes – rivière, lac, piscine, étang, source, océan –, aux animaux qui, sans malice ni dissimulation, lui permettent d’établir des relations, et lui tendent un miroir inversé. Quand ils ont peur d’elle, elle a le pouvoir de les rassurer ou au moins de ne pas leur faire de mal, ainsi à cette « bête […] svelte et posséda[nt] un long cou souple » qui lui ressemble et lui offrira une véritable représentation de ce qu’elle a vécu, mais avec une issue plus heureuse : « or il y eut, à ce moment précis, une légère saute de vent et son odeur se trouva dans le vent et frappa en plein dans les narines de la bête incrédule, alors elle vit monter des lueurs de terreur pure dans les yeux de la bête parce que la bête venait de comprendre que l’être en face était bien réel, et la bête éternua bruyamment de surprise, puis la bête fit vers l’arrière un grand bond écartelé et grotesque, comme si quelqu’un l’avait prise par la peau du garrot et l’avait soulevée et enlevée brusquement vers l’arrière, puis la bête fit d’autres bonds gigantesques et, en bondissant spectaculairement, s’éloigna rapidement du lieu de la rencontre et alla au sommet d’une crête et, parvenue en sécurité là-haut, cria avec d’autant plus de véhémence qu’elle s’était laissée idiotement surprendre ».
Les rencontres humaines, si elles sont plus angoissantes, finissent aussi par rassurer la fille et lui permettent de retrouver peu à peu la parole. Elles se font avec des hommes qui ne sont pas si éloignés d’aspect de ceux du hangar mais qui ne sont pas violents : un ancien militaire, un infirmier psychiatrique compatissant et doux, un vigile respectueux, des gendarmes humains. Hors de tout manichéisme, le monde institutionnel n’est ni diabolisé ni idéalisé : les gendarmes ont des attitudes différentes selon les situations, une infirmière compréhensive et apaisante lors de l’arrivée à l’hôpital va se montrer dure quand la jeune fille ne lui obéira pas, tandis que les clichés émaillent aussi le discours de son collègue libertaire. La violence légale, tout en existant, reste mesurée. Simplement, la transcendance n’est pas à chercher du côté du monde social ou des institutions. Elle viendra de la marge et de la nature.

Marc Graciano
De nombreux échos résonnent avec les deux premiers romans de Marc Graciano. Les trois livres peuvent se lire comme une trilogie dans le parcours même des personnages : Liberté dans la montagne se passait sur la route, les protagonistes se dirigeant vers une montagne où se terminait l’action. Une forêt profonde et bleue se déroulait tout entier dans « le haut-pays », alors que le voyage de la fille électrique la conduit de la montagne à l’océan. La structure d’Une forêt profonde et bleue est la même que celle du présent roman : une jeune guerrière subit un viol collectif puis se reconstruit par le contact avec la nature et par une rencontre. Mais là où un seul homme, un médecin lépreux, sauvait la guerrière, dans Au pays de la fille électrique l’héroïne est davantage actrice de sa réappropriation de soi et les adjuvants sont plus diffus. Si certains personnages en rappellent d’autres, ils ne s’équivalent pas. De plus, là où les deux premiers livres se passaient dans un Moyen Âge indéfini, le dernier roman est situé à l’époque contemporaine, ce qui finalement ne change pas grand-chose, tant la vie des personnages errants, en route, est proche d’une période à l’autre.
Le livre prend parfois l’aspect du conte évoqué par le titre, avec son indétermination socio-temporelle, la forte présence des animaux et la curieuse capacité de l’héroïne à les approcher, l’irréalité onirique de certaines scènes, ainsi celle de la « bête » rêveuse, ou quand la jeune fille voyage toute une nuit à la lueur de la lune sur le dos d’une jument. L’arbitraire de certaines rencontres rappelle également l’univers du conte, en particulier celle d’un vieux gitan, sorcier amical et souriant qui met la jeune fille sur la dernière partie de sa route tout en la laissant l’accomplir seule. Cependant, on pense aussi aux romans picaresques et graves de Cormac McCarthy ; certains passages expriment la même poésie, laconique et ample, grande et dévastée, du voyage solitaire : « Le lendemain, elle dormit dans une vieille ruine drapée de lierre un peu à l’écart de la route, et c’était encore un lieu sale avec partout des Kleenex qui avaient servi à moucher quelque chose et aussi les restes de revues porno, et, le surlendemain, elle trouva, au milieu d’un rond-point routier, la réplique miniature d’un paysage local, et c’était un cabanon de planches entouré de trois rangs de vignes et elle dormit dans le cabanon, et, le surlendemain encore, elle dormit sur le vieux ponton de bois d’un étang situé un peu à l’écart de la route ».
Dans la continuité des deux précédents romans, Marc Graciano manifeste dans celui-ci une extrême ambition pour l’écriture romanesque : atteindre à l’intensité par la précision, par la concentration sur les détails. Avec l’idée qu’on peut raconter une histoire palpitante grâce à des gestes, à la manière de se laver, d’entrer par effraction dans un cabanon ou d’allumer une cigarette. Qu’on crée ainsi la présence.












