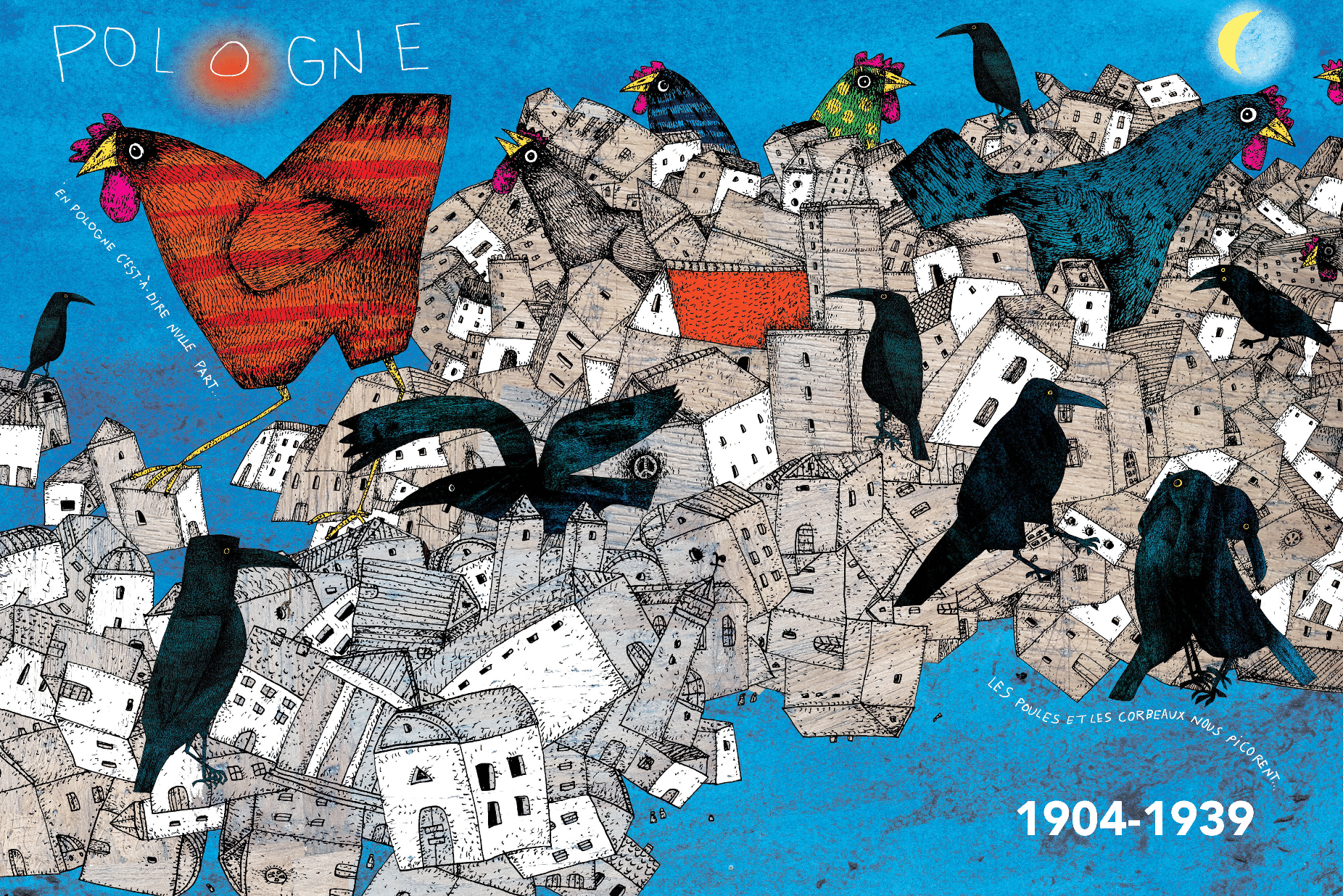Lire Mia Couto est une expérience singulière et radicale : on entre dans un monde où la réalité se recompose tout le temps, car la parole qui la dit s’invente et se modifie sans cesse. L’écrivain mozambicain dont c’est le pseudonyme est biologiste. Le romancier, connu pour La confession de la lionne ou L’accordeur de silences (Métailié, 2015 et 2013), est aussi nouvelliste : les éditions Chandeigne, spécialisées dans la littérature lusophone, publient un recueil demeuré sans traduction française depuis sa parution en 1994, c’est-à-dire dans les premières années d’écriture de Mia Couto et peu de temps après la guerre qui a meurtri le Mozambique.
Mia Couto, Histoires rêvérées. Trad. du portugais (Mozambique) par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Chandeigne, 167 p., 17 €
Dans un avant-propos vibrant, Mia Couto écrit : « Pendant d’incommensurables années, les armes avaient versé le deuil sur le sol du Mozambique. Ces textes ont surgi en moi entre les rives de la douleur et de l’espoir. Après la guerre, je croyais que seules restaient des cendres, décembres sans intériorité. Tout pesant, définitif et sans réparation. » Continuons de le citer : « Durant tout ce temps, la terre a gardé, entières, ses voix. Quand on leur a imposé le silence, elles ont changé de monde. Dans le noir elles sont demeurées lunaires. » Les vingt-six textes qui suivent, souvent de quelques pages concises, ne se rapportent pas directement à la guerre, toujours vue de biais. Dans « Pluie : la rêvérée », qui fait écho à un court roman de Mia Couto intitulé La pluie ébahie (Chandeigne, 2014), l’eau, motif qui parcourt l’ensemble du recueil, réapparaît dans le ciel quand la guerre s’estompe. Les autres occurrences sont rares, mais on lit dans « La pipe de Felizbento » : « La vie s’attelait au temps, les arbres gravissant les hauteurs. Cependant un jour, la guerre débarqua capable de toutes les variétés de la mort. Dès lors tout changea et la vie devint excessivement mortelle. »
Voilà comment Mia Couto dit autrement et donc autre chose. Le conflit entre le gouvernement dirigé par le Front de libération du Mozambique (FRELIMO) et les rebelles de la Résistance nationale du Mozambique (RENAMO), de 1977 à 1992, a l’air bien loin de tout cela. En plus de la guerre d’indépendance qui s’est terminée deux ans auparavant, c’est pourtant bien ce qui a déchiré des êtres, des mémoires, toute une communauté, que le conte semble entreprendre de réunir, au moins symboliquement. Mia Couto, à l’époque, a agi personnellement. En tant que journaliste, en tant que militant du FRELIMO, qui venait de dégager le Mozambique de la tutelle coloniale. Mais, ici, sa réponse aux meurtrissures se trouve dans la recherche d’une langue qui recomposerait ce qu’il nomme les « voix de la terre » et qu’il dissimule dans le récit. Réduites au silence, tapies dans la nature et les foyers, elles sont tout autant des voix d’hommes et de vivants que d’animaux et de plantes, de disparus, d’enfants et d’ancêtres, voix d’un monde invisible qui n’a pas moins de réalité et de valeur que son envers. Il faut entrer dans la terre, la creuser pour les trouver, les extraire de leur gangue de silence pour les transmettre. Chaque nouvelle se déroule dans cet espace d’entre-deux, un lieu indéfini et en cela semblable aux êtres de décalage et de manque qui l’habitent, à l’image de celui de la première nouvelle du recueil, Vovô, qui est « de ceux qui se taisent parce qu’ils savent et de ceux qui parlent même sans rien dire ». Un autre « décrivait ce qui n’existait pas ». Un troisième dit : « Je souffre, finalement, de la maladie de la poésie : je rêve d’endroits où je ne suis jamais allé, je ne crois qu’à ce qu’on ne peut pas prouver. » Vouloir faire entendre ces voix-là, qui ont l’air « ailleurs », est une résistance douce mais pleine de force.

Mia Couto
Traversée de néologismes, d’idiotismes ou de jeux de mots qui rappellent fortement le travail du Brésilien Guimarães Rosa [1], la langue qui dit ces voix a bien sûr des aspects techniques que les traducteurs connaissent mieux. Ils sont en soi un objet de lecture et de rêverie. Mais, en dehors de cela, que se passe-t-il pour qu’on soit à ce point saisi par cette langue, qu’on ait l’impression d’y percevoir une forme de vérité ? Il faut certes parfois faire un choix entre suivre les détails du récit ou bien la suivre, elle, dont les inventions fascinantes ressemblent souvent à de courts miracles et qu’Elisabeth Monteiro Rodrigues fait passer en français avec beauté et attention. Il arrive que les deux soient possibles dans le même geste de lecture, et c’est alors comme un enchantement où tout s’associe, où ces « voix », dissimulées dans la narration, exercent pleinement leur puissance, recouvrent toute la réalité sensible.
L’ambition universelle de ces textes est grande, et elle est réalisée. Blanc et africain, descendant d’Européens et mozambicain, Mia Couto concentre en lui-même les complexités de son pays, où la langue nationale – le portugais – cohabite avec plus de quarante langues bantoues. Ce n’est sans doute pas pour rien que la langue que parlent ses textes maintient un air indécidé. Pour dire les voix de cette terre, il faut une langue qui dise toutes les langues en les intégrant et en les transformant dans un geste poétique, une langue qui ne soit pas uniquement attachée à une œuvre, mais qui soit proprement « mozambicaine ». Pas dans le sens de ce qui limite, enferme ou sépare. En un sens plus profond, plus difficile aussi, mais plus espérant.
-
1 Les nouvelles de João Guimarães Rosa ont paru en 2016 : Mon oncle le jaguar & autres histoires (Chandeigne), dont Hugo Pradelle rend compte dans ce numéro. Lire également Mathieu Dosse, toujours dans ce n°23.