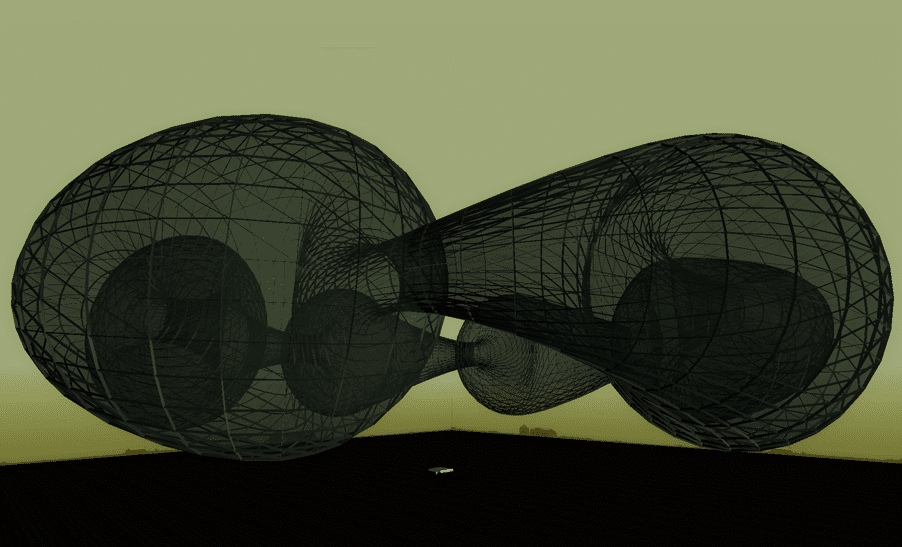Toujours en alternance avec la série Au Palais de justice, nous poursuivons notre réflexion sur « la littérature et le réel » en compagnie, cette fois-ci, du poète Adonis et de la psychanalyste Agnès Benedetti.

Adonis, en 2011
Adonis. Une expérience en Algérie.
Le témoignage d’une psychanalyste.
1. La citation du jour
« Mais que fait le printemps dans cette ville,
Parmi les enfants qui meurent étouffés et brûlés ? »
Adonis, Jérusalem. Traduit par Aymen Hacem, Le Mercure du France, 2016.
2. Le débat
Les lecteurs de ce blog le savent, depuis le début de l’automne, nous leur proposons de réfléchir aux relations qu’entretient la littérature avec le réel. Il ne s’agit pas de redéfinir une littérature engagée au sens où on l’entendait il y a 40 ou 50 ans, mais plus largement et plus modestement à la fois, de relever dans la littérature d’aujourd’hui la manière dont les écrivains voyagent de l’intimité, du repliement qui leur est nécessaire, au monde extérieur. Prends-moi, chaos, dans tes bras, répond le grand poète libanais d’origine syrienne à travers le titre d’un de ses derniers ouvrages paru au Mercure de France en 2015, traduit par Vénus Khoury-Ghata.
Je me souviens l’avoir rencontré pour la première fois lors d’un voyage en Algérie. Nous avions (nous, c’est-à-dire une dizaine de poètes, de langue arabe et française) rendu visite aux étudiants de l’université d’Annaba. Dans le grand hall d’entrée, dont les murs étaient couverts d’affichettes et de textes violemment anti-occidentaux (c’était en 1990), il y avait deux tables où étaient exposés de nombreux livres. L’une était tenue par de jeunes hommes. L’autre, par de jeunes femmes dont la tête et le corps étaient dissimulés, mais le visage était souriant et avenant. Adonis était allé vers elles et leur avait déclaré fermement : « Il ne faut pas lire, ni proposer à la lecture des livres qui commentent le Coran. Il faut proposer le Coran lui-même. » Autrement dit, il ne faut pas se fier aux exégètes, mais accéder soi-même, avec sa propre intelligence, ses propres forces, au texte fondateur.
« Pourquoi le ciel de notre époque ne sait plus lire que le livre du meurtre ?
pour cette raison nous accueillons spontanément les anges de la mort et leur préparons des festins de viande
l’histoire politique et le pouvoir se cachent dans la viande
viande, fête de la victoire et de la conquête
festin des cieux »
(Prends-moi, chaos, dans tes bras)
Cette attitude m’avait beaucoup frappée. Plus tard, dans l’amphithéâtre bondé d’étudiants et d’étudiantes, nous avions pris place sur l’estrade face à eux et avions pris la parole à tour de rôle. J’y étais la seule femme, et j’ai pensé : Il faut que je m’adresse précisément aux jeunes femmes présentes. Mais que leur dire ? Je me sentais incapable, et pas le moins du monde désireuse de leur lire un de mes poèmes, comme devait le faire chacun d’entre nous. Il me semblait en effet que ma poésie était sans relation avec leurs préoccupations à elles, avec leur vie (pas plus pas moins que celle des autres, d’ailleurs). Alors je leur ai dit, paraphrasant le très beau titre d’un film de Satyajit Ray, La Maison et le Monde : « Il faut sortir de vos maisons, et entrer dans le monde ».
Après la séance, les jeunes filles m’ont entourée, mais alors qu’elles voulaient continuer la conversation, elles en furent peu à peu empêchées par de jeunes hommes véhéments. Au bout d’un moment, ce furent eux qui m’entouraient, et avec hostilité.
Cet épisode ne raconte rien que la vérité d’un moment. Le souvenir important que j’en ai conservé est l’incitation d’Adonis à réfléchir par soi-même, et le devoir de sortir de l’aire domestique que je proposais aux jeunes filles.
Marie Étienne

3. La réponse d’une lectrice
Autre immersion dans le réel, autre réflexion sur la nécessité de nommer, mais de nommer autrement, par le moyen de l’écriture et de la littérature. Agnès Benedetti est une psychanalyste qui conduit par ailleurs des « supervisions d’équipe en travail social ».
« Je suis donc, nous écrit-elle, amenée à entendre ce que les professionnels ne peuvent dire nulle part, qui touche non seulement à la clinique du quotidien, avec ses heurts et ses malheurs, mais aussi à la barbarie institutionnelle dans laquelle ils évoluent. Je n’ai pas de mot plus adapté. Notamment en psychiatrie. C’est très difficile pour moi et les collègues qui ont cette pratique de jongler entre technique et éthique, entre soutenir cela, pour soutenir l’espace à penser, rêver, dire, ou claquer la porte. Et il est impératif d’inventer.
L’écriture, dans son versant littéraire et fictif me paraît la voie unique de transmission. Les mots de la psychanalyse sont divisant. Dans l’association que j’ai fondée et que je dirige, j’avance de plus en plus dans ce sillon délicat. En effet, nous sommes dans un milieu qui défend tout de même le concept, la théorie, l’orthodoxie. Il y en a même qui défendent un aspect « scientifique ».
… Mais surtout, je vous envoie un texte que j’ai écrit qui raconte comment entre quelques amis/collègues aimant écrire, nous tentons une transformation des situations cliniques en littérature. Je l’ai intitulé “La clinique c’est de la littérature ”.
Merci pour votre initiative soutenante. »
La clinique, c’est de la littérature
« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Proust, Le temps retrouvé.
« Enfin découverte et éclaircie » : la vie nous serait voilée à nous-mêmes, elle comporterait une opacité. « La seule par conséquent réellement vécue » : en ce sens elle nous est inaccessible, c’est une vie qui ne se vit pas réellement. Cela m’évoque la notion de présence — toujours une angoisse native. Comment en effet appréhender ce qui est, nous qui n’appréhendons le monde des choses que par le filtre de la fiction et du fantasme. C’est donc, dit Proust dans l’absence à la vie et dans le détour par la littérature qu’il y aurait, par la perte d’être, une possibilité de vraie vie, à moins que ce ne soit de vie vraie. « Ces vides à l’aide de quoi le souvenir doit être revécu. » Alors le rêve se dépose comme une texture soyeuse sur la fenêtre d’un réel inaccessible. C’est mieux ainsi, un voile sur le vide.
Nous sommes donc, les psychanalystes lacaniens, orientés vers le rapport de la vérité à la fiction, et de la structure imaginaire qui constitue les fondements de notre subjectivité.
Je vous disais l’autre jour, le 16 novembre 2014, alors que j’intervenais ici même sur la proposition de Joseph Rouzel dans le colloque sur les supervisions, je vous disais que la lacune est le point d’ancrage du récit. Le vif du sujet échappe à l’énonciation, comme la vie échappe à notre capacité de la dévoiler, se heurte au noyau de la résistance, et se trouve satellisé, tournant autour d’un trou noir. Le récit, lui, naît sur l’oubli des choses, cet oubli est selon le poète Bernard Noël « la terre natale ». « Le mot “oubli ” a surgi alors pour désigner la masse obscure dans laquelle me semblait puiser l’écriture. La mémoire n’offre que du déjà vécu, déjà su ; l’oubli révèle de l’inconnu au fond de lui dissimulé. L’exercice de l’écriture, pour peu qu’il soit débarrassé d’intentions, fait surgir et s’exprimer des éclats de l’immense dépôt commun que notre langue recueille depuis toujours. Aucune parole n’est perdue mais toutes sont oubliées en attendant que nous reviennent par l’écriture des parties impersonnelles de ce que nous savons sans le savoir ».
À ce titre le récit porte la trace de sa source, il ne surgit que segmenté, lacunaire, recomposé à l’instar du rêve. C’est pourquoi sûrement il y a toujours eu cette intimité entre psychanalyse et littérature. A l’ère de la transparence et de la surveillance généralisée, et notamment par le biais du numérique qui au contraire laissent trace de chacun de nos signes, par ce qu’on nomme les « données », peinons-nous aujourd’hui à nous constituer un oubli ? C’est une question en soi avec d’autres développements. En tous les cas, l’oubli est une nécessité non seulement pour l’écriture mais pour la pensée et pour la transmission. L’absence d’oubli implique l’absence ou le rétrécissement d’un espace à penser adossé à ce qui se perd du fait qu’on parle. Là encore, question clinique et politique très actuelle qui ferait l’objet d’un travail autonome. L’oubli est cause de la remémoration et de la quête de l’insu.
Donc, dans ACPI, l’association que je préside, nous fabriquons à l’atelier d’écriture de l’oubli de la clinique vécue et racontée, c’est un curieux objectif vous allez dire, penser la clinique comme une fabrique de savoir à condition de l’oublier… Je vais tenter de vous dire simplement comment on s’y prend.
Je vous avais alors raconté au colloque sur les supervisions, comment m’était venue à l’idée la mise en place d’un atelier d’écriture dans un groupe d’analyse de pratiques professionnelles. C’était le chapitre premier de cette histoire en cours, qui se transporte sur d’autres scènes ; avec le souhait d’enfin m’amuser parmi les autres, j’ai souhaité transposer ce dispositif sur la sphère associative. Sauf que voilà, c’est tout autre. Donc même dispositif, mais autre scène, autres protagonistes, et donc un autre jeu.
Le deuxième chapitre se déroule sur l’espace de l’association que j’ai fondé avec une artiste et une agricultrice, sur Arles, Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution, composée d’un collectif de travailleurs sociaux, de psychologues et moi-même qui suis psychanalyste. Un atelier d’écriture à partir de récits issus de la clinique s’est donc mis en place, dans un esprit de type Oulipien, cherchant contraintes et méthodes pour parvenir à une libération et un amusement sérieux, mais aussi un sorte de Banquet, car l’on y boit et l’on y mange. Il se tient pour la deuxième année et chaque séance laisse les protagonistes dans l’étonnement. On pourrait se demander d’ailleurs pourquoi nous en sommes étonnés, puisqu’on commence maintenant à savoir, c’est ainsi à chaque fois. Et bien non, on se redit toujours les mêmes phrases finales qui témoignent du constat d’une clinique native, ne correspondant en rien à l’idée que l’on s’en fait. Ce sont donc des séances au sens analytique ou quelque chose s’actualise, et chacune nous modifie, et plutôt du côté de la joie.
Pour l’atelier d’écriture, j’ai lancé l’idée, l’idée a circulé, et lors de la première séance nous étions neuf, enseignant, psychologues, éducateur spécialisé, formateur, art-thérapeutes, orthophoniste, psychomotricien. J’ai posé quelques jalons de départ, en partie assouplis aujourd’hui : être membre de l’association pour participer, garder le groupe clos pendant l’année avant de le rouvrir. Actuellement le groupe souhaite demeurer ouvert, par cooptation. Pour le reste, j’ai exposé ma méthode, d’autres en ont exposé d’autres, quatre au total, et enfin je n’anime pas les séances.
On a fixé quatre dates dans l’année, des samedis matin, toutes suivies de repas partagé, à chaque fois chez une personne différente qui assure les invitations et garantit le bon déroulement de la séance. Le leadership est donc tournant, assuré par l’hôte du jour. Chaque séance l’an dernier a exploré une méthode. Cette année, le groupe s’est recomposé à quatre vingt pour cent, nous sommes dix, et démarre en privilégiant la méthode que j’avais proposée à savoir : comme en analyse, des pratiques professionnelles.
1ere étape : quelqu’un raconte un récit issu de sa clinique, comme il peut, les autres écoutent puis posent quelques questions concrètes. Ici, il est essentiel de ne pas verser dans l’analyse. Il n’est pas indifférent pour ce dispositif que nous soyons des cliniciens orientés par la psychanalyse, mais nous n’y faisons pas référence. Nous sommes donc au ras des faits, et nous interrompons les questions dès qu’elles versent dans la tentation de comprendre.
2ème étape : On passe là du récit oral vers l’écriture. C’est le premier passage. Chacun écrit son texte à partir de ce récit sans aucune censure si possible, et selon le style qui s’impose. On a une première transformation et une première perte. Après quoi les feuilles sont mélangées entre les participants. Deuxième passage, je perds mon texte, ma feuille est morte, l’autre le prend, un texte va vivre.
3e étape : Chacun lit un texte transmis en silence pour s’approprier l’autre dans ses lignes incertaines. Puis, à tour de rôle, on se lève et on lit à voix haute ce qui devient le texte du lecteur. Troisième passage de la navette dans le métier, le lecteur devient auteur, par son acte de lire.
4e étape : Chaque membre du groupe peut commenter librement, jusqu’à la lecture suivante. Et la navette reprend.
Et là, il se produit quelque chose : on ne sait plus tout à fait de quoi il s’agit, car au fur et à mesure des lectures, une autre histoire est en train de s’écrire, une autre histoire advient, et une suite se crée entre les textes, alors ne me dites pas « c’est l’illusion groupale », une histoire se crée, c’est tout. L’ordre au départ aléatoire des lectures, crée, par le mouvement souple et régulier de notre écoute et de nos paroles partagées, une histoire qui constitue sa chronologie. Je ne peux qu’en attester, après en avoir parlé entre nous tous, nous assistons à chaque séance à cette fabrique-là. Une nouvelle histoire naît, qui n’est plus le récit initialement versé au pot, pas non plus exclusivement les récits écrits, mais la constitution d’un nouveau récit produit par l’architecture des étapes dites.
Cette histoire a de particulier deux points qui sont constants, de séance en séance :
1/ Elle réinvente, réinterprète, reconstitue le récit lacunaire et balbutiant du clinicien, nous dressant un portrait riche et complexe du sujet ou de la situation abordée ; en ce sens, chaque récit mais aussi leur succession et le récit nouveau qui en émerge nous enseigne et enseigne tout particulièrement celui qui parmi nous a lancé son récit. La lacune et l’oubli ont œuvré, nous en reconstituons l’envers, ce travail est un travail du négatif. Nous recevons étonnés un enseignement clinique inattendu à partir de cette nouvelle histoire complexe qui se déploie comportant un éclairage sous des angles multiples. Un sujet nouveau se révèle à nous, se déplie de lectures en lectures. En somme une révélation comme on dirait en photographie.
2/ Les textes produits sont systématiquement littéraires. Généralement beaux, toujours étonnants, avec deux ou trois types littéraires qui reviennent, le récit de fiction, le travail de l’absurde, le maniement de la lettre, la poésie lyrique ou organique. Ce point prouve que les participants sont des cliniciens, quand bien même ils ont volontairement laissé leur boîte à outil compréhensive, analytique et conceptuelle. Chaque participant en effet est un sujet travaillé par son désir, pour lui-même et en temps que professionnel, c’est aussi ce à partir de quoi sont produits de tels textes. Écrits spontanément en moins de trois quart d’heure, ils offrent des variétés de style qui marquent la singularité de chaque écrivant, de chaque écoute, et c’est par ce biais-là exactement, celui du style, qu’apparaît l’enseignement décrit ci-avant. Chaque texte par sa singularité apporte une vérité clinique, interprétant le sujet, manifestant la caisse de résonance que fut l’écoutant et comment il joue sa musique en écrivant. Une interprétation donc mais musicale, pas psychanalytique. Et les textes mis bout à bout forment un récit complexe mais cohérent dans la chronologie.
Ce que nous avons fait c’est nous payer le luxe d’être des cliniciens qui ont abandonné leur outil pendant trois heures quatre samedis par an et ont habillé de fiction les questions posées par le récit de la clinique. Et ce point me tient particulièrement à cœur aujourd’hui où la psychanalyse et la clinique du sujet sont attaqués sur tous les fronts. Je cherche dans ces dispositifs ce qui peut se vivre et se transmettre en dépit des discours, et l’amusement poétique est une piste majeure sur laquelle Lacan avait insisté sur la fin de son enseignement. Mais nous sommes allés plus loin encore. Le récit initial lui-même, nous l’avons décroché de toute notion de professionnalisme, nous avons laissé le vide pour que le savoir issu du souvenir puisse être revécu dans l’acte d’écrire, produisant cet objet nouveau : un récit, non pas seulement qu’il soit une fiction, celui initial en était déjà une, mais un autre récit, et, surtout, décliné non pas dans un style, mais par le style. Pierre Bergougnioux rappelle dans Le style comme expérience que « stulos désigne un ermite qui vivait et priait au sommet d’une colonne, entre ciel et terre. »
Il n’y a rien d’inintelligible là-dedans, on a à l’œuvre le système symbolique qui opère sa fabrique par l’imaginaire de chaque sujet, et par le réel de leur écoute, de leur écrit, de leur lecture. Ce qui est psychanalytique là-dedans, c’est bien cela, cette fabrique-là. Nous sommes tous, dans l’atelier, en séance.
Vous avez sûrement reconnu, dans le récit des étapes, le passage de la navette dans le métier à tisser. Je voudrais vous citer Charles Melman :
« À la naissance de la pensée, il y a deux mille cinq cents ans à peu près, le tissage, l’activité du tissage va être la métaphore maîtresse qui va convenir aussi bien à l’activité poétique qu’à l’union politique et à la relation sexuelle. (…) Le passage de ce fil continu que constitue la trame dans le bâti vertical représenté par la chaîne semble à même de figurer au mieux l’union intime du même et de l’autre et cela dans les trois activités, poétique, politique et sexuelle et je le dis tout de suite pour en donner un avant goût, pour Cicéron, tisser, c’est écrire. »
Si ma petite histoire vous a plu, alors je n’aurai pas travaillé pour rien. Pour bonus utilitariste j’ajouterai qu’outre nous donner de la joie, ce dispositif peut être un outil central pour l’accompagnement des professionnels saturés d’information procédurales et en manque d’oubli, c’est à dire de pensée soutenue en tant que telle.
Janvier 2016
Agnès Benedetti, psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne Internationale, présidente ACPI