Pourquoi qualifie-t-on de « mortes » les langues qui nous servent le plus dans la vie ?
Alain Rey et Gilles Siouffi, De la nécessité du grec et du latin. Flammarion, 192 p., 15 €
Hubert Aupetit, Adeline Desbois-Ientile et Cécilia Suzzoni (dir.), Le bon air latin. Fayard, 360 p., 22 €
Quand j’ai commencé le latin, en cinquième, je ne comprenais rien : l’enseignante chargée de nous y initier ne l’avait pas elle-même étudié. Puis ce fut la quatrième, avec un vrai professeur de latin. Un maître sévère puisqu’il considérait l’emploi du syntagme adjectival « assez satisfaisant » comme une faute très grave (« satis » veut dire « assez »). En troisième, me retrouvant seul en latin, j’ai forcément pas mal travaillé. À la difficulté se mêlait le plaisir. Plaisir, par exemple, de trouver dans le Gaffiot la traduction de tout le membre de phrase qui m’avait fait précisément y chercher tel ou tel mot : exactement le même plaisir que mon père avait éprouvé cinquante ans plus tôt.
Selon Brunetière, cité dans Le bon air latin, le latin ne pourra jamais être pour les Français une langue étrangère. Avant lui, Jean-Jacques Ampère, parlant de la langue française, avait dit : « les mots celtiques y sont restés, les mots germaniques y sont venus, les mots latins n’y sont point restés et n’y sont point venus, ils sont la langue même et la constituent ». C’est pourquoi connaître le latin est le plus sûr moyen de comprendre les mots de notre langue. En lisant « hiémal » ou « vernal », j’ai su qu’on parlait de l’hiver ou du printemps ; en passant devant le bureau « décanal », j’ai subodoré que le doyen n’était pas loin.
Certes, le sens « étymologique » d’un mot ne coïncide pas toujours avec le sens qu’il a aujourd’hui. Qui voudrait absolument s’en tenir au premier (erreur où tombent certains « puristes ») « serait ridicule et ne serait pas compris », comme l’observent Gilles Siouffi et Alain Rey. Prétendre que « formidable », sous prétexte que « formido » signifie « crainte », a davantage le sens de « redoutable » que celui de « merveilleux » n’est pas défendable. Pour de nombreux mots, il y a ainsi deux types de sens : le sens moderne et le sens d’origine.
Le sens ancien n’est donc en rien le « vrai » sens. Mais, avec le latin ou le grec, c’est « comme si on ouvrait un autre tiroir dans l’armoire du langage, comme si on en découvrait un double fond » (Rey et Siouffi). Valère Novarina, dans Le bon air latin, voit lui aussi dans le latin un ouvreur, « qui nous permet de déstabiliser notre langue, par dessous, d’imaginer d’autres courants ou contre-courants : toute une dérive imaginaire et une histoire autre des mots ». Dans le même ouvrage, Cécilia Suzzini remarque que « le rétrécissement sémantique d’un mot se fait au détriment de la charge de vie et d’humanité qu’il doit à son histoire ».
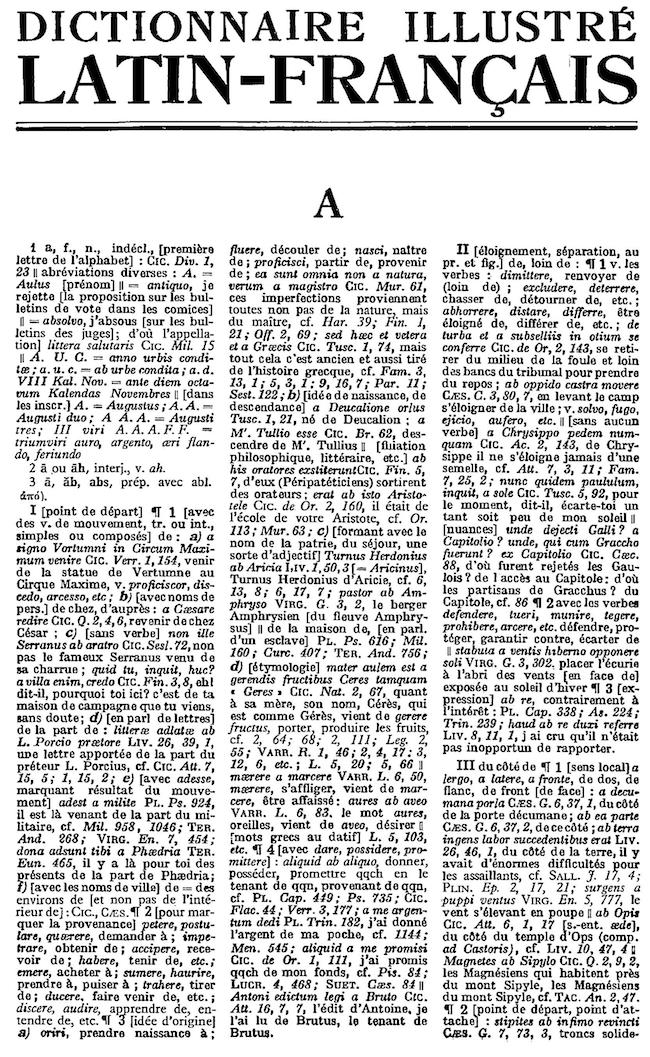
Pour aborder les textes du passé, le latin se révèle parfois indispensable ; sans lui, nous disent Rey et Siouffi, on a l’illusion de comprendre et, en réalité, on multiplie les contresens. Même chose pour le grec : on peut difficilement appréhender l’histoire de la philosophie sans savoir que le mot « philosophia » renvoie d’abord à la science – et non à la sagesse.
Si notre langue est essentiellement latine, le grec y a aussi sa part. En particulier, le nombre de racines grecques utilisées dans la terminologie médicale est considérable. Et c’est en puisant dans les langues « mortes » qu’on forme de nouveaux mots : « Dans les techniques et les sciences, notent Rey et Siouffi, aucune langue vivante ne l’emporte, malgré les apparences. Pas même l’anglais. Les langues-reines, pour nommer le monde, sont le grec et le latin. »
Le français « n’est pas seulement issu du latin par évolution naturelle », rappellent les mêmes auteurs. À partir de la fin du Moyen Âge, on s’est mis à « relatiniser » la langue pour que la source en soit plus claire. Par exemple, le mot latin « fabrica » avait donné « forge » en français ; comme on ne reconnaissait pas le premier dans le second, on a créé « fabrique ». Cette relatinisation est à l’origine de nombreux doublets. Elle a touché également l’orthographe, « pié » devenant « pied », ou « doi » « doigt », pour que leurs ancêtres respectifs (« pedem », « digitum ») ne demeurent pas invisibles. Hubert Aupetit, dans Le bon air latin, cite Chesterton, qui définissait la tradition « comme une extension du droit de vote » à ceux d’entre nous qui sont morts.
Chez les bons élèves du collège, le latin est sans doute la matière qui résiste le plus. Le mathématicien Laurent Lafforgue confie : « Le latin a servi, en particulier, à m’habituer un peu plus à travailler, à m’habituer à fixer mon attention, à m’habituer au fait que les choses ne tombent pas toutes seules. » De la même façon, pour Thomas Pavel, « continuer d’exiger l’étude du latin au collège contribuerait considérablement à l’entraînement de l’attention, tâche essentielle de l’éducation ». Quoi de plus difficile, en effet, et de plus excitant, que de « résoudre » une version latine ?
Plus que le lexique, ce qui dépayse l’apprenti latiniste, c’est la grammaire : comme le soulignent Alain Rey et Gilles Siouffi, la grammaire française s’est beaucoup éloignée de la latine. Le français n’est plus une langue à déclinaisons. Seuls nos pronoms personnels varient encore selon leur fonction : « Elle aimerait que tu lui parles de ce qui la concerne. » Mais l’ambiguïté d’un énoncé comme « tu connais mieux mon fils que moi » est due à l’absence de distinction entre nominatif et accusatif. Les cas du latin ne sont d’ailleurs pas uniquement au service de la logique ; ils permettent une grande variété dans la disposition de mots qu’associent leurs terminaisons, comme dans ce vers de Virgile où le premier mot se rapporte au dernier : « Majoresque cadunt altis de montibus umbrae. »

Que reste-t-il du latin à ceux qui l’ont, un peu ou beaucoup, étudié ? Il reste, pour Jean-Michel Delacomptée, « cette fréquentation où la fonction transitive du langage cultivée par les techniques de communication cède au silence des livres où l’on s’élève vers une saisie lente, où l’irisation des entours compte davantage que ce qu’on empoigne » ; à Jean-Michel Maulpoix, « ce silence qui entoure nos poèmes, ce puits de silencieuse mémoire où continue de s’abreuver leur écriture ». Évoquant l’apprentissage du latin, André Suarès disait : « Une goutte de cette essence, chaque année, à l’âge où l’esprit se forme, avait parfumé la raison pour toujours. »
Il est vrai que cet apprentissage « a constitué pendant des décennies un marqueur social » (Rey et Siouffi). Mon grand-père paternel, agrégé passé par le certificat d’études à une époque où l’enseignement en France était socialement coupé en deux, avait un grand regret dans la vie : ne pas avoir fait de latin. Il avait à la fois une connaissance très précise du français (Suarès exagère lorsqu’il dit : « Qui n’a point fait de latin, ne saura jamais le français que de rencontre. ») et le sentiment que quelque chose lui manquerait toujours.
Ainsi que l’affirme Thomas Pavel, la réduction de l’enseignement du latin au nom du combat contre un élitisme prétendu revient en fait à enchaîner les gens dans leur condition, à « s’assurer qu’ils seront les victimes de la distraction et de l’oubli, les prisonniers de l’utile ». « On égalise en déshabillant, certes, dit encore Hubert Aupetit, mais on le peut aussi en donnant un manteau à chacun pour affronter l’hiver. »
Si nos humanités, si nos langues mortes n’étaient pas si vivantes, s’ingénierait-on à les liquider sur l’autel de l’interdisciplinarité ? Un mot barbare, quoique latin.



![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)








