Voix de Syrie
Le politologue d’origine libanaise Gilbert Achcar, qui enseigne dans une université londonienne, avait publié il y a trois ans un livre consacré à l’éclosion et aux premiers temps des soulèvements arabes [1]. Ce nouvel ouvrage reprend la lecture des événements qui ont bouleversé le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord là où le précédent était resté : à l’automne 2012. Depuis, les révolutions se sont transformées en contre-révolutions et, en Syrie comme en Égypte, les deux cas qu’étudie de près Gilbert Achcar, à l’espoir a succédé la barbarie.
Gilbert Achcar, Symptômes morbides : La rechute du soulèvement arabe. Trad. de l’anglais par Julien Salingue. Sindbad-Actes Sud, 280 p., 22 €
Cet échec n’est pas définitif. Gilbert Achcar se situe dans le long terme d’un processus révolutionnaire s’étendant sur des décennies, où le printemps pourrait finalement s’installer et devenir durable. Les événements tragiques qui se sont enchaînés ces dernières années sont les symptômes morbides d’une crise (la métaphore est empruntée à Gramsci) où l’ancien meurt et où le nouveau ne peut pas naître. On comprend ainsi que l’analyse de Gilbert Achcar ne porte pas sur les dynamiques révolutionnaires, mais sur les étapes d’un échec programmé mais peut-être temporaire, échec qu’il semble promettre également à la révolution tunisienne.
Gilbert Achcar est tout à fait représentatif d’une gauche intellectuelle arabe qui aspire à « une révolution sociale radicale » et ne se contente pas d’une démocratisation politique, même s’il en reconnaît, un peu malgré lui, les mérites. Il note ainsi « l’intense répugnance du régime Assad pour le potentiel contagieux de la démocratie », qui explique la violence immédiate de la répression d’un mouvement pacifique.
S’agissant du désastre syrien dont il retrace les étapes, la cause, selon Achcar, en est double : d’une part, la politique américaine ; et de l’autre, un « intégrisme islamiste » tous azimuts. Ce schéma interprétatif, que l’on retrouve tout au long du livre, manque, pour le moins, de complexité. Il ne tient pas compte du fait que l’adhésion à des partis ou à des mouvements (différents les uns des autres et sujets à des divisions internes) se référant à l’islam a fait également partie du processus révolutionnaire. François Burgat ne cesse de le répéter et de le démontrer [2]. Dans un article récent (Nawaat.org, 9 janvier 2017), l’intellectuel tunisien Sadri Khiari observait que « l’enracinement populaire d’Ennahdha n’était pas qu’une histoire de ‟conservatisme religieux” ou de manipulation, qu’il était, que l’on s’y reconnaisse ou non, l’une des expressions de la révolution – la révolution réelle, belle et moche à la fois – et non de la contre-révolution ». Mais il n’est pas toujours facile d’admettre ces faits et d’en tirer les conséquences.
La politique moyen-orientale menée depuis des décennies par Washington a été désastreuse. Nul ne le conteste. Gilbert Achcar souligne la symétrie existant, à ses yeux, entre George W. Bush, à l’origine d’une agression militaire contre l’Irak, et Barack Obama, coupable de non-assistance à la population syrienne quand celle-ci réclamait, au minimum, des missiles portatifs pour répliquer aux hélicoptères qui larguaient des barils de TNT, puis des composants chimiques.
L’auteur minimise considérablement la responsabilité de l’intervention russe. C’est « le désarroi évident de Washington » qui aurait ouvert la voie à la Russie. Gilbert Achcar s’appuie ici sur une déclaration du président iranien Hassan Rohani, selon qui le « soutien militaire au régime syrien » aurait été apporté avec l’accord tacite, sinon explicite, de Washington. C’est ce même Iran qui ailleurs est désigné comme « le régime intégriste islamique khomeyniste iranien ». Ailleurs, il est question du régime corrompu et confessionnel chiite de Bagdad. Mais les pays à majorité sunnite, comme la Turquie et les monarchies du Golfe, ont également pris une part très importante au déclenchement de cette série de catastrophes.
On souhaiterait certes, aujourd’hui, que puisse être démontée la mécanique funeste qui a conduit les puissances régionales et internationales à investir une Syrie transformée en arène où depuis elles ne cessent de se mesurer. Mais l’analyse devrait être menée en termes politiques ; elle devrait évaluer les intérêts en jeu et en conflit, en se demandant ce qui se dissimule derrière cette invocation multiforme à des références religieuses.
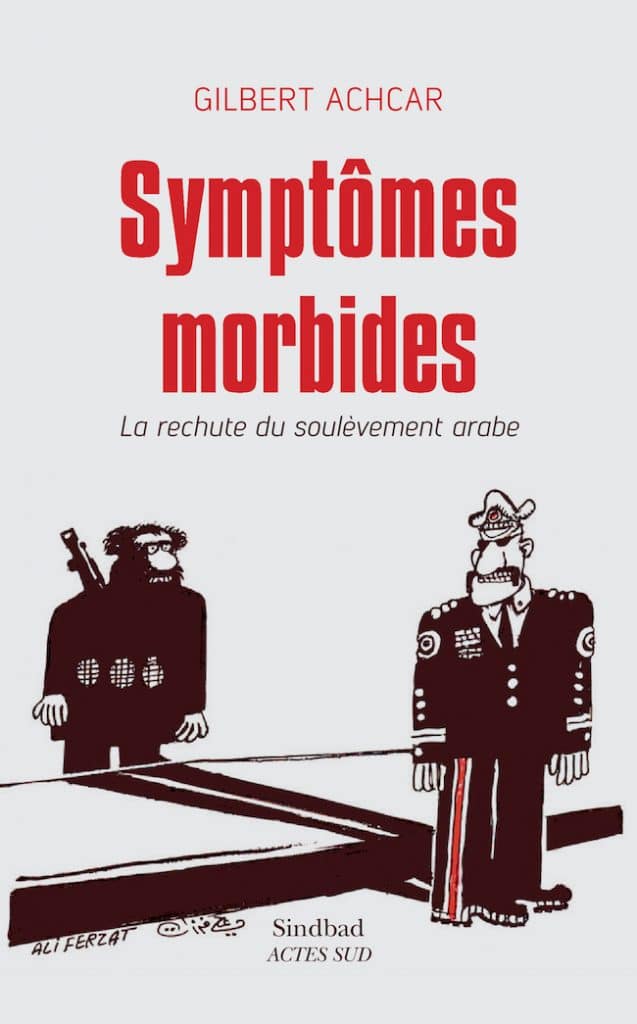
Il est vrai que la situation syrienne, avec ses jeux d’alliances multiples qui se font et se défont, est particulièrement difficile à analyser. Mais elle implique également des acteurs locaux, des stratégies, qu’on ne voit guère apparaître dans le long chapitre que lui consacre Gilbert Achcar. On sait pourtant, par divers témoignages, que les miliciens circulent d’un groupe à l’autre. On sait aussi que dans ce que l’on appelle l’opposition syrienne démocratique on tente aujourd’hui de dresser l’inventaire, et d’identifier la succession des erreurs.
Le cas de l’Égypte, auquel Gilbert Achcar consacre le deuxième grand chapitre de son livre, est très différent. On se trouve dans une situation assez classique, puisque c’est un coup d’État difficilement reconnu comme tel par la communauté internationale qui a mis fin au processus révolutionnaire, et instauré une répression féroce. Les partisans du coup d’État opéré par Abdel Fattah al-Sissi le 3 juillet 2013 l’ont présenté comme une deuxième version du putsch de juillet 1952 par lequel les officiers libres égyptiens, dirigés par Gamal Abdel Nasser, avaient renversé la monarchie. Gilbert Achcar, lui, les oppose. Le putsch de 1952 était un coup d’État révolutionnaire ; celui de 2013, qui a restauré l’ancien régime, un coup d’État réactionnaire qui a mis en place « un régime de terreur d’État ».
Ce n’est pas la destitution du président élu, Mohamed Morsi, qui fait problème pour Achcar. Non seulement Morsi avait échoué à relancer l’économie, même en mettant en œuvre les réformes néolibérales requises par le FMI, mais il avait été dénoncé par les associations syndicales pour n’avoir pas tenu ses promesses électorales, pour avoir utilisé des moyens extrêmement violents afin de réprimer les grèves. Il avait refusé de céder aux manifestations et à la campagne de pétitions réclamant une élection présidentielle anticipée. Les « progressistes égyptiens » se tournèrent alors vers l’armée pour obtenir sa destitution. Une destitution que l’armée s’empressa de leur accorder, mais pour s’emparer du pouvoir et ne plus le lâcher, en s’engageant dans une « terrible escalade répressive » dont tous furent victimes : les Frères musulmans, d’abord, les « progressistes » ensuite, avec les ouvriers et les syndicalistes, et même ceux qui naïvement ont depuis tenté de recueillir des informations. On pense ici au jeune chercheur Giulio Regeni, qui travaillait sur les syndicats égyptiens, et dont on a retrouvé le corps mutilé en février 2016 dans une banlieue du Caire : il avait été torturé à mort. On se plaît à rêver à l’État de droit et au simple respect des règles de la démocratie formelle.
« Socialisme ou barbarie », écrivait Rosa Luxemburg en 1915. Pour Gilbert Achcar, l’ensemble de la région arabophone est condamné à rester dans « l’enfer du choc des barbaries » tant que ne seront pas construites des « directions progressistes résolument indépendantes ». C’est alors seulement que pourra s’achever « la transition vers une nouvelle ère de développement humain et d’émancipation ». Cette vision d’avenir ressemble fort à un retour vers les rêves du passé.
-
Gilbert Achcar, Le peuple veut : Une exploration radicale du soulèvement arabe, Sindbad-Actes Sud, 2013.
-
François Burgat, Comprendre l’islam politique : Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste, 1973-2016, La Découverte, 2016.





![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)






