Au moment où font rage les discussions sur la « post-vérité » et les « faits alternatifs » en politique, il est bon d’avoir un livre sur la source en principe la plus fiable de faits non alternatifs, la science. Las ! Les scientifiques aussi sont atteints, comme le montre Malscience, le livre rigoureux et tonique de Nicolas Chevassus-au-Louis, par les fake news. Heureusement même les fraudeurs n’ont pas encore invoqué les faits alternatifs. Il y a donc de l’espoir que la science continue à nous donner le la sur ce qu’est un fait et que les journalistes puissent au moins de loin s’inspirer d’elle.
Nicolas Chevassus-au-Louis, Malscience, de la fraude dans les labos. Seuil, coll. « Science ouverte », 200 p., 18€
Le livre de Nicolas Chevassus-au-Louis est un véritable inventaire de toutes les manières dont le faux se manifeste en sciences. Dans une conception idéale, hypothético-déductive, le savant propose ses hypothèses, en déduit des conséquences observationnelles, et si l’expérience les infirme, l’hypothèse est rejetée, cédant la place à une autre, jusqu’à ce qu’une théorie soit bien établie. Idéalement le savant recherche la vérité de manière désintéressée, pratique le scepticisme méthodologique, et s’adresse à une communauté, celle de ses pairs, qui ont reçu la même formation que lui et respectent les mêmes valeurs. Mais on sait que cette image idéale est rarement réalisée. Les hypothèses ne viennent pas toutes seules, ni sous forme organisée : le hasard, l’intuition, voire même l’inspiration jouent un rôle crucial. Les théories ne sont pas ordonnées comme des soldats de plomb ni structurées comme des axiomatiques (même si post hoc, après coup, on peut se livrer à des reconstructions rationnelles, qu’on enseigne dans les manuels). Enfin la relation des théories à l’expérience est complexe. Comme le soutint Duhem, il est rare qu’on puisse tester une hypothèse isolément sans tirer la bobine de la théorie d’arrière-plan qui se lie à elle, et surtout il n’est pas toujours aisé d’interpréter les données. Mais, aussi problématique soit souvent la manière dont on teste et reçoit les hypothèses en science, il y a, comme le disait Thomas Kuhn, un régime normal de la science, qui en fait la forme de savoir la plus fiable, la plus respectée et la mieux policée.
Certes, nombre de sociologues des sciences et de philosophes comme Paul Feyerabend n’ont pas cessé de nous expliquer que, non seulement ces idéaux et valeurs sont sans cesse battus en brèche, mais aussi qu’il n’y a pas de méthode ni de fondement rationnel à l’activité scientifique. On savait aussi que, pour reprendre une réflexion d’Ulrich dans L’homme sans qualités, les mœurs des savants ne sont pas si différentes de celles des braconniers. On en avait eu toutes sortes de confirmations en lisant par exemple la manière dont James D. Watson a narré la façon dont il avait volé l’hypothèse de la double hélice, ou la course effrénée à la découverte du virus VIH par les équipes du Dr Gallo et celles de Luc Montagnier. On avait bien entendu parler de l’affaire lamentable de la mémoire de l’eau, des plagiats des inénarrables frères Bogdanoff, des sorties de Claude Allègre contre le réchauffement climatique, du scandale du psychologue Stapel qui faussait toutes ses données, et d’un certain nombre d’autres scandales. Et l’on pensait que c’étaient là des exceptions, un peu trop médiatisées, mais ne remettant pas en cause le fonctionnement général de l’institution scientifique.
Mais la lecture de Malscience montre au contraire que la science normale produit de manière régulière des fraudes, des filouteries et des mensonges, des plagiats, des arrangements avec la méthode, les mesures, les voies de publication et de production des travaux scientifiques. Nicolas Chevassus-au-Louis se livre à une enquête extrêmement détaillée, aussi précise et chirurgicale que les situations qu’il décrit l’exigent, qui révèle que la fraude est presque devenue constitutive de la production scientifique. Elle affecte toutes les disciplines, mais surtout les disciplines biologiques et médicales, ce qui semble a priori normal, car ces dernières sont à la fois celles où les enjeux économiques et sociaux sont les plus saillants et celles dont les procédures de vérification sont les plus fragiles. Mais on découvre aussi qu’elles affectent, bien que dans une moindre mesure, la science fondamentale, la physique et la chimie. Elle n’affecte pas les mathématiques, car l’erreur s’y détecte immédiatement. Mais tout mathématicien vous racontera des histoires de plagiat, et personne ne niera qu’il y a dans ce domaine aussi des biais, des modes et des formes de compétition.
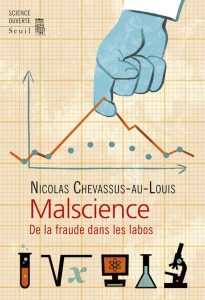
Il n’est pas très difficile de trouver des explications à ce phénomène généralisé. La science est devenue technoscience et elle affecte toute l’économie et le devenir de la planète. Les pays qui, comme la Chine, la Corée et le Japon, étaient jadis des nains dans ce domaine sont devenus des géants, mais leurs chercheurs peinent encore à publier en anglais. Les revues scientifiques sont supposées passer au crible les articles, mais bien souvent les referees, débordés, laissent passer d’habiles contrefaçons. Le système même des experts pour les grandes agences de financement est loin d’être transparent (et le cas des conflits d’intérêt dans les grands groupes de pharmacie a assez défrayé la chronique). Le système de financement privilégie l’impact factor (le nombre de citations dans les revues les plus cotées, qui, par un effet de feed back, sont les plus lues) et on donne systématiquement plus de crédits à ceux qui ont déjà publié. Le publish or perish, la multiplication des articles (un article peut se dupliquer en deux ou trois autres) et le principe de Sarkozy (« Qui paye décide », qui revient à dire que l’on ne cherche, dans certains secteurs, que ce que les financeurs voudraient qu’on trouve) ont accéléré encore jusqu’à la surchauffe la machine à produire de la science. On publie aussi ce qui « marche », en privilégiant les découvertes sensationnelles, ou celles qui vont avoir a priori des impacts humains ou technologiques majeurs. Enfin le système de méritocratie scientifique, avec ses prix Nobel et ses médailles, ainsi que l’ensemble du système universitaire encouragent ces phénomènes (les crédits, depuis les années 90, ne sont plus récurrents, mais liés à des appels d’offre, où il faut nécessairement se vendre). Pire : alors que certaines fraudes sont rapidement découvertes et publicisées, les fautifs livrés à la vindicte populaire, d’autres mécanismes conduisent à l’omertà (comme le montre Chevassus-au-Louis dans un éclairant chapitre sur la tendance des Français à préférer cette méthode). Beaucoup de ces dispositifs favorisent les escrocs qui cherchent une carrière rapide, les ambitieux qui veulent acquérir du pouvoir ou l’étendre, et les entrepreneurs.
Nicolas Chevassus-au-Louis propose, en remède partiel à son constat lucide et déprimant, de « ralentir la science », en la désindividualisant (en récompensant autant le labo que les chercheurs individuels), en la communalisant, en renonçant à l’impact factor et à l’envahissement de la bibliométrie. Mais c’est, je le crains, un peu comme espérer que Pierre et Marie Curie pourront rester dans leur petit laboratoire du cinquième arrondissement une fois que Monsieur Schutz aura obtenu ses palmes (dans le film du même nom). La Troisième République des sciences a à peu près autant disparu que celle des Lettres.
C’est d’ailleurs une question qu’on peut aussi se poser en refermant cet excellent livre : que dire du monde des lettres et des sciences humaines ? Si l’on suit le principe selon lequel plus une science est « molle », plus elle est susceptible d’être la proie du plagiat et de la fraude, on devrait s’attendre à ce qu’un livre semblable puisse s’écrire sur la sociologie, la psychologie, l’économie, et même la littérature et la philosophie. Et de fait on a encore en tête l’affaire Maffesoli-Elisabeth Tessier, et des canulars comme celui qui mit aux prises récemment des imitateurs facétieux de la prose d’Alain Badiou dans l’International Journal of Badiou Studies , ou encore des affaires comme celles d’un vulgarisateur scientifique comme Étienne Klein pris en flagrant délit de plagiat. On trouvera sans peine des équivalents dans le domaine des lettres et des sciences sociales des cas de fraude scientifique décrits dans ce livre. Si un « grand philosophe » peut être si aisément imité et canularisé n’est-ce pas qu’il y a quelque chose de louche dans la posture du gourou ?
Le syndrome est encore plus général. Ceux qui fraudent, dans les sciences ou dans les lettres ne sont pas tant à condamner parce qu’ils ont commis des grivèleries intellectuelles (les plagiaires plaident toujours l’étourderie, et minimisent leurs fautes), voire des escroqueries passibles de poursuites pénales, mais bien plutôt parce qu’ils ont péché contre l’Esprit. Comme l’a écrit Jon Elster , il y a un obscurantisme dur dans les sciences dures, qui tient au fait que la science normale a trop confiance dans ses méthodes, et se croit toute puissante. Il y a aussi un obscurantisme mou dans les sciences molles, qui vient de ce qu’on n’y respecte pas les valeurs intellectuelles et qu’on est prêt à produire des théories fumeuses sur n’importe en quoi en toute impunité (on a rarement vu un philosophe médiatique jeté en prison pour ses bêtises). Mais on peut se demander si le premier obscurantisme n’est pas moins grave que le second. Car au moins le savant fraudeur a une idée de ce qu’est la méthode scientifique et il la respecte minimalement, même si c’est pour servir à ses propres fins, tandis que le littérateur ou le philosophe marron la méprise.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
