Son parti pris de « métamorphoses » (d’anamorphoses, parfois) fait que ces pages offrent une sorte de bouquet de ce que sait faire Gérard Cartier, de ce par quoi il doit passer s’il veut parvenir à donner une image fidèle de lui-même.
Gérard Cartier, Les métamorphoses. Le Castor Astral, 110 p., 12 €
Ingénieur de métier (il a fait partie des équipes qui ont réalisé le tunnel sous la Manche et conçu celui vers l’Italie), Gérard Cartier a longtemps séjourné à l’étranger. Cette absence n’a pas empêché son œuvre de trouver une place dans le champ poétique français. Elle n’a manqué ni d’éditeurs (Flammarion, Obsidiane), ni de reconnaissance (prix Max-Jacob et Tristan-Tzara). Désormais libre de se consacrer à l’écriture, il est un des membres essentiels de la revue en ligne Secousse où il se révèle un lecteur attentif des poètes de son temps.
« Du désir ainsi que d’un fruit »
Je ferai mon poème en forme de citron qu’il roule sous la main qu’il offre aux lèvres sa pointe charnue j’ai des anciens sultans la faim terrible et l’œil égaré et je vois sous le volet ma favorite un souple rameau aux fruits aigrelets
Le cloître est sombre seize vierges dans leurs cages chantent en bas latin dans l’aurore je vois à la branche vernie pendre un astre froid ce citron est mon cœur un soleil au-dehors triomphant disgracié au-dedans et gorgé d’amertume
Le ciel paraît la terre est un jardin seul sur un banc écarté j’appelle mon amie et j’aigris suscitant dans l’éclat du verger un simulacre louant en silence celle qui se dérobe un citron pour la bouche et pour la main une ombre…
Ce poème est caractéristique d’une forme que tes lecteurs reconnaissent immédiatement. Ce bloc de prose ajouré, divisé en fragments (?), brouille entre autres les frontières entre phrase et vers, et se révèle plein de possibilités rythmiques.
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre. Il est vrai que lorsque j’écris en blocs de prose ajourés, comme ce poème « en forme de citron », je me sens généralement assez à l’aise. Cette forme, qui n’est pas nouvelle (elle a été pratiquée par d’autres, Paul Louis Rossi en particulier), est extrêmement flexible et a l’avantage, entre autres, de se plier à toutes sortes de combinaisons rythmiques. Elle permet de varier la longueur des « fragments », donc la cadence et le mouvement du poème, tout en conservant à celui-ci un aspect relativement compact. Mais, en dépit de la très grande liberté qu’elle autorise, c’est une forme : elle a ses règles, plus ou moins conscientes. Il suffit, pour s’en rendre compte, d’imaginer ce que deviendrait un tel poème (celui du citron) si l’on faisait de chaque fragment un vers : il s’effiloche, la forme apparaît arbitraire, une partie de l’effet s’évanouit.
La liberté dans l’écriture n’est pas toujours un avantage. Les formes plus rigides ont aussi leurs vertus. Quand la forme commande, elle oblige à sortir de soi, à inventer. Pensons aux trouvailles auxquelles la nécessité de la rime (que je pratique très peu) a conduit certains poètes – Emmanuel Moses, par exemple dans son dernier recueil (Ivresse, Al Manar).
En outre, sauf exceptions justifiées par le projet du livre, j’aime varier la forme d’un poème à l’autre : vers libres, vers troués, prose, versets, etc. C’est le cas dans ces Métamorphoses. Non seulement parce que la répétition d’une forme unique pourrait engendrer une certaine monotonie, mais aussi parce que c’est parfois une nécessité : de façon un peu mystérieuse, certains poèmes qui viennent mal dans une forme se mettent immédiatement en place dans une autre. Quand un poème me résiste (c’est fréquent !), je ne trouve souvent la solution qu’en changeant sa forme.
Tes textes sont souvent très denses, comme si chacun d’entre eux voulait épuiser son sujet. Dans cette densité, les différents silences sont essentiels pour la compréhension mais aussi pour le plaisir. Pourrais-tu nous dire comment tu les conçois, comment tu t’en sers… et quels sont tes rapports avec l’oralité ?
J’écris en aveugle, en me fiant autant à l’oreille (au rythme, aux assonances) et à l’œil (à l’apparence du poème, à sa disposition sur la page) qu’à ce qui régit la substance du texte – l’intelligence, la sensibilité, la mémoire. Quant à la densité de mes textes, Je n’en ai pas vraiment conscience – mais c’est une qualité que j’ai beaucoup valorisée dans mon activité professionnelle (« Belles oranges pas chères » !). Si une partie du travail d’écriture consiste à nouer de façon harmonieuse des mots épars et à découvrir un sens à ce qu’on a d’abord écrit d’instinct, une autre partie, la plus longue et la plus difficile, consiste à élaguer. Cela vaut sans doute pour toutes les formes d’écrits. Montherlant disait : « Je tiens qu’un tiers de la vie d’un auteur dramatique doit se passer à écrire des pièces, et les deux tiers restants à y faire des coupures. » Plus qu’à épuiser mon sujet, je cherche donc à donner une cohérence au poème, à en faire un tout harmonieux pour l’oreille, pour l’œil et pour l’esprit. Je le prends et le reprends longtemps, jusqu’à ne plus pouvoir le changer sans croire le gâter (on s’abuse facilement).
Dans le dispositif du poème, les espaces blancs sont pour moi essentiels. Ces silences jouent comme une ponctuation. Ils permettent de multiples effets – modulations du rythme, jeux d’échos, rimes internes, suspensions ou ruptures du sens, etc. Il m’arrive souvent de les utiliser dans d’autres formes de poèmes, par exemple en vers :
Chancelant l’œil et la langue aux abois
Et la chair à l’agonie Comment
Réconcilier ces deux qui font leur personnage
La dimension orale du poème est primordiale. Je ne conçois pas qu’on puisse écrire ou lire un poème (non plus qu’un roman d’ailleurs) avec les yeux seulement, sans le dire, même de façon muette. L’épreuve de la lecture à haute voix est révélatrice. Si le poème vient mal en bouche, s’il ne coule pas (ou ne gronde pas, etc., selon l’effet recherché), il faut le reprendre. Il suffit parfois de changer un mot, de supprimer une syllabe – on ne s’en rend parfois compte que trop tard…
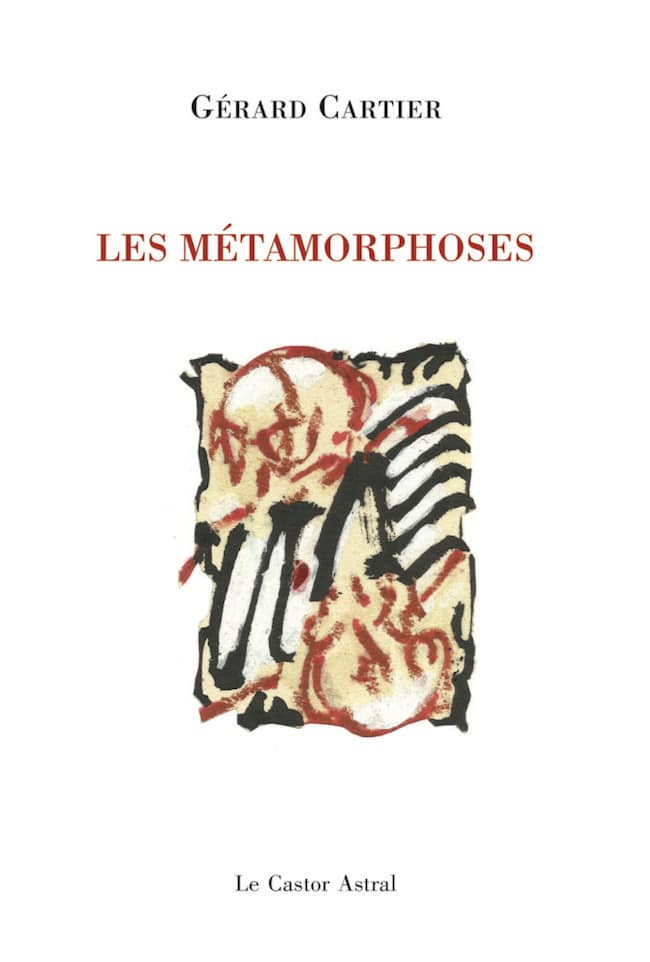
Tu accordes beaucoup d’importance à la mémoire. J’ai l’impression que, dans Les métamorphoses, tu te plais à user de toutes ses variantes, de toutes ses possibilités.
C’est tout à fait vrai, j’en prends conscience en lisant ta question. C’est peut-être une conséquence du fait que je n’écris que très rarement « sur le motif » et pour inscrire sur la page un sentiment. Ma matière, ce n’est pas l’instant vécu mais l’énorme masse de ce qui, au moment d’écrire, n’est accessible que par la mémoire : les soubresauts de l’Histoire (la déportation, le Vercors, la guerre d’Algérie, la Palestine…), les évènements de ma vie personnelle ou professionnelle, plus ou moins réinventés, les souvenirs de lecture, etc.
Cette dernière dimension est importante dans Les métamorphoses, ne serait-ce que parce que chaque poème est une évocation, parfois oblique, d’un poète d’aujourd’hui ou du passé. Ces « métamorphoses » sont en effet celles de l’amateur de poèmes qui parcourt les « ruines » de ses lectures (pour reprendre l’expression d’Olivier Rolin dans Bric et broc), c’est-à-dire ce qui subsiste dans sa mémoire longtemps après qu’il a refermé l’œuvre d’un poète : quelques vers, une image, un simple sentiment – ou le remède d’une abbesse allemande pour lutter contre la rétention du sang menstruel… C’est ainsi, par exemple, que le poème en forme de citron a été écrit à Grenade en pensant au poète andalou du XIe siècle Ibn Zaydûn, resté célèbre pour ses amours contrariées : « Elle est branche odorante et fruit ». Ces ruines de lectures sont le plus souvent colorées ou contaminées par ma propre vie, mes propres sentiments – ou bien c’est le contraire : un souvenir personnel, un évènement, un lieu suscite un poète – une visite du cimitero acattolico de Rome (le livre a été en partie écrit en Italie) appelle Keats et Pasolini.
Donc tu as raison, la mémoire joue un rôle essentiel dans ce livre. Il faut toutefois compter avec la liberté d’invention : doit-on toujours croire à ce que les écrivains prétendent, y compris à propos de leur propre vie (La prose du Transsibérien !) ?
Est-ce que « l’esprit scientifique » joue un rôle dans ton œuvre ?
C’est certain. En ce qui concerne les sujets abordés, d’abord. Mon livre précédent (Le voyage de Bougainville, L’Amourier, 2015), se présentait comme une encyclopédie des savoirs et des disciplines de la pensée : histoire naturelle, géographie, sciences, etc. Il était donc tout entier gouverné par cet « esprit scientifique ». L’épigraphe était d’ailleurs : « Nul ne pénètre ici s’il n’est géomètre ». Dans Les métamorphoses, comme dans la plupart de mes livres, un poème évoque directement mon métier d’ingénieur : « Des ports sous les alizés des ponts volants corriger le monde… ».
C’est ce même esprit rationnel qui explique aussi, sans doute, l’organisation de mes livres. Aucun n’est un simple « recueil » de poèmes. Tous répondent à un projet : chaque poème prend place au sein d’une composition conçue a priori et concourt à un sens plus vaste que lui.
Plus fondamentalement, cet esprit (ce travers ?) se manifeste par une méfiance vis-à-vis de toute forme d’extase de la pensée, de toute transcendance – même si, paradoxalement, j’ai été très marqué par mes séjours dans un ancien monastère de chartreux, lorsque j’étais enfant, et si me fascine encore la posture monastique, où je vois une métaphore de celle de l’écrivain.
Propos recueillis par Gérard Noiret











