Dans son roman Brooklyn Strasse, Gabrielle Segal crée au cœur d’une bâtisse et d’un petit quartier tout un théâtre d’ombres et de voix où se mêlent souvenirs et présences, disparition et attente. Une écriture remarquable par touches fines et approches à l’affût, pour tenter de clore provisoirement des inventaires de vie. Un beau livre entêtant et profond.
Gabrielle Segal, Brooklyn Strasse. Maurice Nadeau, 208 p., 18 €
Ils sont voisins à Brooklyn, dans l’immeuble de Madleen Hutikton, et clients de l’épicier Stefan Karmerr, le vieux Juif berlinois ; la maison part à vau-l’eau et les rayons de l’épicerie dégringolent. Ils se croisent, ils s’écoutent, ils se devinent ; chacun a un secret lourd à garder et à porter. Gabrielle Segal construit leurs rencontres sur une vingtaine de séquences centrées à chaque fois sur un ou deux personnages, offrant une mise au point par bribes, un feuilletage d’introspection, une concentration sur un moment. Scènes brèves, conversations confiantes mais retenues, évocation voilée de terribles traumas, dessinent la marque de ce premier roman très travaillé et réussi.
Ils ont en commun leur habitat, leur classe moyenne, leur discrétion, une vie marquée par une rupture. Rupture causée par la grande histoire des barbaries, rupture amoureuse dans un bar ou sur un bref coup de fil vingt-sept ans après l’idylle, rupture du lien filial : Pete Parker disparait, laissant ses fils Chuck et Roy désarmés ; quant à Mary June Parker, elle est née d’un ventre anonyme. Dans leur flottement et leur solitude, naissent leurs paysages de mots, leur identité incertaine. Sans être minimaliste, Gabrielle Segal sait tirer parti de menus faits, d’odeurs et de légers glissements dans la perception d’un lieu familier après une courte absence. Épouse et fils délaissés, mari en fuite, orphelins, émigrés vieillissants, ils ont en commun la survie qui les hante, les liens brisés, l’avant et l’après.
Comme il y a les étages de l’immeuble – Norman Klein au deuxième, inconsolable de la mort de sa mère, Madleen au-dessus de la famille Parker –, il y a les strates des prises de conscience et des bouffées d’inconscience mal calées. Amours toutes contrariées, vies loupées, souvenirs d’émotions et méandres de l’âme : tout cela dans une langue imagée avec une densité sans lourdeur, une vibration des corps, des clés, des téléphones. Et la versatilité du quotidien fait échapper au dogmatisme d’un portrait à charge grâce à quatre versions du personnage du père, tout comme la nostalgie s’allège à l’arrière-plan, grâce à quelques scènes de jeunesse insouciante.
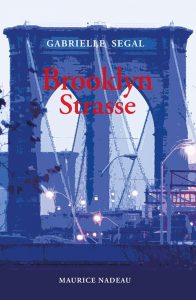
Brooklyn, terre d’exil et de mémoires : Gabrielle Segal joue constamment sur deux intrigues, la partie américaine, celle du présent avec la disparition de Pete Parker, le violent à la gueule d’ange, l’homme-bombe, le fauve aux dents carnassières, et la partie allemande, ancienne, enfouie, en lente métamorphose avec le temps, deux épisodes disjoints et rejoints alternant des instants de cruauté et de tendresse. Elle joue aussi sur deux échelles, du petit format de l’album de famille à la grande nasse de la période nazie, et pose ses rescapés comme « sur un pont, d’une distance de quarante années, entre Berlin et New York entièrement dans le brouillard ». Révérence gardée aux poèmes d’Heureux qui n’a pas de patrie de Hannah Arendt, cette double appartenance donne une épaisseur à ces anonymes aux histoires individuelles apparemment méconnues ou tristement banales, un formidable quant-à-soi tout en pudeur, une force dans la constance et l’approche de l’autre. Madleen, ex-médecin, voit défiler toutes les femmes qu’elle a sauvées mais qui retournent « toujours à leurs bourreaux logés dans leurs maisons et dans leurs cauchemars », mais elle se garde de toute interrogation morale.
Le temps reste imprécis, sans aucune date, même si Stefan, épicier sexagénaire, était étudiant en philosophie à Berlin avant de fuir en Amérique. De même, le site de Brooklyn n’est délibérément jamais décrit, pas une rue nommée, aucun marquage local d’un extérieur réduit à un terrain vague et à une allusion à l’hôpital, car c’est bien l’intérieur des perceptions et des mémoires qui est l’enjeu : les pensées encombrées, les rêves et les évocations. Sur le banc devant l’épicerie, où devisent les deux ex-Berlinois, « une image ancienne recouvre le présent. Trente ans plus tôt, sur ce même banc, Stefan avait embrassé Madleen sur les paupières. De la poudre vert pâle s’était déposée sur ses lèvres. Il l’avait attrapée avec le bout de ses doigts. Il se souvient du temps écoulé entre le moment où il avait pris la décision de lui donner un baiser et celui où il avait touché sa peau. Il se souvient de la couleur noire de cet instant, de ce geste. Il n’avait pas cherché les lèvres de Madleen mais bien ses yeux ». Les moments de tendresse qui flottent dans les souvenirs s’imbriquent dans la mosaïque d’un présent de mélancolie plus atone. Mais un fil continu est tendu de la jeunesse berlinoise aux retrouvailles à New York à mi-parcours, puis la vieillesse qui vient, et toujours le même banc devant l’épicerie : hier n’est pas mort.
Cette atmosphère à la Pinter, faite de menace ancienne, de violence sourde, voire d’envies de meurtre, s’alimente de croisements et de retours qui multiplient l’incertitude et la solitude des vies. Dès ce roman de l’intime qui a l’ambition d’un livre plus total, Gabrielle Segal manie bien le paradoxe d’une zone floue qui permet de peaufiner les personnages, celui d’une clandestinité réactivée – des fuyards des strasse au fuyard de Brooklyn –, et la fuite du temps dans le maquis des non-dits où le passé tour à tour affleure et s’efface. Dans ce système d’échos qui relie les fragments, d’intercalaires ciselés au rythme syncopé, la beauté vient de la forme imbriquée du singulier et de l’historique, si bien qu’au au fur et à mesure tout décolle, les rêves se multiplient, la confusion se revendique entre présent et passé. Brooklyn Strasse, ce sont des êtres en rappel pour qui court encore « le temps brut et indolore de la jeunesse berlinoise de Magda Beck et de Stefan Karmerr qu’elle chérira toujours fidèlement. Elle pressent qu’il s’accroche à ce temps – qui dans une époque pacifique les aurait irrémédiablement unis ». Les voilà tous deux loin des rues de Berlin, voisins à Brooklyn, « sur-vivants, sauvés sans doute mais un peu maudits, non ? », comme dit Karmerr.
Ce regret d’une époque pacifique trop brève lie les personnages de ce roman des douleurs de l’absence et de la fuite, du dépaysement perpétuel et des malédictions aléatoires. Brooklyn Strasse vrille dans les dégâts en préservant des équilibres et des échappées oniriques, en captant dans la pénombre et le brouillard le tourment de ceux qui tentent de réparer l’irréparable.












