Mémoire éclatée, de Nils Andersson, livre la face cachée de ce dont a vécu le second XXe siècle, non pas une contre-histoire que d’aucuns appelleraient le refoulé d’une hantise ou sa nostalgie, mais ce qui en fit la légitimité rétrospective : le combat incessant pour la liberté de penser et donc d’écrire et de publier au temps de la guerre froide qui ne supportait aucun accommodement avec les voies subversives de la pensée. Encore média majeur de la diffusion des aspirations politiques, le livre interdit, pourchassé, saisi, eut ses éditeurs capables de trancher sur l’essentiel et d’articuler la pensée à la morale, l’action aux options. Nils Andersson fut de ceux-là et, à le lire, nous plongeons dans ce qui constitua des chaînes d’insoumission du second XXe siècle, lequel ne leur fit pas de cadeaux.
Nils Andersson, Mémoire éclatée. Préface de Gérard Chaliand. Éditions d’en bas, 544 p., 25 €
Ce livre témoigne d’une triple histoire : celle d’une personnalité inflexible qui parle d’elle-même de façon mesurée ; celle d’une conjoncture politique dominée par les guerres de décolonisation et les remugles de la guerre froide ; celle d’un moment éditorial où le livre poursuivi avait la dignité du véhicule majeur qu’il allait cesser d’être avec le monde connecté. Le parcours singulier de Nils Andersson en fait un personnage singulièrement européen mais aucunement assimilable aux jeux de pouvoir de l’Europe qui s’est instituée. Le paradoxe est que la légitimité morale des institutions que l’on connaît dans leurs tribulations critiquées et critiquables provient précisément de ce qu’elle a récusé et qui s’est constitué très loin de son berceau : dans des combats à l’arraché d’acteurs et d’intellectuels, des protagonistes majeurs non moins internationalistes qu’idéologiquement rigoureux et toujours proches d’un communisme dissident.
Le récit semble se dérouler en voix off. Ce sont des faits déroulés par le témoin de son propre travail, dont l’ascèse est à peine dite, mais ainsi est mis en place, par les noms et la chronologie, le souvenir de ceux qui firent vivre un siècle alternatif absolument foisonnant. La Cité, la structure que Nils Andersson a très tôt mise sur pied, alors qu’il n’appartenait encore qu’à une bande de jeunes gens férus de poésie et de littérature, se proposait de déprovincialiser la Suisse, du moins le canton de Vaud, plutôt que de partir à Paris, car la culture francophone reste polarisée alors que les Suisses de langue germanique ne souffrent pas du même syndrome.
Tout a donc commencé par un simple organe de diffusion du livre français à fort impact poétique ou théorique. Son implantation au bas de la vielle ville de Lausanne, près du Grand-Pont et du café de la jeunesse d’alors, Le Barbare, eut aussi le bonheur de se situer au cœur d’un vaste immeuble contemporain, le Métropole, aux multiples issues, ce qui put se révéler utile par la suite. Loin du moindre réalisme commercial mais grâce à la confiance que lui firent Maspero, Jérôme Lindon et Oswald, ce comptoir put faire connaître ce qui passait mal en Suisse. L’aventure était improbable et audacieuse, et il n’y a pas jusqu’au fisc qui ne se soit étonné de la faible marge que prenait cette maison, réduite il est vrai à son unique agent.
 La Cité devient éditeur fortuitement, en 1959, pour raisons politiques, quand La question d’Henri Alleg ne put être imprimé à Paris ; de même pour La gangrène : témoignages qui prouvent que la métropole française est affectée en retour des méthodes qu’elle emploie en Algérie, ce que tous les rapports signalent à partir de 1957. Il fallut alors combiner des liens et des compétences. Le dispositif mis en place permettait de ressortir en dix jours les volumes saisis en France, surtout quand, à partir de 1960, se durcirent les attaques contre les tenants du droit à l’insoumission. Les uns composaient, d’autres qui imprimaient le journal du FLN surent faire fonctionner la fabrication, d’autres enfin la diffusaient, par petits paquets, alors que Feltinelli, fort de gros moyens financiers, n’imaginait pas possibles ces petits paquets et ces « moyens de boutiquiers ». Là encore, l’action n’a existé que par la confiance dans les contacts directs, déterminants.
La Cité devient éditeur fortuitement, en 1959, pour raisons politiques, quand La question d’Henri Alleg ne put être imprimé à Paris ; de même pour La gangrène : témoignages qui prouvent que la métropole française est affectée en retour des méthodes qu’elle emploie en Algérie, ce que tous les rapports signalent à partir de 1957. Il fallut alors combiner des liens et des compétences. Le dispositif mis en place permettait de ressortir en dix jours les volumes saisis en France, surtout quand, à partir de 1960, se durcirent les attaques contre les tenants du droit à l’insoumission. Les uns composaient, d’autres qui imprimaient le journal du FLN surent faire fonctionner la fabrication, d’autres enfin la diffusaient, par petits paquets, alors que Feltinelli, fort de gros moyens financiers, n’imaginait pas possibles ces petits paquets et ces « moyens de boutiquiers ». Là encore, l’action n’a existé que par la confiance dans les contacts directs, déterminants.
Cette partie de La Cité a été racontée par Nils Andersson au fil d’articles et dans Livre et militantisme : La Cité éditeur, 1958-1967 (Lausanne, 2007, un ouvrage collectif avec une postface de François Maspero), mais c’est l’enchaînement des rencontres et les reprises de la chronologie au fil d’une vie qui intéressent ici. Les dates et les lieux, les méthodes et les problèmes sont confirmés, des portraits esquissés en quatre mots, telle, par exemple, la figure de Robert Davezies, indéfectible soutien du FLN et prêtre de la mission de France, scientifique et passe-frontière qui fut arrêté au buffet de la gare d’Annemasse lors d’un rendez-vous avec Nils. On entrevoit aussi Jacques Vergès, toujours aussi ambigu.
Parallèlement, les choix éditoriaux à faire en conscience et en rigueur par l’éditeur qui croit à sa fonction, donc solitairement, furent déterminés par une ligne morale et esthétique : éditer un salaud reste indésirable en dépit des scoops possibles, il en est de même pour certaines aubaines. Et, dans tous les cas, un texte mauvais reste mauvais en dépit des critères adjacents possibles, et là Maspero ou Lindon, qui purent confirmer une hésitation, une décision, ont eu un vrai rôle d’amis et de soutiens.
Ces aventures éditoriales furent prolongées par nombre de travaux liés à des mouvements d’émancipation africains et latino-américains en sus de la guerre du Vietnam. Au moment du « grand tournant » des relations sino-soviétiques, quand tout parti communiste lié à Moscou interdisait la diffusion de ce qui venait des Éditions de Pékin. C’est alors que, fidèle à sa position, La Cité édita et réédita de la littérature prochinoise et ML (celle des partis marxistes-léninistes, particulièrement importants en Asie et autour du Pacifique). Là encore, la non-inféodation, le désir de savoir et la sincérité politique entraînaient des formes d’action liées à l’édition.
Fils d’un père suédois décorateur qui s’est arrêté à Lausanne sans prendre la nationalité suisse et d’une mère française et calviniste arrivée suite à des tribulations sur les bords du même lac, Nils Andersson fit tous ses apprentissages à Lausanne, y compris celui du métier de la décoration qui ne l’intéressait aucunement. Malgré un cocasse intermède de service militaire suédois, sans aucune maîtrise de la langue et avec campements par moins 30 degrés, il resta suisse de fait et de destin. Son expulsion de 1966, liée à des tracasseries venant des éléments les plus autoritaires de la Confédération, sous prétexte de contacts – éditoriaux – avec l’ambassade de Chine et au titre d’étranger, engendra le retentissant soutien de compatriotes de droite, peu sensibles au combat pour ces idées-là, et presque indifférents à la liberté de pensée des Suisses, mais qui défendirent vivement un concitoyen, né à Lausanne, parfaitement indigène jusque dans les bistrots fréquentés, soit très loin de la simple logique d’un passeport.
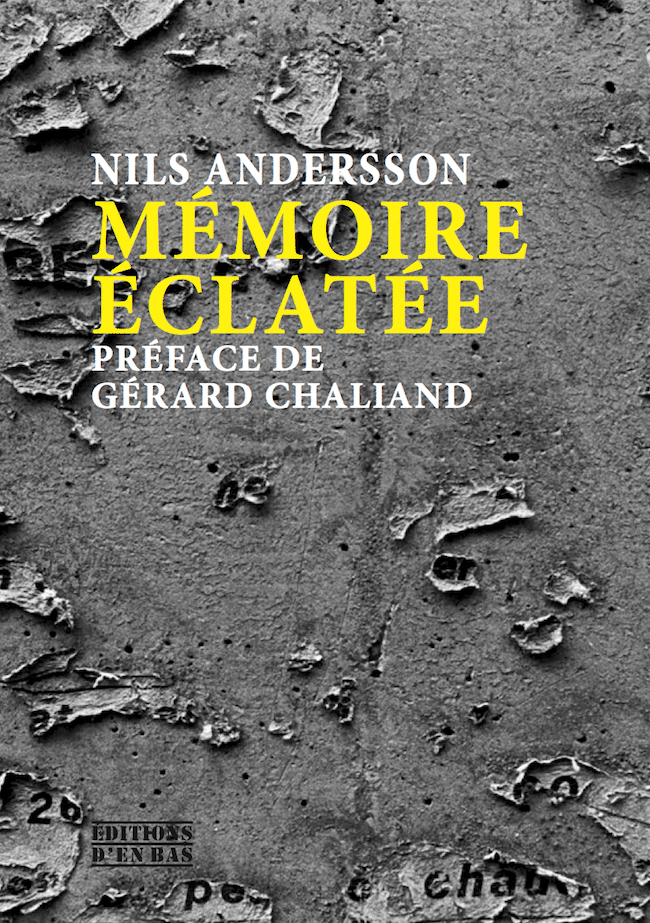
C’est là que le passage par Radio-Tirana et ses éditions en langue étrangère donnèrent à l’auteur la compréhension concrète de ce qu’est un monde méditerranéen montagneux, archaïque et patriarcal, dont il avait eu l’écho par les Algériens en lutte. Ce petit pays arriéré, Lilliput « isolé, ignoré, méprisé », tentait sa propre voie communiste en dépit de sa pauvreté, de son enclavement et de ses mœurs. Rien ne s’y joue comme ailleurs, car l’économie et le temps de la réception d’une idéologie sont subordonnés à d’infinies variables. À force de le parcourir en tous sens, l’auteur en reste un des rares connaisseurs et spécialistes ; de là, la pertinence et donc la vivacité des réflexions qui entourèrent la polémique avec Ismaël Kadaré, jadis grand protégé d’Enver Hodja, devenu son radical contempteur après 1990, quand « toute l’Europe » stigmatise ce qui fut peu ou prou communiste. Les difficiles aventures du XXe siècle sont là, féroces pour une non-puissance de surcroît non alignée, qui ne compte pas deux millions d’habitants.
La vingtaine d’années suédoises de l’auteur, toujours diffuseur de livres et manieur de cartons, fut rude ; le marché de la littérature francophone est étroit, les boulots adjacents sont nécessaires, tant pour le narrateur que pour sa femme Renée, et l’exil doublé de vrais/faux retours au pays use autant qu’il interroge sur ce qu’est un chez soi et une langue, des odeurs et des mœurs dont l’analyse finale est que l’année 1986, avec l’assassinat d’Olof Palme, toujours non élucidé, marque un tournant indéniable pour l’Europe entière : la fin d’une social-démocratie qui parut heureuse du fait de sa durée, au point de pouvoir faire croire à un modèle possible, mais cet adoucissement des mœurs partit d’une situation de misère absolue qui était celle de paysans perdus de famine, d’alcoolisme et d’ignorance, longtemps promis à un exil de masse vers l’Amérique.
Ainsi alla la vie d’un homme et d’un groupe sans cesse refait, similaire et différent, le sens même du compagnonnage qui gouverne les travaux du livre et la réalité de la pensée du second XXe siècle. Sauter les frontières au rythme de rendez-vous utiles de Paris à Lyon et circuler de fait et de force à travers l’Europe entière, cela rappelle les incertitudes et les contradictions d’un proche passé qui se projeta ailleurs que dans le discours politique actuel. Le rappel de ces contingences n’en est que plus précieux et c’est cette histoire que relate avec équanimité Nils Andersson. Et ses scrupules d’acteur d’abord témoin, la modestie de celui qui sait, sans s’en targuer, rendent son texte magnifique.












