Dans l’embrasement des journées de juillet 1789, la police royale de Paris s’effondre aussi brutalement que l’Ancien Régime. Comment « l’admirable police » vantée par les visiteurs de la capitale française a-t-elle pu disparaître aussi rapidement alors que tous la disaient omnisciente grâce à une surveillance étroite de la population parisienne ? Plus encore, comment l’édifice policier de la Lieutenance générale, autant admiré que redouté, avait-il réussi à « tenir Paris » pendant plus d’un siècle ? Dans un pays où les relations entre la société et la police sont toujours empreintes de défiance, le « compromis de l’ordre » trouvé au XVIIIe siècle invite à une réflexion historique en profondeur.
Vincent Milliot, « L’admirable police » : Tenir Paris au siècle des Lumières. Champ Vallon, coll. « Époques », 376 p., 28 €
Ce livre dense et fouillé nous fait pénétrer dans les mécanismes de la police parisienne de l’Ancien Régime. Il complète le précédent ouvrage de Vincent Milliot sur les mémoires du lieutenant général de police Lenoir et résume une vingtaine d’années de recherches sur le sujet dans les archives parisiennes. Le résultat évite les deux écueils trop souvent rencontrés dès qu’il est question de police, à savoir le procès à charge contre les « ripoux », laquais obtus d’un pouvoir liberticide, et l’admiration sans recul pour une police omnisciente et d’une habileté quasi surnaturelle.
Pour sortir des polémiques, rien ne vaut l’immersion dans le fonctionnement de la « machine policière » parisienne du XVIIIe siècle. Trois sortes d’« ouvriers » y travaillent : 48 commissaires, 20 inspecteurs et peut-être 3 000 espions, sans compter les patrouilles des gardes et soldats occupés à la « manutention » de la police. Les premiers, magistrats du Châtelet, le tribunal de première instance de Paris, incarnent le lien indéfectible entre la justice et la police. Plus anciens que le Lieutenant de police créé en 1667, bien assis dans leur charge, comme tous les propriétaires d’offices de grande valeur sous l’Ancien Régime, ils garantissent le maintien d’un « style » de police conforme aux traditions de l’État de justice, que défend également le Parlement de Paris contre la montée en puissance de l’administration royale. Toute l’habileté des lieutenants généraux de police successifs aura été de les diriger vers l’exercice d’une police modernisée, plus proactive, moins intégrée dans les réseaux de voisinage et de métier, sans rejet de leur part ni perte de prestige auprès des populations.

Ainsi se dessinent les silhouettes de commissaires dévoués, proches du lieutenant, comme Pierre Chénon, commissaire du quartier du Louvre et chargé du département de la Bastille et des ordres du roi. Un homme de confiance donc, sur qui Sartine et Lenoir s’appuient directement, mais aussi une autorité de référence dans son quartier, capable de faire cesser une émeute par sa seule présence. Car si certains commissaires préfèrent exercer leur charge tranquillement, en poursuivant davantage les opérations rémunératrices comme la pose de scellés après décès que les voleurs, d’autres deviennent des spécialistes efficaces et zélés, dans la lutte contre la prostitution, la surveillance des logements « garnis », les vols dans les marchés, etc. La compagnie des commissaires elle-même, structure corporative classique d’Ancien Régime, qui aurait pu garantir l’autonomie de ses membres, devient progressivement un outil de promotion et de direction des carrières dans la main du lieutenant.
Avec les inspecteurs, le lecteur entre dans la zone grise de la réputation policière. En effet, les inspecteurs de police, créés par le lieutenant d’Argenson à la fin du XVIIe siècle, incarnent longtemps aux yeux des Parisiens (et de certains historiens) l’illégalité, la brutalité, la corruption. En bref, les inspecteurs auraient été les exécuteurs des basses œuvres d’un pouvoir despotique. Le procès mené sous la Régence (1715-1723), qui révèle leurs exactions et pour certains la collusion avec la bande du célèbre bandit Cartouche, les marque pour longtemps d’une infamie apparemment méritée. L’effort de la lieutenance, maintenu durant le siècle, aura été de reprendre en main ces « moutons noirs » pour en faire des officiers de police aussi efficaces que respectés. Cette difficile transformation, qui prend forme avec la refondation du corps à partir de 1740, s’appuie sur une attention rigoureuse portée au recrutement : les militaires, dont la dignité égale celle des magistrats, deviennent les candidats préférés. Plus encore, les lieutenants n’hésitent pas à sanctionner les inspecteurs indélicats ou compromis. Propriétaires d’offices dont la valeur ne cesse de grimper, bénéficiant de revenus confortables, les inspecteurs de police de la fin du siècle peuvent collaborer avec les commissaires à respect égal. Au cœur de la lieutenance, le bureau de Sûreté qui lutte surtout contre le vol, par le renseignement et les recherches de terrain, réunit l’élite de ces policiers, qui expérimentent de nouvelles techniques d’enquête.

Le Traité de la Police, de Nicolas de la Mare
Les espions de police, enfin, ne connaissent évidemment pas semblable réhabilitation. Le lynchage d’une « mouche » de police au Palais-Royal au tout début de la Révolution donne la mesure de la haine populaire à leur égard. L’espionnage généralisé est d’ailleurs mis en avant par tous les contempteurs de la police parisienne. Mais, là encore, Vincent Milliot nous invite à dépasser les apparences et à nuancer les évidences trop faciles. Sous cette rubrique générale d’espions de police se dessinent en effet des individus très différents. Les uns sont des indicateurs rémunérés, repris de justice sortis de prison en échange de leur collaboration avec la police, méprisés par celle-ci comme par l’ensemble de la société, mais qui permettent de résoudre les affaires. D’autres, de toutes origines mais avec une forte proportion de domestiques, espionnent réellement les cercles et les milieux dans lesquels la police ne peut pénétrer, des cafés à la mode jusqu’aux salons les plus huppés. D’autres, enfin, sont plutôt des auxiliaires naturels de la police, comme les revendeuses de fripes du Pont-Neuf, qui signalent volontiers les vendeurs suspects aux commissaires et inspecteurs. En échange de leur participation à la lutte contre le vol, la police les protège de la concurrence des revendeurs non autorisés qui cherchent le client n’importe où dans la ville.
Car la police parisienne, comme toutes les polices d’Ancien Régime, a pour objectif majeur d’assurer le bon ordre des êtres et des choses dans une vision immuable du monde. L’espionnage généralisé tout comme les « enlèvements de police » sont des outils au service d’une vision prophylactique du rôle de la police dans la ville. Il s’agit d’être bien informé pour prévenir les « malheurs » et de retrancher préventivement du corps social les individus fauteurs de désordre. La police écarte les individus qu’elle juge inutiles ou néfastes à la bonne cohésion sociale, comme elle fait enlever du marché les vivres avariés ou traiter de force les prostituées malades. La pratique policière relève de la prophylaxie sociale, la bonne police étant d’abord et avant tout garante de la prospérité et de la sécurité des peuples. Dans cette conception d’une police protectrice et préventive, l’arbitraire n’est donc pas un obstacle ni un sujet de critiques sauf lorsqu’il entraîne des erreurs sur les personnes ou des abus dans les moyens employés. Or, la lieutenance de police les évite de mieux en mieux, en croisant les informations, en surveillant ses personnels, en respectant des formes bureaucratiques élaborées et en recherchant une validation judiciaire rapide. C’est dans cette rigueur croissante, dans cette attention aux procédures, que se justifie aussi l’excellence de cette police parisienne.
Si la police « tient » Paris sans problème majeur avant 1789, c’est encore parce que les conceptions de la bonne police rejoignent les attentes sécuritaires de la population, à une époque où la vie reste « fragile ». L’arbitraire policier est accepté comme contrepartie de la protection policière dans la vie quotidienne, surtout lorsqu’il s’insère dans des cadres comme les corporations ou la famille. Si la police est gravement remise en cause lors des émeutes à propos de la rumeur d’enlèvements d’enfants en 1750, les familles font toujours appel au lieutenant pour obtenir des lettres de cachet contre un fils rebelle ou un mari violent. De manière tacite, la police parisienne arrive à maintenir, pendant presque tout le siècle, un « compromis de l’ordre » entre la société et le pouvoir.
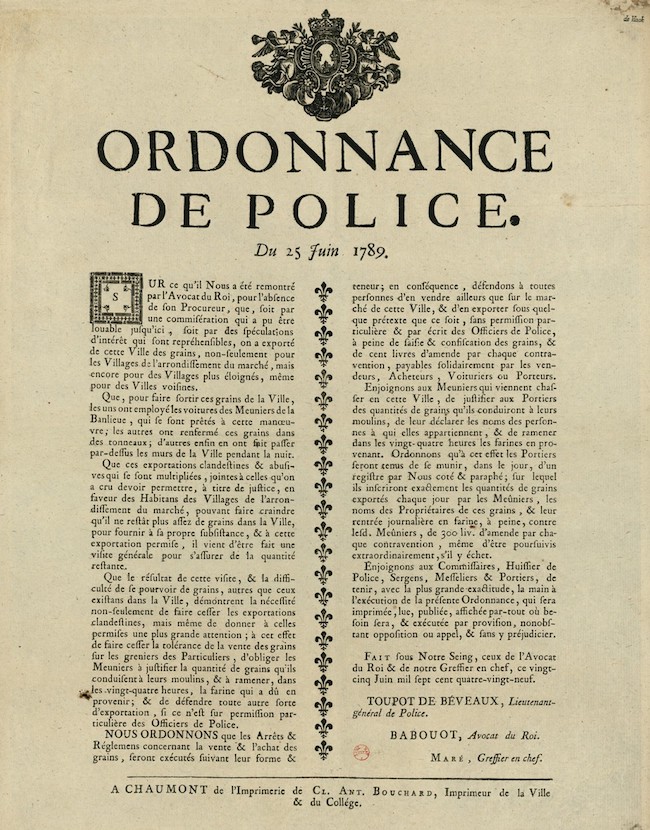
Mais ce compromis se révèle fragile lorsque les idées de liberté individuelle et de garantie des droits quittent les tables de travail des philosophes pour atteindre la sphère publique. La surveillance préventive devient pur despotisme sur une société qui aspire à s’émanciper des cadres collectifs contraignants de l’Ancien Régime. Beaucoup hésitent encore entre deux mondes. Des observateurs comme Louis-Sébastien Mercier ou le libraire Hardy témoignent d’une attitude ambivalente vis-à-vis de la police, louant sa capacité à contraindre une « populace » dangereuse, tout en dénonçant son rôle dans la répression des revendications du Parlement. Lorsque les revendications atteignent les fondements de l’organisation sociale de l’Ancien Régime, le compromis noué entre la police et les Parisiens depuis le début du XVIIIe siècle s’effondre et la légende noire d’une police purement despotique peut naître. Exilé loin de Paris dès les débuts de la Révolution, l’ancien lieutenant de police Lenoir voit avec chagrin s’élever des critiques dont il ne peut relever que les excès, impuissant à justifier son « admirable » police, reflet d’une époque révolue.
En définitive, le XVIIIe siècle parisien témoigne de l’équilibre atteint à un moment donné entre les techniques policières et les attentes sociales, mais aussi de la fragilité de cet équilibre toujours à reconstruire, ce qui n’a pas été sans peine depuis la Révolution. À une époque où les critiques contre la police se multiplient, cet exemple historique invite à réfléchir, au-delà des positions partisanes, sur ce qui fonde le lien entre police et société.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

