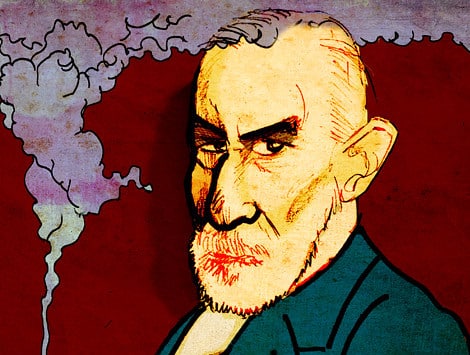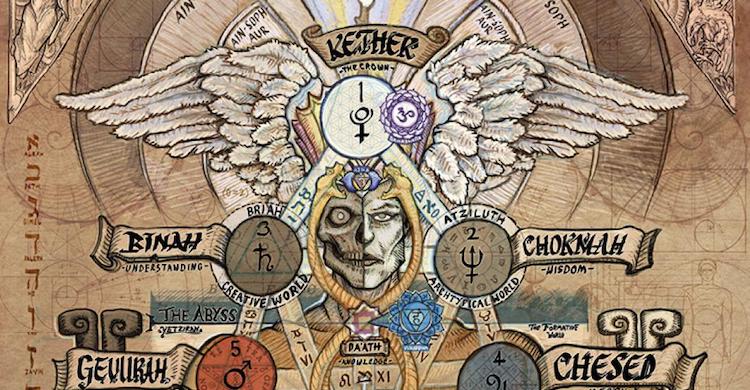Dans le sillage de son grand livre sur la psychanalyse, publié en 2013 aux éditions Thierry Marchaisse et repris en « Folio » en 2017, La Psychanalyse: Science, thérapie – et cause, Moustapha Safouan a répondu aux questions d’En attendant Nadeau sur sa pensée et son expérience de l’analyse.
Dans le sillage de son grand livre sur la psychanalyse, publié en 2013 aux éditions Thierry Marchaisse et repris en « Folio » en 2017, La Psychanalyse: Science, thérapie – et cause, Moustapha Safouan a répondu aux questions d’En attendant Nadeau sur sa pensée et son expérience de l’analyse.
Né en 1921 à Alexandrie, Moustapha Safouan a quitté l’Égypte à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire des études à Paris. Disciple de Lacan, avec qui il a commencé une analyse de contrôle en 1949, il a écrit depuis cette époque près d’une quinzaine d’ouvrages traitant aussi bien de questions théoriques – l’Œdipe, la castration, la fonction paternelle – que de questions techniques portant sur le transfert, la transmission et la formation des analystes.
Au sein de cette production, retenons La sexualité féminine dans la doctrine freudienne (Seuil, 1976), Jacques Lacan et la question de la formation des analystes (Seuil, 1983), La Parole ou la Mort (Seuil, 1996 ; édition revue, 2010) et l’important Pourquoi le monde arabe n’est pas libre : Politique de l’écriture et terrorisme religieux, qu’il a écrit en anglais et qui a été publié par Denoël en 2008. L’histoire de la traversée des langues que ce livre raconte est fascinante : les textes ont été écrits en arabe (mais pour moitié en arabe classique et pour l’autre en arabe égyptien), puis repris et auto-traduits en anglais, et traduits par d’autres en français, mais encore une fois repris et avec une nouvelle préface.
Cela donne une idée du texte comme étant une production jamais définitive, toujours à reprendre, toujours en voyage, qui est un éloge de la mobilité de la pensée, à l’inverse de la pensée arrêtée ou systématique. La traduction, la reprise, sont aussi des manières de lutter contre la domination. Car Moustapha Safouan est aussi traducteur : il a notamment traduit en arabe L’interprétation des rêves de Freud et en démotique égyptien Othello de Shakespeare. On peut dire de Moustapha Safouan qu’il est, terme qui peut paraître un peu désuet aujourd’hui, un lettré possédant dans diverses langues – l’arabe, le français et l’anglais – une immense culture psychanalytique et philosophique. Il a reçu chez lui, rue Guénégaud, Michel Plon et Tiphaine Samoyault, qui l’ont invité à reprendre tous ces thèmes.

Moustapha Safouan
Michel Plon : J’aimerais commencer par une question très générale. Où en est selon vous la psychanalyse aujourd’hui, aussi bien dans le monde qu’en France ? À la fin de votre livre sur la psychanalyse paru en 2013, vous semblez penser que, du point de vue de la théorie, cette histoire est terminée.
La psychanalyse, c’est l’histoire du complexe d’Œdipe et l’histoire du complexe d’Œdipe, c’est l’histoire de la famille. J’ai en projet un livre sur les avatars du complexe d’Œdipe, liés à l’évolution historique de la famille. On peut dire que dans le milieu des chasseurs-cueilleurs, la famille était non problématique : le fils voyait devant lui que son père était vraiment le signifiant du désir maternel et il s’apprêtait à vivre selon la même méthode. Avec la révolution agricole, naît le patriarcat, qui entraîne en quelque sorte la deuxième naissance de l’Homo erectus : au lieu de dépendre de ce que la terre donne, on produit cette terre. La justice romaine, par exemple, s’arrête à la porte de la maison. À l’intérieur, c’est la loi du patriarche. Et si le patriarcat n’a pas été une folie (car c’est une folie que de remettre un tel pouvoir, la loi, à quelques-uns), c’est parce qu’on a bâti, à côté de la maison, le temple. On a imposé le tiers devant lequel nous sommes tous égaux. Dans ce contexte, l’Œdipe a très bien marché puisqu’un fils, quelle que soit la tension entre lui et son père, devient le gardien de l’histoire et du nom de l’ancêtre, avec la protection également de l’égalité devant Dieu.
Les choses ont changé avec la révolution industrielle : d’abord, le père n’a presque plus rien eu à transmettre, la maison a cessé d’être un atelier, la mère a commencé à travailler dans les usines, la famille s’est coupée des sociétés. Le cadre de la famille n’a plus été le social mais l’État, or l’État limite l’autorité parentale. Ce vide absolu a entraîné la vogue des psychanalystes. Nous sommes venus pour remplir ce vide. À ce moment-là, comme la famille s’est vue composée d’individus qui n’avaient plus rien en commun (ni croyance commune, ni transmission), la tension entre le père et le fils a éclaté. L’histoire de la faillite des pères a éclaté d’une façon inimaginable avec les destructions du XXe siècle. Les camps, le génocide : les enfants ont vu des choses qu’on n’aurait jamais pu imaginer.
On a trouvé le complexe d’Œdipe – c’est la découverte de Freud – quand le père était encore là, mais il n’aura pas lui-même duré bien longtemps. De ce point de vue, nous sommes donc à la fin de la psychanalyse.

« Œdipe et le sphinx » de François Xavier Fabre (1808)
Tiphaine Samoyault : Parce que, pour vous, la fin du complexe d’Œdipe c’est la fin de la psychanalyse ?
En tout cas, c’est la fin de ce à quoi l’analyse avait affaire jusqu’à présent, aussi bien du point de vue thérapeutique que du point de vue didactique : dans tous les cas, on avait affaire à des analyses d’œdipes échoués, à des cas où la normalisation œdipienne avait raté, pour des raisons plus ou moins graves…
Michel Plon : À la fin du livre, vous laissez entendre avec un soupçon d’ironie que la théorie, elle, demeurera, comme faisant partie du patrimoine de la pensée, mais qu’en ce qui concerne la pratique c’est une autre affaire
Ce qui reste, ça aura été quand ça passera (mot de Lacan), c’est en effet la théorie et celle qui a mis l’accent sur le parlêtre. Lacan a transformé radicalement le complexe d’Œdipe en définissant le désir par le désir de l’Autre et en faisant de l’Autre un lieu du langage, dont la mère est la première à occuper la place.
Tiphaine Samoyault : L’importance du parlêtre nous conduit à la question de la langue et à celle de la traduction. Vous avez traduit vers l’arabe classique L’interprétation des rêves de Freud. Comment la langue arabe s’ouvre-t-elle au mode de pensée de la psychanalyse ?
Ce sont les circonstances, avec ce qu’elles comportent de surprise et d’inattendu, qui m’ont conduit à traduire ce livre. Je rentrais pour des vacances en Égypte en décembre 1953. C’était juste après la première séance de la Société française de psychanalyse (SFP), après la division. Avant, j’avais assisté à tout le drame de cette division et de cette séparation d’avec la Société psychanalytique de Paris (SPP). Lacan avait son premier séminaire à Sainte-Anne. Je me rendais donc en Égypte pour retravailler et ce fut le coup d’État de Nasser, qui a rendu tout travail impossible car on ne pouvait même pas acheter un livre et, en outre, il n’y avait plus de visa de sortie. Le seul moyen pour sortir était de travailler à l’Université pendant cinq ans, ce qui devait me donner le droit à un congé d’études me permettant d’obtenir ce visa de sortie. Alors j’ai profité des cinq ans que j’avais devant moi pour traduire Freud. Greimas était en Égypte et partageait avec Charles Singevin un véritable intérêt pour la psychanalyse et pour les écrits de Lacan sur le langage. Nous avons donc constitué un groupe, auquel participait aussi Hilde Zaloscher, une historienne yougoslave, spécialiste de l’art chrétien en Égypte, en particulier des portraits du Fayoum. Elle avait fait ses études à l’université de Vienne, elle était allée chez Freud, et elle m’a beaucoup aidé pour la langue, notamment pour comprendre certaines expressions très courantes de Freud. Et puis, grâce à elle, j’ai compris un rythme, celui de l’allemand qui coule comme de l’eau de source. J’ai commencé à traduire en voulant atteindre la même fluidité en arabe. Pour cela, je testais dans le salon que tenait mon père les histoires que racontait Freud, exposant par exemple l’histoire de l’homme qui vous donne des bouteilles et qui vous empoisonne avec, et, si je voyais rire les amis de mon père disant : « c’est exactement comme chez nous », alors je savais que j’avais atteint mon but.

Jacques Lacan
C’est le livre le plus vendu en arabe, de Beyrouth au Maroc. Mais je n’ai pas touché un sou. Il a été publié par la Maison de la Connaissance Dar al-Maaref, fondée par les chrétiens maronites au Liban, qui ont fait les premiers grands dictionnaires modernes. J’avais envoyé un mot à Anna Freud pour lui dire que le texte était enfin disponible en langue arabe. La seule réaction qu’elle a eue a été de demander à la Hogarth Press de réclamer des droits à l’éditeur. L’Égypte ne faisait pas partie d’un accord global sur le droit d’auteur !
Michel Plon : Anna Freud ne vous a jamais répondu personnellement ?
Non c’est le seul écho que j’ai eu d’elle ! Pour revenir sur cette traduction, je dirais que je n’ai pas rencontré de problème de style ou de vocabulaire, mais que tout était une question de ton car chaque histoire a son ton dans L’interprétation des rêves. Il y a beaucoup d’éléments concrets sur lesquels on doit s’appuyer. La seule difficulté, ce fut pour traduire le terme « identification » : il a fallu inventer le mot en arabe. Depuis la traduction de ce livre, beaucoup de psychologues ont entrepris de faire un vocabulaire arabe de la psychanalyse. Mais moi, lorsque je traduisais, il n’y avait rien.
Le mot « conscience » n’existe pas en arabe, pas plus, dès lors, qu’« inconscient ». On a utilisé un mot qui veut plutôt dire « sentiment ». Ma solution fut de faire des notes expliquant les termes qui n’existaient pas en arabe. Mais c’est surtout ces deux mots-là qui manquaient, et toute la gamme des termes forgés autour de « conscience » : conscience de soi, inconscient… À la vérité, le mot même de sujet n’existe pas en arabe. Sauf pour l’analyse grammaticale, mais on utilise un mot qui veut dire « le premier de la phrase ». « Le premier » n’est pas le « sujet ». J’ai pris le mot qui veut dire « un tel », ou « le même ».

Alexandrie, où est né Moustapha Safouan en 1921.
Tiphaine Samoyault : Aviez-vous lu Freud pendant vos études ? Dans quelle langue ?
J’ai toujours vécu dans un milieu très littéraire : on était noyés dans les lettres. Le milieu de mon père était extrêmement spirituel. Comme lui, ses amis étaient passionnés par les grandes œuvres de la littérature arabe classique, sans doute en réaction à l’occupation anglaise. Mais ils étaient très ouverts aux sciences européennes, en particulier celles qui étaient nouvelles. Ce qui caractérisait aussi ces êtres, c’était moins l’érudition que la créativité qu’ils manifestaient avec leurs bons mots. Cette époque a d’ailleurs été désignée par un vocable assez difficile à traduire (‘asr alzorafaa) qui cumule les deux sens de « lettré » et de « lutin ». Un jour (j’avais entre dix et douze ans), un des amis de mon père a ouvert son parapluie en plein soleil. Un autre a manifesté son approbation par un mot qui a déclenché des rires bruyants. Je n’en comprenais pas la raison jusqu’à ce que je me rende compte que le vocable renvoyait à une racine de trois consonnes qui, en arabe dialectal, conjuguait les sens d’ombre et de faute. Il disait un remerciement ambigu : pour donner de l’ombre et aussi pour nous avoir égarés. Mon éducation a été ainsi très marquée par le mot d’esprit et par le double sens. On avait des traducteurs inouïs à l’époque. Ensuite, le régime de Nasser a muselé cette classe intellectuelle et spirituelle.
Tiphaine Samoyault : Dans Pourquoi le monde arabe n’est pas libre, vous décrivez les mécanismes de la domination. Vous montrez que si le monde arabe n’est pas libre, c’est qu’il est doublement contraint : par la dichotomie entre langue classique, écriture, et langue vernaculaire, qui rend difficile, voire impossible, l’accès des non-lettrés à la culture religieuse et lettrée ; et par la domination occidentale, comme vous l’expliquez très bien dans la préface à la traduction du Discours de la servitude volontaire de La Boétie, « Les facteurs de la domination occidentale », texte repris comme premier chapitre de Pourquoi le monde arabe n’est pas libre. Voyez-vous l’oppression au cœur de la langue ou bien sont-ce des usages de la langue qui asservissent selon vous ?
Je ne vois pas en quoi la langue serait oppressive. C’est l’appropriation de la langue qui l’est. Avec l’islam, la coupure de l’écriture s’est aggravée. À l’époque des pharaons, on écrivait la langue qu’on parlait. Mais avec l’islam, on ne se mit à écrire que la langue du Coran et on cessa d’écrire la langue qu’on parlait. La langue a été sanctifiée. Aujourd’hui, aucun régime arabe (de l’Arabie saoudite au Maroc) n’acceptera jamais d’enseigner l’arabe parlé : seule la langue de Dieu a une grammaire. Du même coup, cela assure le pouvoir politique, ce qui arrange bien l’Occident. En Égypte, nous sommes un peuple où peu de gens savent lire un journal mais où domine la fatuité de l’esprit religieux. Un Libyen m’a dit un jour : « Quelle merveille, Dieu a fait faire tout ça (les avions, les machines à laver, les maisons…) pour que nous en ayons la jouissance… »

« Othello et Desdémone à Venise » par Théodore Chasseriau (1850)
Michel Plon : Tu as aussi traduit vers l’arabe vernaculaire égyptien Othello. Qu’est-ce que cette traversée des langues apporte à ton travail analytique ? Pourquoi as-tu choisi Othello ? Ce choix peut nous conduire à la question de la femme et de la féminité : sur le versant culturel, la femme dans le monde arabe, et sur le versant de la psychanalyse, ce qu’il en est de la sexualité féminine et au-delà.
J’ai sans doute choisi Othello parce que le personnage est arabe et porte un nom arabe. Le thème me paraît en outre plus facile à suivre que ceux des pièces historiques de Shakespeare. Hamlet évoque un univers culturel trop différent. Je voulais traduire Othello dans une langue vulgaire pour donner la preuve qu’on peut faire une littérature de cette langue-là, qu’elle n’est pas faite que pour injurier les voisins ! Le résultat a été un désastre parce que personne ne lit dans ce pays. Le livre ne s’est pas vendu. La pièce a été jouée, mais la scène de mariage a été jouée avec des danses du ventre, etc., de façon tout à fait ridicule.
La place de la femme, la question de la jalousie, sont aussi ce qui m’a intéressé dans cette pièce. En Égypte, depuis les années 1920, la femme (la femme bourgeoise) a commencé à sortir de la maison. Nawal el Saadawi a introduit le mouvement féministe, mais elle a rencontré des résistances pour former un véritable mouvement car les Égyptiens n’ont pas de tradition du travail en commun. L’étatisme empêche de travailler ensemble. Mais elle a eu quand même beaucoup d’influence. À l’heure actuelle, on voit des femmes dans tous les services. Il y a eu une émancipation, mais qui ne touche qu’une seule classe, la plus occidentalisée. À la campagne, même si la femme a toujours travaillé, la séparation s’est maintenue entre les hommes et les femmes. Cela s’est accentué avec l’augmentation du chômage. Sur le plan sexuel, c’est certainement une société narcissique ; le harcèlement sexuel existe très largement dans ce pays. Il doit y avoir une différence énorme entre Égypte et Liban. Le Liban est plus prospère, il y a moins de chômeurs, plus d’éducation, l’esprit de la ville domine. En Égypte, les choses sont plus violentes, ce qui est dû à une certaine ignorance culturelle et au chômage.
Michel Plon : Mais en France ? Qu’en est-il des mutations de la famille et des défis qu’elles posent ? Comment la psychanalyse se positionne-t-elle aujourd’hui par rapport à ces mutation sociales, à la question du couple homosexuel, à celle de l’adoption par ces couples ? Vous savez comme moi combien cette question fait débat dans le milieu psychanalytique mais, en même temps, c’est un débat clôturé, fermé.
Ce qui change, c’est que ce qui s’appelle la main invisible du marché a englobé l’enfant. L’enfant est devenu un objet mercantile. Vous achetez le sperme, les ovules, la mère porteuse… Cette industrie, qui pèse déjà lourd dans le marché mondial, transforme les enjeux de l’analyse (et la justice aussi), elle transforme tout ce qui fait la culture. On pourrait dire qu’il n’y a qu’une seule chose dans laquelle la culture n’est pour rien : c’est que l’enfant vient du ventre de sa mère. La reconnaissance par le père, c’est l’esprit même de la culture. Quand le père devient démontrable biologiquement, on quitte la sphère de la reconnaissance, donc on transforme profondément la culture. Le juge lui-même ne sait plus qui est le père : est-ce celui qui a reconnu l’enfant ou celui qui est démontré biologiquement ?
Michel Plon : Les psychanalystes prennent-ils la mesure de cette transformation ?
Non, ils font silence là-dessus. Ils continuent comme si le monde extérieur n’avait pas changé depuis Freud. Il y a un débat très sourd entre ceux qui disent qu’il faut étudier les transformations sociales et ceux qui disent que rien n’a changé. Le seul qui a fait attention, ne serait-ce qu’aux phénomènes de la modification des demandes faites aux analystes, c’est André Green. On ne s’adresse plus seulement à nous pour des névroses, des phobies, des obsessions, des hystéries, mais pour des états borderline, comme l’homme aux loups, c’est-à-dire des analysants ou des analysantes susceptibles de traverser une crise psychotique au cours de l’analyse.

Le cabinet de Jacques Lacan
J’ai d’ailleurs une théorie là-dessus : dans l’état borderline, il n’y a pas forclusion du nom du père, mais forclusion de la métaphore paternelle, ce qui fait qu’il n’y a pas le manque de l’intégration de l’ordre symbolique. À l’âge de l’Œdipe, le père de l’homme aux loups était un mélancolique, un absent ; il ne pouvait donc pas travailler comme signifiant du désir maternel. C’est ma théorie sur le borderline
L’insouciance de certains psychanalystes que vous pointez me paraît parfaitement juste. Sous prétexte que les structures ne changent pas, que les névroses, psychoses ou perversions ne changent pas, il ne serait pas nécessaire de prendre en compte les changements du monde. Comme nous sommes tous les enfants de la même époque, est-ce que les analystes eux-mêmes ne sont pas borderline en grande partie ?
Michel Plon : Dans votre livre, un point qui peut apparaître très technique, mais qui à mon avis n’est pas seulement technique : vous dites qu’il n’y a pas de fin de l’analyse.
Quand il y a un travail, on doit bien penser qu’il va quelque part. Mais vers quoi ? Les avis sont partagés. Pour Melanie Klein, cela va vers l’assomption de la séparation. Lacan, à cette occasion, a fait une distinction entre la dépression symptôme et le deuil authentique. Il peut y avoir aussi le fait d’assumer l’être pour la mort, mais finalement la fin est quand même la castration symbolique, et pour arriver là il faut traverser quelque chose qui s’appelle le fantasme fondamental. Selon l’analysant, selon son histoire, tel aspect dominera. Une autre fin peut être encore la chute du sujet supposé savoir, la chute de celui dont j’imagine qu’il va me dire ce que je suis. Donc il y a bien des fins, mais l’idée de mener son analyse jusqu’à sa fin est une fausse question. On peut d’ailleurs compter sur les doigts de la main les cas où l’on peut dire qu’il y a eu assomption de l’être pour la mort ou traversée du fantasme fondamental.
Michel Plon : Qu’en est-il aujourd’hui de la passe, cette procédure inventée par Lacan et qu’il reconnut par la suite être un échec ? Quelle est votre position sur le devenir de cette procédure ?
L’idée de Lacan avec la passe était de sortir définitivement du conflit né en 1926 autour de la question de l’analyse profane, l’analyse pratiquée par des non-médecins. Pour Lacan, la scientificité de la psychanalyse était un horizon et la passe un moyen d’y accéder : la passe était une réponse psychanalytique à la question de la formation des analystes et donc à celle de la transmission. La psychanalyse didactique par laquelle s’effectue la transmission ne relève d’aucun diplôme, d’aucune formalité institutionnelle extérieure à la psychanalyse. Lacan voulait que la psychanalyse soit bien distinguée d’une quelconque forme de sacerdoce, d’où l’introduction qu’il fit de la dimension du désir, le désir de l’analyste comme point d’aboutissement de la didactique et donc différent du désir d’être analyste que peut manifester un sujet au début d’une analyse. Lacan fut le premier à percevoir que le désir de l’analyste relève de l’ordre de la vérité. En juillet 1978, Lacan a tiré la leçon de l’expérience de la passe en déclarant que la psychanalyse est intransmissible. La mise en œuvre de la passe dans le cadre de l’EFP [École freudienne de Paris de Psychanalyse] entre 1968 et 1980 n’a pas donné une quelconque élaboration du savoir : le bilan a été nul, d’où le verdict de Lacan que la passe était « un échec ». La passe n’a apporté aucune réponse quant aux raisons qui pouvaient pousser un analysant à exercer ce « métier impossible » qu’est la psychanalyse, d’où cette autre conclusion de Lacan selon laquelle la passe n’a rien à faire avec la psychanalyse. L’idée ne rimait à rien car, dans une analyse, il s’agissait de finir le travail que l’échec de la normalisation au début laissait en chantier. Parce que ce qui fait les névroses, c’est quand même que l’objectivation nuit au sujet. Je veux dire qu’on peut faire un travail sur le malheur pesant qu’entraînent les tentations du don, avec tout ce que comprend le fait de se méprendre. On cherche à modifier le mode d’existence d’un sujet, à pouvoir le faire exister pour qu’il n’ait pas de pouvoir sur le désir de l’autre.

Mélanie Klein (1945)
Tiphaine Samoyault : Ce qu’Othello ne comprend pas…
Au regard du désir, le don apparaît toujours comme mesurable et intéressé, il paraît petit confronté au désir. Othello est possédé par une névrose de possession et de contrôle absolu. De celui qui refuse que le désir soit un don.
Tiphaine Samoyault : Une des manières de lutter contre le rationalisme réducteur peut être encore une fois le recours à d’autres langues. Vous intégrez des termes arabes dans votre discours sur la psychanalyse. Par exemple, vous dites la force d’un terme comme al-mourid en arabe qui veut dire le disciple et qui signifie littéralement le « désirant » ou le « voulant ». Pensez-vous que des termes arabes pourraient modifier la langue de la raison, qu’ils seraient utiles pour penser autrement ?
L’élève, l’étudiant, c’est en effet celui qui veut. Cela se dit surtout quand on s’adresse à un maître. « Al-mourid », c’est ce que j’étais pour Lacan. Je me suis intéressé à la langue et aux langues. Quand j’ai quitté l’Égypte, je voulais aller à Cambridge pour rencontrer Wittgenstein. Mais je suis venu à Paris, je suis tombé névrosé ici à Paris car je n’avais pas de rapports de proximité avec les professeurs. Ma chance a été d’aller en analyse chez Marc Schlumberger. J’étais ami avec un Égyptien qui voulait écrire une thèse sur le langage chez Husserl. Grâce à lui, j’ai côtoyé Bachelard, qui a parlé un jour d’un jeune psychologue n’ayant pas la réputation qu’il méritait (Lacan). Je suis alors allé à la Société psychanalytique de Paris, en 1947, et Lacan m’a tout de suite intéressé car il était le seul qui parlait de langage ; il parlait de la parole, ce qui fait que j’ai commencé à penser qu’il y avait quelque chose à faire en France. Dans le monde anglo-saxon, on parlait du langage mais pas de la parole. Je lui ai demandé un contrôle. Il m’a demandé de parler de ma provenance, et lorsque je lui ai dit que quand j’étais né mon père était en prison, il a dit, de façon très sympathique : « alors vous avez été élevé par des femmes ! » Je lui ai dit non, j’avais un troupeau d’oncles !
De tous, c’est de lui que j’ai reçu le plus. Pour lui, tout ce qui s’appelle différence, quelle que soit sa place sociale, est intéressant. Chacun n’a que le poids que lui donne sa parole. On n’avait, de part et d’autre, aucune thèse à défendre.
Michel Plon : Est-ce qu’à la fin de sa vie il n’a pas été enfermé dans les difficultés de son école ?
Oui, c’est sûr. Il voulait des psychanalystes sauvés de la psychologie ou du comportementalisme, il était devenu militant. Or on ne peut pas être psychanalyste et militant. On ne peut pas mener une analyse tout en ayant le désir affiché de quelque chose. Il a été victime de ce dont il avait fait une cause. Son rêve d’une école purement psychanalytique échappant aux effets institutionnels, aux luttes de pouvoir, à tous les effets de prestance, s’est révélé être effectivement un rêve : il a été tenté d’affirmer par divers moyens un pouvoir, une autorité autre que celle que lui donnaient son œuvre et son enseignement, et cela a suscité des résistances, des luttes internes. Sans doute y a-t-il un lien entre cet échec-là et ce qui fait suite à la dissolution de l’École, à savoir une division incessante entre groupes, associations, écoles, dont les membres se réunissent invariablement autour d’un guide, d’un chef censé les guider vers on ne sait quel paradis.