Publié pour la première fois en 2010 sous le titre The New Jim Crow : Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, La couleur de la justice de Michelle Alexander est aujourd’hui disponible en français. Portrait sans retenue du racisme institutionnel aux États-Unis, depuis l’esclavage jusqu’à Obama, un propos qui résonne avec force dans l’Amérique de 2017 et paraît plus que jamais d’actualité, car condamné à l’immobilité politique.
Michelle Alexander, La couleur de la justice. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Anika Sherrer. Syllepse, 364 p., 17 €
Tout commence par l’esclavage, ou plutôt par sa fin. Michelle Alexander le précise immédiatement : « Cela fait plus de cent ans que les chercheurs soulignent le caractère illusoire de la proclamation d’émancipation. » Le ton est donné : à l’ombre du roman national, le récit explore un système de castes raciales constamment redéployé. « Il y a quelques siècles, ce pays mettait aux fers ceux qu’il ne considérait pas comme des êtres humains ; il y a moins de cent ans, il les reléguait de l’autre côté de la ville. Aujourd’hui il les met en cage. Une fois libérés, ils s’aperçoivent qu’une main cruelle et lourde s’est abattue sur eux. »
En effet, quatorze ans seulement après la proclamation d’émancipation, apparaissaient les lois Jim Crow, du nom d’un comédien blanc qui se grimait en noir pour faire le saltimbanque dans les minstrel shows racistes. Le système de ségrégation raciale que ces lois mettaient en place empêchait à la fin du XIXe siècle les Noirs de s’asseoir à l’avant du bus, de boire dans les mêmes fontaines, de dîner dans les mêmes restaurants que les Blancs. Des lois qui furent abandonnées en 1964, date à laquelle la discrimination institutionnelle disparaît officiellement en Amérique. « Tout observateur impartial des États-Unis est forcé d’admettre que le racisme a une très grande capacité d’adaptation », anticipe l’auteur.
Son postulat est le suivant : « la guerre contre la drogue est le nouveau Jim Crow ». La ségrégation raciale continuerait sous le visage de la lutte contre un type particulier de criminalité. Évidente pour certains, complètement exagérée pour d’autres, l’idée est troublante, même si plus grand monde ne nie aujourd’hui qu’il y ait un problème avec la question de la drogue et des solutions qu’on lui apporte (selon le rapport mondial sur les drogues de l’ONU). Michelle Alexander distingue trois étapes dans le scénario mille fois répété de la situation du délinquant : capture, condamnation et « châtiment invisible » (l’impossible réinsertion dans la société).
Le livre entreprend dans le détail le récit de cette « guerre » contre une minorité, déclenchée officiellement par Nixon mais portée à son paroxysme par Reagan qui la lance en 1982, quand seulement 2 % des Américains la considèrent comme le problème le plus important de la nation, avant de se structurer sous Bill Clinton, notamment, dans les discours comme dans les esprits. L’administration Reagan, puis Bush, va revaloriser les budgets des organisations comme la Drug Enforcement Administration (DEA, de 86 millions à 1 026 millions) et le FBI (de 38 à 181 millions). Entre 1981 et 1991, le budget du ministère de la Défense pour la lutte contre la drogue est passé de 33 à 1 042 millions de dollars. Les descentes se font dans les quartiers défavorisés en priorité.
Parmi les généraux de cette « guerre » menée sur le sol américain, Robert Stutsman, agent de la DEA en poste à la direction de son bureau new-yorkais, est chargé par le gouvernement de « consolider le soutien de la population », en apparaissant dans les médias pour « alerter » sur le problème. Michelle Alexander rapporte d’ailleurs un propos assez édifiant de ce Stutsman : « J’ai commencé à faire du lobbying auprès des médias. Ils ne demandaient qu’à coopérer […] le crack était le sujet de reportage le plus chaud depuis la fin du Vietnam ». L’idée étant de n’orienter le regard que sur le ghetto, en oubliant que la drogue touche toute la société dans des proportions remarquablement similaires. Le discours médiatique se construit, ainsi des « crack whores » aux « crack babies », alors que la disparition des emplois industriels permet à la crise économique et sociale de se développer dans les ghettos. Michelle Alexander n’accuse pas les médias d’être autre chose que sensationnalistes et manipulés par le politique, elle présente d’ailleurs des exemples allant dans ce sens. « D’octobre 1988 à octobre 1989, le Washington Post publie à lui seul 1 565 papiers consacrés au fléau de la drogue ».
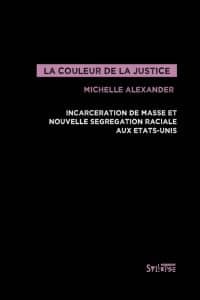
Deuxième soutien, les juges : à Washington, la Cour suprême trouve différents stratagèmes pour permettre aux policiers d’enfermer des petits délinquants. Le quatrième amendement de la Constitution américaine dispose : « Le droit des citoyens d’être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé ». Aucun problème ! la plus haute juridiction des États-Unis autorise sa police à contourner cet amendement, notamment par la règle du « Stop and Frisk » qui permet d’arrêter quelqu’un sans raison apparente et de le fouiller. Si le citoyen ne donne pas son consentement, le policier ne peut rien faire. Mais personne ne le sait, donc tout le monde accepte. Et c’est suite à cette ignorance que près de 80 % des arrestations pour drogue ont été réalisées entre 1982 et aujourd’hui.
De fait, si « ce pays [les États-Unis] affiche fièrement un taux d’incarcération six à dix fois supérieur à celui des pays industrialisés », c’est bien que les protections des citoyens face à la force de la loi sont beaucoup plus faibles que ne le laisserait penser l’image magnifiée par les séries télévisées : très peu de condamnés ont un avocat, même commis d’office, beaucoup d’innocents plaident coupable pour accélérer les procédures, etc. Et la prison remplit son office : faire des condamnés des citoyens de seconde zone, une « sous-caste » : ils se voient retirer leur droit de vote, refuser les prêts bancaires, expulser. Michelle Alexander prend le temps de dresser quelques portraits de ces destins brisés, toujours édifiants.
« Imaginez que vous êtes […] une Africaine-Américaine de trente ans, célibataire et mère de deux enfants et que vous vous faites arrêter. […] vous êtes innocente […] au bout d’une semaine passée en prison vous n’avez plus personne à qui confier vos enfants […] votre avocat commis d’office vous convainc de plaider coupable de vente de drogue […] au bout d’un mois de prison, vous décidez de plaider coupable pour pouvoir rentrer chez vous […] vous vous retrouvez condamnée à dix ans de mise à l’épreuve et 1 000 dollars d’amende […] Désormais ‟délinquante pour drogue” vous ne pouvez plus bénéficier de coupons alimentaires ; vous risquez de faire l’objet de discrimination à l’embauche, vous êtes déchue de votre droit de vote pour au moins douze ans et vous serez sur le point d’être exclue de votre logement social. Quand vous serez à la rue, vos enfants vous seront retirés et placés en famille d’accueil ».
Vers la fin de l’essai, le ton du livre se durcit, comme si l’auteure perdait son calme. On regarde les budgets exploser, tout comme le nombre de prisonniers (+ 1 100 % d’incarcération pour drogue entre 1985 et 2000 ; en 2005, les quatre cinquièmes des arrestations étaient liées aux stupéfiants). Les statistiques sont confondantes : entre 1982 et 2005, et exception faite de la marijuana, les chiffres de consommations de drogue sont plus élevés chez les Blancs que chez les Noirs, toutes drogues confondues. Il y aurait en moyenne autant de dealers blancs que noirs, autant de deal dans les quartiers riches que pauvres. Pourtant, 80 % des prisonniers dans cette guerre sont pauvres et noirs. Une politique qui se poursuit gouvernement après gouvernement, malgré les tentatives des électeurs d’en enrayer le mouvement. « La politique de fermeté envers le crime de l’administration Clinton a eu pour conséquence l’augmentation la plus forte en nombre de détenus dans les prisons fédérales et d’États jamais observée pendant un mandat présidentiel aux États-Unis. »
La couleur de la justice pourrait aller plus loin et Michelle Alexander semble frileuse par moments : elle mentionne en passant les liens entre CIA et trafiquants nicaraguayens qui inondèrent les ghettos avec le crack, fait relativement bien connu et qu’elle ne développe pas. De la même manière, elle rappelle les immenses intérêts financiers de Dick Cheney dans les prisons privées, et ne développe pas. Elle dresse d’ailleurs une longue lise de « profiteurs de ce système ». A contrario, malgré une ambition « scientifique » affichée, elle semble soutenir la qualification de génocide : « Le terme qui paraissait autrefois choquant a aujourd’hui tout son sens ». Même un public informé sera gêné par quelques sentences définitives et caricaturales de ce genre.
Les solutions proposées sont intéressantes : la légalisation du cannabis et de « pourquoi pas toutes les drogues », l’affirmation plus complexe de la race et de ses différences (l’auteure plaide contre l’indifférence à la couleur : « dire que l’on ne se préoccupe pas de la race est présenté comme une vertu disculpatoire alors qu’en réalité ce peut être une forme de cruauté »), la rénovation du système judiciaire, notamment des peines, l’idée de la fin des prisons, etc. Et surtout : « Il ne nous faudra pas céder à l’illusion que nous allons ébranler les fondations de l’ordre racial actuel […] il s’agit d’entamer une conversation ».

Par sa focale sur le temps long, l’auteure se force à un examen de conscience. Comment juger les mandats Obama ? Comment parler de la question de la race sans mentionner le fait qu’un mirage fait perdre de vue à tout le monde qu’il y a là encore un véritable sujet ? Comment ne pas embarrasser le premier président noir avec ces questions, tout en gardant à l’esprit que rien n’a changé ? Un président qui est à la fois le plus puissant des symboles et qu’il ne faut surtout pas résumer à sa couleur. Et comment régler les problèmes dont il est ici question, si le président, ancien militant de ces idées, n’est pas en mesure d’agir sur elles ? C’est le moment où Michelle Alexander a moins recours aux statistiques, où elle mentionne les lanceurs d’alerte de cette politique de caste raciale, les rappeurs (elle cite même son préféré, Common), Martin Luther King, évidemment, mais aussi Bill Cosby (le livre a été publié aux États-Unis avant les accusations de pédophilie contre le comédien) ou Sydney Poitier.
On sent tout l’égarement d’une nouvelle génération de militants qui ne sait plus trop comment mener le combat, la fatigue aussi de n’avoir aucun nouveau porte-drapeau d’envergure depuis les années 1960. La lassitude de devoir expliquer que la question de la race n’a pas disparu, ni des esprits ni des systèmes, et qu’elle constitue les vestiges d’une réalité si ancienne, que plus personne n’a les yeux pour la voir. Aujourd’hui, la situation des Noirs aux États-Unis est plus que jamais discutée, admise, mais les obstacles politiques qui se dressent devant elle évoluent à nouveau, et les moyens d’agir contre ce système restent à préciser. À la fin du livre, Michelle Alexander exhorte « les jeunes » à s’emparer de ces sujets d’une manière différente, à dépasser les anciens leaders et à radicaliser le propos. Transparaît alors toute la désillusion de celle qui espère surtout que quelqu’un ramasse ce flambeau qui gît au sol, presque éteint.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
