« Faire le garçon » : le lecteur nonchalant est en droit d’imaginer que ce titre dit tout d’emblée, presque trop. Qu’il se détrompe, le titre dissimule un livre bien plus inattendu et pénétrant que ce que sous-entend cette expression. Jérôme Meizoz, son auteur, est un écrivain suisse, formé par l’étude de la littérature et de la sociologie (il a travaillé sous la direction de Pierre Bourdieu). Il est aujourd’hui critique, professeur, spécialiste de Ramuz et auteur de récits, de proses brèves, éclatées, très étonnantes.
Jérôme Meizoz, Faire le garçon. Zoé, 150 p., 12,50 €
Faire le garçon est une de ces savantes petites fusées de papier propulsées dans le ciel du temps, qui explosent en paillettes incandescentes. Elle se compose de cent cinquante pages fragmentées et classées en deux volets : « Enquête 1, 2, 3… 30 » et « Roman 1, 2, 3… 30 », en tout soixante séquences en prose, en vers, en romain, en gras, en italique… qui forment une installation en mots, en émotions et en réflexions délicatement subversive et vertigineuse.
La séquence intitulée « Enquête » est une esquisse de biographie, celle d’un homme qu’on imagine volontiers comme le double de l’auteur. Elle démarre avec un clin d’œil à l’un des grands romans d’initiation de la littérature occidentale, Moby Dick, et son apostrophe célèbre : « Call me Ishmael ». Sous la plume anti-romanesque de Meizoz, cette invite devient : « Si ça vous chante, appelez-le “J.” N’importe quel prénom fera l’affaire. Moi, je préfère “le garçon”. » En effet, c’est une lecture possible de Faire le garçon : y voir un jeu drôle et presque sur-conscient sur le J, J comme Jérôme, J comme Je, J comme… ce que vous voulez. J est de toute façon « un être inachevé » et cette « Enquête » n’est qu’une succession d’aperçus sur son enfance, son adolescence, sa formation scolaire, civique, religieuse, sociale en général. Ce garçon sans nom n’est pas un être de papier, au contraire, c’est un être de chair, d’une sensibilité extrême, sujet d’émois qui le disputent sans cesse à la pensée, fontaine de désirs naissants, de troubles, d’interrogations, d’observations du monde et des gens alentour. La réalité le heurte, mais surtout elle ne lui suffit pas, il a besoin de plus : « Il a besoin d’inventer. »
Le volet « Roman », lui, raconte le choix de ce garçon qui gagne sa vie en étant gigolo : il propose sur internet des massages pour « femmes uniquement. Pas de rapports. Sur rdv, 11-23 heures ». Défile alors une cohorte de clientes, femmes mûres, chairs usées, solitudes mariées et lasses qui viennent s’épancher et retrouver le goût du plaisir sous les mains du garçon devenu homme. Ces séquences ne sont pas des scènes, ni des dialogues, mais des images, des captures d’écran, des sensations fortes et retenues, esquissées, rapides, l’auteur/narrateur/prostitué retire les mains au dernier moment comme s’il allait se brûler : « Il n’aime pas sonder jusque dans la viande mortelle. Trop de tristesse, après. Ni boucher ni gymnaste. Il préfère que tout se fasse en douceur. Pudeur, etc. » Etc. Que le lecteur se débrouille, jouisse, complète, glose, imagine… toujours ce « besoin d’inventer ». Le garçon, lui, « a su très jeune que la viande s’exprime » : difficile de dire plus crûment la chair triste, le « bonheur animal », la physique des sexes et la contrainte du corps.
Lequel a ses raisons, et Jérôme Meizoz n’aime pas ceux qui les nient : les pédagogues, les moralisateurs, les prêtres au sens large. Citant tour à tour un manuel anti-théorie-du-genre, une circulaire de quatre-vingts députés UMP, ou La santé des familles, un ouvrage de 1935, il règle son compte directement et définitivement à tous les discours arrêtés, clos et butés sur les questions d’identité sexuelle. Faire le garçon est un livre politique, militant, enraciné dans nos années. Ainsi s’exprime en 2017 le sociologue, l’homme blessé et l’écrivain engagé, qui, soulignons-le, cite surtout des écrivains-femmes (Simone de Beauvoir, George Sand, Annie Ernaux).
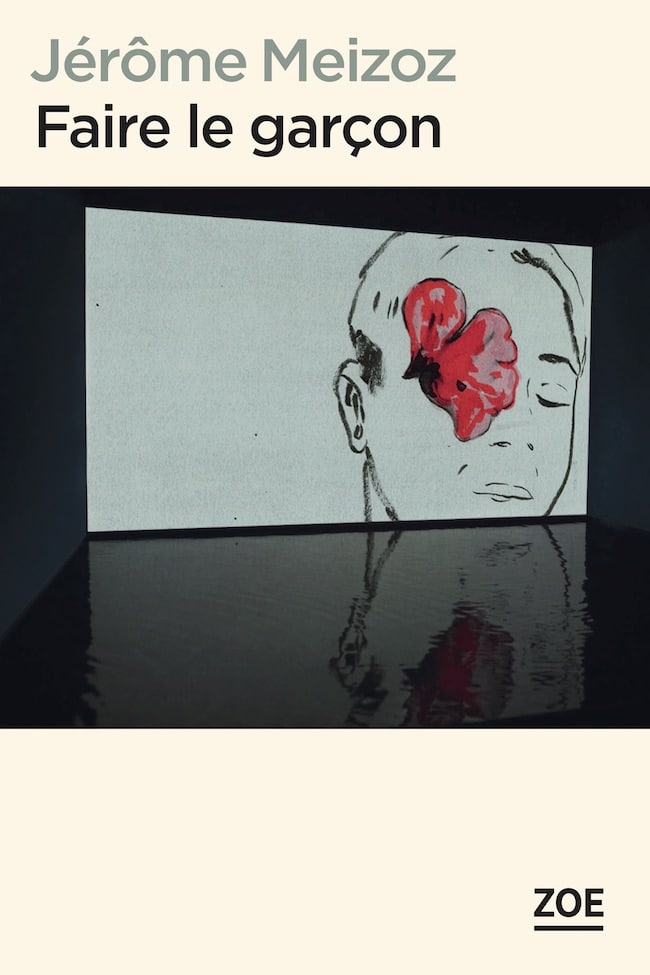
N’en concluez pas au drame ni au pathos, Jérôme Meizos a de la distance, singeant délicieusement les réflexes d’enseignants des années 1970 sous l’esquisse du professeur d’allemand du garçon, un dandy qui « lit Novalis et Goethe d’une voix en arabesques » et, « au premier arbre ou clocher, à la première bougie ou colonnade », s’exclame : « Das ist ja ein phallysches Symbol ! », que les adolescents reprennent « en chœur et sur tous les tons ». Et que dire de la voisine, que l’on dirait échappée d’un film de Tati, qui a baptisé son chien Éros et soupire dès que le garçon arrive : « Éros s’est encore échappé ! » Il y a, derrière les désarrois de l’élève Meizoz, un galopin et un gamin moqueur, qui, adulte, ne se prive pas de railler la bêtise et la vanité de la vie matérielle, souvent représentée par les maris de ses clientes malheureuses : « Le pays favorisait les êtres de ma sorte, capables de faire travailler les autres ou l’argent des autres : le droit de s’enrichir y était le plus sacré de tous […] on s’était jeté à corps perdu dans la finance, la fabrication d’armes et d’antidépresseurs ».
Faut-il pour autant réduire Faire le garçon à ce qu’il n’est pas, un roman à thèse ? Ce serait y voir un livre somme toute assez convenu, sur des sujets qui sont devenus de l’actualité la plus courante. Faire le garçon sonde beaucoup plus profondément : c’est un livre qui marque par tout ce qui est « inconvenu » en lui, irréductible à l’époque et au politique. Il touche, il vise non seulement ce qui est arbitraire suivant l’ordre social, ou suivant l’ordre des prénoms, « ces drôles d’étiquettes » dont les saints et les martyrs sont « les devanciers », mais ce qui est existentiellement arbitraire, gratuit, donné. « Comme elle est bien faite la nature que personne n’a faite ! », s’exclame le garçon gigolo qui admire les sexes et les pivoines en fleurs. C’est pourtant le même – il semble – qui souffre d’un « sentiment d’irréel », d’un regard trop incisif, à vif, qui voit aussitôt derrières les apparences, derrière les pactes, le compromis qu’on appelle « vivre », la douleur qui naît de là, le rire noir qui permet de survivre : « Le garçon voudrait fuir dans la montagne. À certains moments, trop de haut-le-cœur. C’est bizarre quand même, personne ne se révolte ici ? » Même la déesse Écho ne répond pas.
La langue de Jérôme Meizos est à la fois crue et recherchée, hyper-réaliste et exquise, faite de phrases brèves, souvent nominales, comme des vignettes, sans genre assigné, entre poésie visible sur la page et prose poétique. Elle est saisissante parce qu’elle dit ce double sentiment de beauté et de platitude, d’arbitraire et de plénitude, l’impression de néant qui accompagne l’impression d’être.
Il faut lire jusqu’à la dernière page où le garçon fuit dans la haute montagne, dans un cirque glaciaire dont le froid va l’emporter (suppose le lecteur), le temps de ne voir plus que des « clochers et clochetons, tours, chante les aiguilles, les becs, les pignes, les pointes… » des signes, des « pattes d’oiseaux happés par le ciel ». Vertige physique, sensation du rien, du gouffre, de la grande mort, voilà jusqu’où ce Faire le garçon nous plonge, ou nous élève, dans les cimes.












