Sous la plume d’un professeur d’Oxford, Matthew Reynolds, a paru l’automne dernier un petit livre sur la traduction qui fait grandement réfléchir. J’aborderai trois des points qu’il envisage.
Matthew Reynolds, Translation. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 144 p., 15 €
Première idée, sous la forme d’une question : toute opération de communication implique-t-elle la réalisation d’une traduction ? George Steiner le pense. Le premier chapitre de son Après Babel s’intitule : « Comprendre c’est traduire ». Selon Steiner, l’être humain procède à un acte de traduction « chaque fois qu’il reçoit d’un autre un message parlé. Le temps, la distance, la variété des points de vue et des références ne font qu’augmenter la difficulté [1] ». Pour Reynolds, au contraire, la traduction n’est qu’une partie de la communication.
Certes, nous n’utilisons pas, les uns et les autres, les mots d’une manière parfaitement identique et pour se comprendre il faut se livrer à d’incessantes adaptations. Mais la traduction n’est nécessaire que lorsque la compréhension rencontre un obstacle. Par le moyen de la paraphrase (synonymie non de mots mais d’énoncés entiers), je peux essayer de formuler plus clairement ce qui a laissé perplexe mon interlocuteur ; par exemple, en passant de : « Ce philosophe s’est voué à l’épistémologie » à : « Cet auteur s’est consacré à la théorie de la connaissance ». Il s’agit bien alors de traduction.
Le besoin de traduire peut se faire sentir aussi devant un texte écrit dans notre langue maternelle il y a quelques siècles de cela. J’ouvre au hasard un livre du passé, les Œuvres poétiques de Jean-Baptiste Rousseau (1669-1741), et m’arrête à l’une de ses Épigrammes (livre premier, XXX) :
De haut savoir Phébus ne m’a doté,
Mais des neuf Sœurs je sais toucher la lyre ;
Grosse chevance oncques ne m’a tenté,
Mais peu de biens ont de quoi me suffire.
Amour me tint longtemps sous son empire :
J’ai retrouvé repos et liberté ;
Mais ce bien-là, certes, je le puis dire,
Si c’en est un, je l’ai bien acheté !
Le troisième vers, en particulier, exige une véritable traduction : « la grande richesse ne m’a jamais tenté ». Les suivants, n’en déplaise à Steiner, s’entendront le plus souvent sans qu’on ait à les traduire.
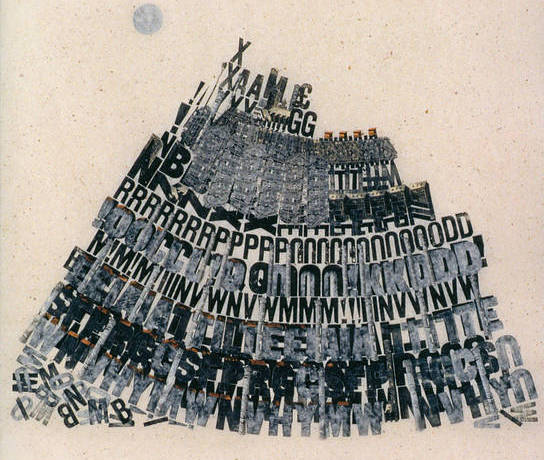
© Gallimard
Deuxième point : comme le rappelle Reynolds, le linguiste J. C. Catford affirmait, il y a quelque cinquante ans, qu’en traduisant nous ne transférons pas une signification d’une langue dans une autre mais trouvons des mots « interchangeables dans une situation donnée ». C’est encore plus vrai dans le cas où la langue ne parle plus du monde mais d’elle-même. Je voudrais l’illustrer par un exemple tiré d’Alice au pays des merveilles. Dans tout le roman, Alice ne commet qu’une seule faute de langue. C’est aux premiers mots du chapitre 2, quand, sous le coup de l’émotion et de l’étonnement, elle fait un emploi défectueux du comparatif : « curiouser and curiouser » (au lieu de « more and more curious »). Ici, la langue se prenant elle-même comme objet à travers une construction grammaticale idiomatique, une traduction littérale est évidemment impossible. Il en va de même quand on a affaire à une paronomase (rapprochement de mots qui se ressemblent phonétiquement), à un jeu de mots offert par la polysémie ou l’homophonie, etc.
Comment traduire ? On ne peut recourir qu’à la « domestication » de la langue-source. Ce n’est pas un sens qu’on doit rendre mais une situation langagière, ou plutôt une situation où la psychologie s’impose à la langue : Alice est si bouleversée qu’elle en perd son latin et produit un solécisme. Il faut donc trouver, dans les mots d’une autre langue, quelque chose qui traduise la confusion langagière d’Alice. Au XVIIIe siècle, le grammairien Nicolas Beauzée assignait à la traduction la tâche de rendre une pensée « comme on la rendrait dans le second idiome [la langue-cible], si on l’avait conçue de soi-même, sans la puiser dans une langue étrangère ». À une telle naturalisation, le présent cas nous oblige.
Les traductologues se serviraient sûrement à ce propos du concept d’équivalence, que Katharina Reiss définit comme « la relation d’égalité de valeur entre des signes appartenant à deux systèmes linguistiques [2] ». L’équivalence s’obtiendra en déterminant les éléments caractéristiques de l’énoncé à traduire et en les hiérarchisant. Dans notre exemple, ce n’est pas la présence du comparatif qui est décisive mais la vraisemblance de l’erreur commise par la locutrice. Il se trouve qu’en anglais il existe deux constructions du comparatif de supériorité (en fonction du nombre de syllabes de l’adjectif considéré) ; on peut supposer que l’emploi de l’une pour l’autre n’a rien d’exceptionnel, notamment dans la bouche d’un enfant. Ce critère de la vraisemblance rend critiquables les traductions suivantes : « C’est curieux de plus en plus ! » (Daniel Bismuth) ; « De plus très curieux en plus très curieux ! » (Henri Bué) ; « De plus en plus pas normal ! » (Laurent Bury). Les traducteurs se sont attachés au comparatif alors qu’il ne devrait venir qu’en troisième position, après l’erreur et la vraisemblance. On aboutit ainsi à des énoncés bizarres : « Plus que plus que curieux ! » (Michel Laporte), qui n’est ni suffisamment fautif ni suffisamment plausible ; « De plus-t-en plus curieux ! » (Jacques Papy), qui est abracadabrantesque.
Une traduction sans comparatif mais prenant en compte l’élément fautif et l’élément vraisemblable serait préférable. On peut imaginer, par exemple, qu’Alice dise : « Une histoire sacrée ! » (au lieu de : « Une sacrée histoire ! »). Mais si la présence du comparatif n’est pas l’essentiel, elle n’est pas non plus complètement indifférente ; les deux meilleurs traductions – rigoureusement équivalentes entre elles par le détour de l’ironie – la retiennent : « De plus en plus en plus mieux ! » (Jean-Pierre Berman) ; « De plus en plus pire ! » (Henri Parisot). Ces énoncés sont erronés (malgré l’extension contemporaine du « moins pire »), vraisemblables (les comparatifs irréguliers sont l’occasion de fautes fréquentes) et utilisent le comparatif. L’idée de « curiosité », d’étrangeté, a été écartée, mais ce n’est pas un problème : elle est encore plus loin dans la hiérarchie ; la stupéfaction d’Alice n’a pas besoin de s’incarner dans un adjectif particulier.
Selon Reynolds – c’est le troisième point –, on gagne toujours à consulter la traduction d’un texte écrit dans notre langue maternelle dans une langue étrangère que l’on connait peu ou prou. Entre tous les lecteurs, le traducteur est celui qui ne peut s’autoriser normalement aucune incompréhension définitive. Et les options qu’il a prises peuvent nous aider à saisir à notre tour des passages qui nous semblaient obscurs – voire fautifs – dans l’original. Prenons l’exemple du Degré zéro de l’écriture de Roland Barthes, avec, en vis-à-vis, sa traduction par Annette Lavers et Colin Smith (Writing Degree Zero). Au début du chapitre « Écritures politiques », on peut lire (je souligne) : « C’est tout un désordre qui s’écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement dévoré qui le maintient en état d’éternel sursis. » Le dernier pronom personnel, qui semble ne pouvoir renvoyer qu’à « la parole », ne devrait-il pas être au féminin ? Voici ce que proposent les traducteurs : « A whole disorder flows through speech and gives it this self-devouring momentum which keeps it in a perpetually suspended state. » Dans la phrase anglaise, on voit mal comment le pronom it pourrait se rapporter à deux substantifs différents : l’erreur est corrigée.
Au début du chapitre « L’artisanat du style », on lit ceci : « l’universalité du langage classique provenait de ce que le langage était un bien communal ». Où diable Barthes est-il allé chercher cet adjectif, qui n’a jamais voulu dire « commun » ? Voici la traduction : « the universality of classical language derived from the fact that language was common property ». La dimension municipale a heureusement disparu !
Voici les premiers mots du chapitre « L’écriture et le silence » : « L’écriture artisanale, placée à l’intérieur du patrimoine bourgeois, ne dérange aucun ordre ». Barthes n’a pas rendu explicite le lien de causalité, l’apposition se contente de le suggérer. Version anglaise : « Craftsmanlike writing, since it lies within the bourgeois heritage, does not disturb any order ». Cette fois, le lien logique ne fait plus aucun doute.
Ainsi la lecture de la traduction anglaise du Degré zéro de l’écriture a-t-elle permis de remédier à une inadvertance ; de supprimer une anomalie ; de lever l’équivoque que peut faire naitre une asyndète.
N’ayant pas le temps de parler davantage du livre de Matthew Reynolds, je formerai seulement le souhait qu’il soit bientôt traduit.
-
George Steiner, Après Babel : Une poétique du dire et de la traduction, Albin Michel, 1978, p. 55.
-
Katharina Reiss, Problématiques de la traduction, Economica, 2009, p. 146.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
