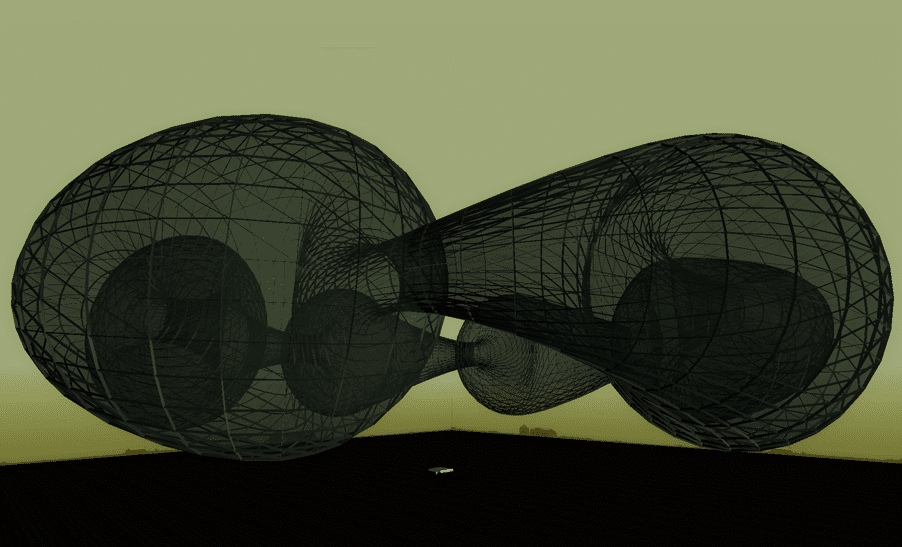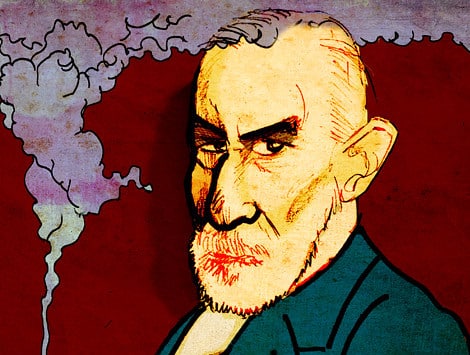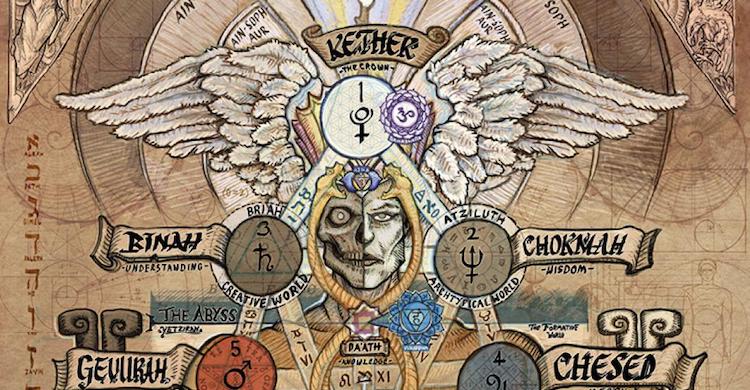La légende est tenace, y compris chez les psychanalystes, qui veut que Lacan ait été allergique à la langue de Shakespeare et que la lecture de son œuvre, voire sa compréhension, n’aient jamais pu franchir les frontières du monde francophone.
Jean-Pierre Cléro, Lacan et la langue anglaise. Érès, coll. « Essaim », 400 p., 20 €
Jean-Pierre Cléro, bien loin de souscrire à cette opinion infondée, explore méthodiquement, en s’appuyant sur sa formation de philosophe, sur sa connaissance exemplaire de la langue anglaise et de ses subtilités et sur sa fréquentation rigoureuse de l’œuvre lacanienne, les modalités au moyen desquelles Lacan « joue » avec cet idiome, comme il l’a toujours fait avec le français, comment il évolue dans cette langue a priori étrangère pour lui en tant que parlêtre, c’est-à-dire comme sujet parlé par lalangue, quelle qu’elle soit.
Entreprise indispensable, la démarche de Cléro est celle d’un spécialiste à l’affût des plus subtiles difficultés inhérentes à son sujet, ce dont témoigne, entre autres, une somme de notes de bas de pages qui pourrait à elle seule former la matière d’un autre volume. Si la lecture de cet ouvrage – sujet oblige – n’est pas toujours aisée, son découpage en cinq parties bien distinctes (« Lacan et les philosophes anglais », « Éléments de logique et de linguistique », « Les écrivains anglais », « Les psychologues et les psychanalystes lus en anglais », « Les savants anglophones cités pour des raisons épistémologiques ») et le fait que chacune soit elle-même constituée de chapitres précis permettent au lecteur de « faire son marché », démarche dont Cléro ne cache pas qu’elle est précisément celle qu’adopte Lacan dans sa fréquentation des auteurs anglais. Si l’on peut ainsi aller d’une partie du livre à l’autre au gré de ses centres d’intérêt, il est une nécessité impérieuse : la lecture de l’imposante introduction, véritable « feuille de route » qui donne les clés du rapport à la fois étrange et étranger de Lacan à l’anglais, de l’usage et du mésusage délibéré qu’il fait des auteurs anglais, de quelque époque et de quelque domaine qu’ils soient.
Volontiers provocateur, Cléro affirme ainsi que Lacan ne parle pas l’anglais mais en use comme pour se commenter lui-même, en recourant à des termes voire à des phrases en anglais, comme s’il s’adressait à lui-même et à un autre dans un même mouvement, comme si, au titre d’une sorte de coquetterie ou d’aparté, il avait, par instants, instants toujours appropriés et jamais fortuits, un pied à Calais et l’autre à Douvres. Cela conduit à cette observation majeure : on ne dit pas la même chose dans une langue et dans une autre, même si l’on croit que l’on traduit. « S’il n’y a pas de traduction possible d’une langue dans une autre, c’est parce que le lien des signifiants et des signifiés en chacune d’elles n’est aucunement stable », écrit Cléro. Lacan s’est expliqué sur cette impossibilité, non seulement en ne se livrant pas lui-même à des traductions, à la différence de Freud, mais aussi parce qu’il a eu d’emblée la conviction qu’il n’y a pas de métalangage et que la diversité des langues est irréductible : « On ne peut parler d’une langue, dira-t-il dans l’un de ses derniers séminaires, que dans une autre langue ». Par là, il désigne bien cette sorte de constante qui spécifie le rapport des langues entre elles, à savoir une incontournable altérité, l’étranger dans son essence. Cléro évoque ainsi, entre autres mésaventures signifiantes de Lacan avec l’anglais, l’incident survenu à Baltimore au cours d’une conférence, en anglais précisément, conférence durant laquelle, exigeant comme toujours et refusant l’approximation, il s’était trouvé désemparé, faute d’une aide venant de la salle, pour trouver le terme anglais équivalent du français… reste. Manque signifiant, celui-là, comme d’autres, erreurs de grammaire, ou lapsus : ce sont autant d’occurrences dont Lacan se saisit pour inventer un anglais imaginaire, ce qu’il énoncera en disant qu’il parle, donne à entendre lalanglaise.
Ces sortes de jongleries, ces erreurs délibérées toujours signifiantes ou, dans le registre inconscient, ces lapsus, utilisés délibérément dans un second temps et dans l’élan d’une découverte, témoignent de ce qu’une faute dans le maniement d’une langue, transformée en une erreur ou en un joke, peut faire surgir un impensé initial.

Jacques Lacan
Parmi d’autres questions posées dans cette introduction, mais on ne saurait ici viser à une quelconque exhaustivité, Cléro aborde le point complexe, parce que produit d’un énoncé incomplet – mais notre auteur souligne que cette incomplétude ne saurait être le fruit du hasard –, celui qui laisse entendre que l’anglais serait un obstacle à la manifestation et à l’écoute de l’inconscient. Cléro discute longuement et avec exigence cette déclaration, tardive dans la démarche lacanienne, à laquelle il n’adhère pas totalement. Il finit par se demander, dans le dédale de cette riche discussion, si c’est Lacan ou bien un « sphinx qui a parlé, concernant l’anglais, ou y a-t-il quelque rationalité de ce dire ? ». Une interrogation de même nature a pu être formulée, suite à un aphorisme lacanien tout aussi hermétique, à propos du japonais. Exigence et rigueur poussent l’auteur de l’ouvrage à nous dire, au terme du parcours à risque que constitue cette introduction, qu’il n’a pas cherché à combler tous les manques ou à répondre à toutes les énigmes et qu’il a même « délibérément négligé des phrases trop peu compréhensibles, voire incompréhensibles », ce qui revient à ratifier, défaut de transcription des séminaires ou mise en forme éditoriale parfois peu rigoureuse, cette formule désormais célèbre, elle aussi ambiguë et comme telle ouverte à plusieurs lectures : « Pas tout Lacan ! »
À défaut, là encore, de parcourir intégralement l’examen que fait Cléro du « commerce » de Lacan avec les philosophes, écrivains, analystes et savants anglais ou de langue anglaise, on se contentera à présent de marquer un temps d’arrêt sur certaines étapes et non des moindres : ainsi du chapitre consacré à Bentham, s’agissant des philosophes, de celui qui traite de Jakobson et de Chomsky pour la linguistique, de celui célébrant Joyce pour la littérature, de celui enfin qui fait place à Winnicott chez les psychanalystes de langue anglaise.
Alors qu’en 1954 Lacan n’évoque pas encore Bentham, et pas plus Berkeley, il développe sa théorie de la signification des mots, proche de la conception benthamienne lorsqu’il soutient que « le sens d’un mot est l’ensemble de ses usages » et ne saurait se limiter au seul signifié. Mais Lacan n’a jamais prétendu avoir découvert la théorie des fictions, sa lecture de Bentham, soutenue, on le verra, par Jakobson, contourne ce qui fondait, « ridiculement » dira Lacan, la célébrité du philosophe anglais, notamment pour les Français la réflexion sur le système pénitentiaire au moyen du panoptique, et tout autant ce à quoi une bonne partie de la philosophie continentale, de Kant à Bergson, a voulu le réduire : l’utilitarisme, dont Lacan affirmera sans détour qu’on en a méconnu le sens quand il concernait l’usage des vieux mots, ce à quoi ils servent. Ce qui retient très tôt l’attention de Lacan dans cette théorie de la fiction, c’est que le philosophe anglais y souligne avec force le caractère fictif de la vérité, son statut de construction que l’on ne saurait assimiler à une quelconque illusion ou tromperie : « Le fictif, affirme Lacan dans le Séminaire sur L’éthique de la psychanalyse, n’est pas par essence ce qui est trompeur, mais à proprement parler ce que nous appelons le symbolique ». À s’en tenir à ces observations, ici presque outrageusement résumées, on demeurerait dans le registre spéculatif, mais c’est dans un registre autre, touchant à la technique de la psychanalyse, à savoir le transfert, que Lacan introduit la fiction, en rappelant que, dans le transfert, ce n’est pas tant de la vérité qu’il s’agit mais de ce que le sujet fabrique, construit.
Partant de la célèbre thèse lacanienne qui affirme que l’inconscient est structuré comme un langage, plus d’un commentateur a eu tôt fait d’ajouter celle de linguiste aux autres compétences de Lacan, négligeant ainsi, Cléro le souligne, la prudence et le respect lacaniens témoignés à l’égard de domaines autres que le sien propre : lorsqu’il parle de sa linguisterie, Lacan indique, bien au-delà de toute facétie, son rapport à la linguistique alors en plein essor, à la fois l’autonomie de sa démarche vis-à-vis de cette science et sa position, là comme ailleurs, d’utilisateur. Si l’on met en exergue l’une des thèses centrales de Chomsky, le fait que selon lui « le langage lui-même est un organe » et qu’il est le produit d’une détermination génétique – toutes déclarations que Lacan a recueillies in vivo lors de son voyage aux États-Unis –, on n’est pas étonné de voir Lacan réfuter, bien qu’avec prudence, ces thèses dont on a pu vérifier, chez les émules de Chomsky, comment elles pouvaient se développer dans les méandres de la psychologie cognitive. Il en va tout autrement du grand ami que sera Jakobson, à qui Lacan ne manquera jamais de rendre hommage. L’un des apports les plus importants de Jakobson sera l’éclairage qu’il apportera, nous l’avons annoncé, à la théorie benthamienne des fictions, montrant qu’il faut identifier dans ce registre un fait de structure identifiable dans la syntaxe et non une interprétation subjective.
Ces pages que l’on a envie de dire trop brèves, sont émaillées d’anecdotes et d’exemples simples mais lumineux. Ainsi de réponses que Jakobson apporte, avec « un exceptionnel brio » souligne Cléro, dans le cadre du séminaire du 1er février 1967 auquel il participe, réponses bien éloignées des discours à la scientificité douteuse, qui démontrent comment, très tôt, le discours de l’enfant fictionne, moment décisif dans le développement psychique. Deux fonctions sont alors à l’œuvre selon le grand linguiste, la fabrication de « l’éclatement subjectif » qui va sous-tendre la prise de rôles d’une part, et ce que cela implique dans l’ordre de l’échange et de la différenciation d’avec l’autre, les modulations de la prédication sur un autre versant : l’enfant sait dire du chat qu’il court, dort ou mange et bien vite dans le même mouvement, délaissant le « chosisme », il va dire que « le chat aboie ». Il entre alors dans la fiction et par là même dans la poétique. Autre exemple qui nous fait revenir aux rapports entre les deux langues : si en anglais je dis que j’ai passé la nuit dernière « with a neighbour », je ne serai pas tenu de préciser le sexe de ce neighbour alors qu’en français le locuteur ne peut faire autrement que de préciser s’il s’agit d’un voisin ou d’une voisine : la diversité des deux langues crée une diversité de situation sur laquelle il n’y a pas lieu à présent d’insister mais dont on peut discerner l’impact s’agissant de la sexualité.

S’il est un obstacle que Lacan nous épargne en matière de littérature c’est bien celui de la complétude fastidieuse : là comme ailleurs, Lacan sélectionne, extrait pour faire jaillir sans le moindre souci d’exhaustivité telle ou telle trouvaille dont l’art est bien, au-delà de ce qui pourrait sembler une insistance coquette sur des détails, de nous donner toujours la sensation d’avoir intégralement lu tel ou tel auteur. C’est d’un travail avec et non sur Joyce qu’il faut ici parler, s’agissant de ce rapport unique dans lequel Lacan s’est inscrit, effets conjugués des lalangues, aidé incontestablement en cela par les commentaires et mises en français que Jacques Aubert a pu faire de l’écrivain irlandais. De toutes les rencontres, échanges et confrontations que Lacan a pu avoir avec les écrivains ou philosophes anglais, aucune, et c’est ce qui ressort du commentaire que fait Cléro de cette mise en rapport entre Joyce et Lacan, n’illustre avec autant de force certains des points, ici rappelés, de l’introduction du livre. Le commentaire ne peut être à présent qu’approximatif et l’on ne saurait faire mieux que Cléro en citant un extrait de sa lecture. Modestement il parle de « toute lecture », se demandant de quoi l’écriture qu’il lit est-elle le symptôme. Lacan, souligne-t-il, n’a pas pu analyser Joyce, il semble bien le regretter – Joyce du reste s’est bien gardé de demander quoi que ce soit de tel – mais son rapport au travail, à l’écriture joycienne apparaît bien comme le produit d’une relation d’ordre analytique : la question ne renvoie pas à un commentaire ou à une recherche divinatoire et dès lors inévitablement psychologisante, il s’agit plutôt d’une sorte de partition en écho : « C’est en apparence bizarrement, en rivalisant de jeux de mots, de calembours, de rébus que Lacan se met et nous met en relation ajustée, si l’on ose dire, avec le texte, en essayant d’imposer le moins possible un carcan et quelque identité préalable à ce que pourrait être une lecture de Joyce. » On est loin de l’idée de traduction en son sens le plus étroit. La proximité entre Lacan et Joyce n’est évidemment pas une question de sympathie ou de telle autre dimension affective, mais une sorte de parenté d’écriture dont les difficultés ne sont pas des défauts ou quelque sophistication gratuite, mais tiennent au « matériau qui est à dire et qui ne peut se dire autrement », Lacan précisant, en novembre 1957, qu’« il y a dans les difficultés de ce style [celui de Joyce comme le sien] quelque chose qui correspond à l’objet même dont il s’agit ».
De tous les psychanalystes de langue anglaise, Winnicott est probablement, par le biais des objets, transitionnel d’un côté, objet a de l’autre, le plus proche de Lacan, mais cela n’exclut pas, sinon une rivalité (Lacan ne manifeste aucune antipathie ou hostilité à l’égard de Winnicott), du moins la tentative permanente de Lacan d’insérer, d’annexer la conception du Britannique dans la sienne propre, celle de sa topique RSI (réel, symbolique et imaginaire). Il y a dans cette relation, continuellement teintée d’opposition, bien plus qu’une relation entre deux hommes, plutôt une confrontation entre deux modes de pensée, Lacan faisant ressortir le manque winnicottien sur le versant de la fiction, l’ancrage du Britannique dans l’imaginaire et sa défaillance quant aux modalités du nouage entre cet imaginaire et le réel : en bref, le spectre d’un retour toujours possible de formes psychologisantes qui se dispensent d’une prise en compte du manque, du vide et du trou.
Plus que conscient de ce qu’il juge être les manques de son travail qu’il réduit, modestie qui nous paraît loin d’être justifiée, à « une simple enquête », Jean-Pierre Cléro en appelle à d’autres recherches possibles, celles qui prendraient en quelque sorte « à bras-le-corps » la question aussi cruciale qu’épineuse de l’histoire du mouvement psychanalytique – le singulier a-t-il ici encore raison ? s’interroge-t-il – et plus spécifiquement celle des fondements de ces divisions, dont l’auteur se demande si l’anglais n’y jouerait pas quelque rôle et non des moindres. Et puis, immense projet à l’horizon, d’autres travaux qui se confronteraient, avec la même rigueur, au traitement de l’œuvre lacanienne dans d’autres langues, contemporaines ou anciennes, arabes, juive, latine ou encore asiatiques. Horizons autres que ceux, « régionaux », dans lesquels le « lacanisme » français contemporain semble trop souvent se complaire.
Si Babel n’est pas un mythe, on ne saurait en conclure à quelque malédiction, mais bien plutôt, c’est ce que nous enseigne cet ouvrage, à une bénédiction.