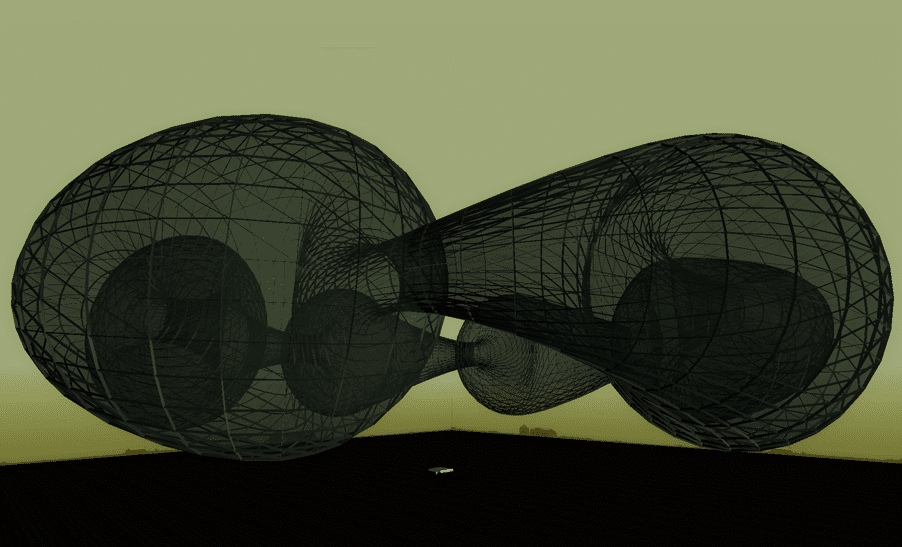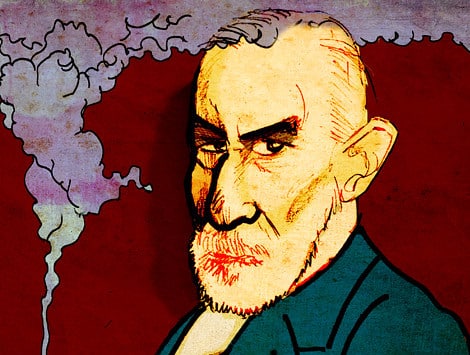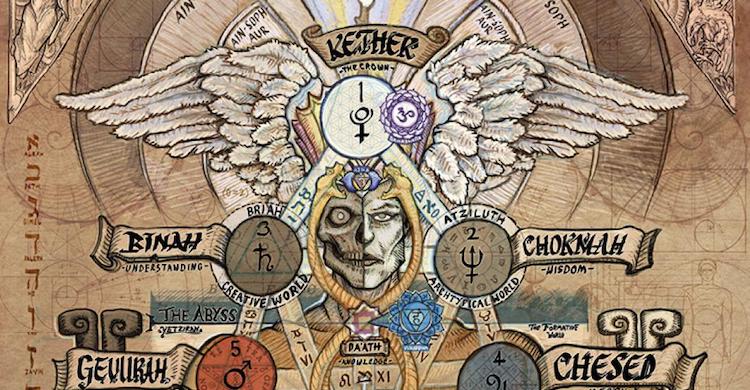La simultanéité de la parution de ces deux livres chez le même éditeur ne saurait suffire à leur rapprochement ; il y a autre chose, le fait qu’ils nous conduisent tous deux dans les méandres, processus transférentiels et contre-transférentiels, temps d’espoir et de découragement, continuité et interruptions brutales, qui ponctuent ou peuvent ponctuer une analyse.
Estelle et Philippe Porret, La formation de l’analyste et son désir : Sammy… Joyce McDougall, Serge Lebovici et Donald W. Winnicott. Campagne Première, 242 p., 21 €
Yves Lugrin, Ferenczi sur le divan de Freud : Une analyse finie ? Campagne Première, 266 p., 24 €
Dans un cas, il s’agit d’une analyse d’enfant et des interventions discutables du superviseur de l’analyste ; dans le second, nous sommes confrontés aux souffrances et à l’exigence de l’un des plus célèbres disciples de Freud, le hongrois Sándor Ferenczi pris dans les mailles terrifiantes de son transfert au maître mais aussi des desiderata de ce dernier qui n’échappe pas toujours, tant s’en faut, à la fonction paternelle et à la position de maître que l’analysant lui assigne et lui refuse en même temps.
Cette lecture en parallèle nous a conduit à formuler une question très simple : « où en sommes-nous aujourd’hui ? » s’agissant de la pratique psychanalytique, laquelle est bien sûr commandée, fût-ce implicitement, à chaque époque par des conceptions théoriques distinctes voire opposées. Chacun des deux ouvrages ici questionnés suggère une réponse bien différente à cette question en définitive rarement formulée. En un mot, le suivi du remarquable travail de Joyce McDougall avec le jeune Sammy que restituent Estelle et Philippe Porret laisse apparaître le caractère audacieux de ce travail qui est quelque peu parasité par le positionnement du superviseur, en l’occurrence le professeur Serge Lebovici, alors « ponte », dans ces années cinquante, de la psychanalyse en France, au point que l’on ne peut que se dire : « heureusement, Lacan et sa refonte tant théorique que pratique sont arrivés, apportant un souffle nouveau, bien éloigné de l’académisme médical dominant à cette époque ! ». À l’inverse, en suivant bien le parcours analytique de Ferenczi fait d’incessantes demandes, voire de plaintes, en notant l’exceptionnelle franchise qui caractérise ce récit dans lequel se manifeste la proximité d’Yves Lugrin avec le disciple hongrois de Freud, nous sommes amené à une interrogation plus teintée d’angoisse : « avons-nous progressé, sommes-nous capables, aujourd’hui, d’un investissement aussi exigeant que ces deux interlocuteurs entièrement immergés dans la psychanalyse ? ».
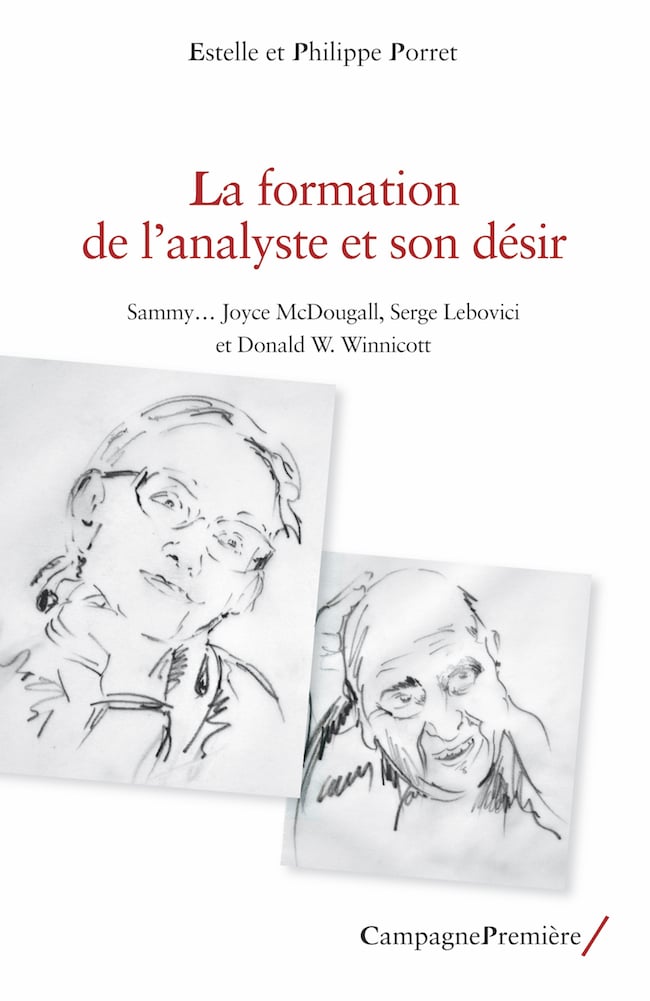
Joyce McDougall, à qui Philippe Porret avait consacré en 2005 un livre justement enthousiaste, allait devenir une analyste connue et reconnue en France. Venant d’Auckland où elle a reçu une première formation, puis de Londres où elle passé un an à la Hampstead Clinic alors dirigée par Anna Freud, elle arrive à Paris où elle s’inscrit dans l’unique société de psychanalyse en France à ce moment-là, la Société parisienne de psychanalyse, dirigée par quelques ténors dont Serge Lebovici qui lui adresse très vite, pour des raisons de langue, un jeune Américain d’une dizaine d’années accompagné de ses parents, enfant que l’on peut qualifier de psychotique – à certains égards, il évoque le personnage de Mommy, le film de Xavier Dolan – et qui avait été pris en charge quelque temps aux États-Unis par Margaret Mahler. Cette cure à Paris, loin de pâtir de l’inexpérience de la jeune analyste néo-zélandaise, bénéficie au contraire de ses trouvailles et de l’émergence pour la praticienne de ce qu’elle reconnaîtra comme étant son désir d’analyste.
Expérience à ce point pionnière pour la France de l’époque qu’elle va donner lieu à un livre patronné par le superviseur, livre, comme l’écrivent les auteurs, qui « permettait aux lecteurs français de prendre connaissance de ce que disent Sammy, Douggie – c’est ainsi que bien vite l’enfant appelle son analyste – mais aussi et après chaque séance, de considérer l’appréciation de Serge Lebovici, psychiatre et psychanalyste, ici contrôleur, sur le cours du traitement, pour reprendre un terme freudien ». Ces quelques mots suffisent pour commencer de cerner – toute la suite du livre ne fera qu’accentuer ce décalage – un montage qui met en présence une relation, celle constitutive de la cure, que l’on peut dire pleinement psychanalytique quelles que soient ses impasses et ses maladresses, celle consistant par exemple à recevoir les parents sans l’enfant qui s’en montre inquiet, et celle de la supervision dont on peut dire avec le recul qu’elle n’a pas grand-chose d’analytique, faite de remarques et d’observations éloignées du dire de l’enfant et relevant plus de conseils professoraux donnés à une élève ; à quoi il faut ajouter, ce que ne manquent pas de faire les auteurs du livre, que l’analyste et son jeune patient parlent un anglais plus que probablement spontané et qui ne relevait certainement pas d’une traduction littérale, alors que les échanges entre l’ « enseignant » et l’analyste ont lieu dans la langue de Molière que l’analyste en retour ne parlait alors qu’approximativement, tout cela impliquant que nombre de signifiants lui échappent inévitablement.
Quoi qu’il en soit, cette expérience donne lieu à un livre qui paraît en 1960, Un cas de psychose infantile, livre signé, hiérarchie oblige, du contrôleur et de la jeune analyste, qui fait une large place aux interventions du professeur dont Estelle et Philippe Porret interrogent plus d’une fois la pertinence. En 1959, à Copenhague, lors du Congrès international de psychanalyse, Serge Lebovici, au cours d’une séance présidée par Donald. W. Winnicott, présente une communication dans laquelle il fait largement état de la cure de Sammy. « On ne sait pas très bien, écrivent les deux auteurs, comment cette communication fut reçue. Elle témoigne d’une appropriation étonnante d’une cure dont Joyce McDougall fut l’analyste » Winnicott fut suffisamment intéressé par le livre pour envisager une traduction en anglais. Mais là, surprise ! Surprise qui marque bien l’ancrage analytique de l’anglais pas dupe de l’académisme français : il s’agit d’une création nouvelle, par le titre d’abord, Dialogue with Sammy, par l’ordre des auteurs ensuite, Joyce McDougall y précédant Serge Lebovici, renversement de titre et de signature dont les auteurs soulignent bien qu’il « obéit et traduit une véritable refondation de l’ouvrage ». Pour résumer l’opération avec quelque brutalité, on est tenté de dire que Winnicott met et remet de l’analyse là où cette dimension était comme étouffée dans la version française.
Qu’il s’agisse de l’extrême minutie avec laquelle les auteurs relatent aussi bien ces modalités éditoriales et institutionnelles, qui laissent apparaître la différence d’alors entre la psychanalyse anglaise et la française, que le déroulement des séances de Sammy avec Douggie, qu’il s’agisse des commentaires de Maud Mannoni ou de Moustafa Safouan cités dans la dernière partie du livre, commentaires marqués par l’enseignement de Lacan et comme tels critiques à l’égard de la démarche exposée dans la version française, cet ouvrage met au jour un moment décisif dans lequel, d’où notre réponse à la question initiale, la psychanalyse en France, celle des enfants en particulier, a connu une transformation fondamentale à laquelle, outre les auteurs à l’instant cités, l’œuvre de Françoise Dolto a plus que contribué.
Reportons-nous à présent quelque trente ou quarante ans en arrière. Freud commence à être pris, et ça n’est pas près de finir, bien au contraire, par la poursuite et le développement de ce qui le passionne, ses recherches théoriques, l’écoute de ses patients, dont il ne fait pas mystère qu’ils l’ennuient, et par la politique de la psychanalyse, le gouvernement de son association, future IPA, chargée d’assurer la protection et la transmission de la psychanalyse. Parmi les « princes » qui vont constituer la garde rapprochée du fondateur et de son œuvre en plein développement, un homme émerge que son intelligence, sa culture et son sens clinique mais aussi sa fascination pour le Viennois vont mettre au premier plan, le Hongrois Sándor Ferenczi, dont Freud songe, la rupture avec Jung accomplie non sans douleur, à faire son héritier en tous domaines.
Deux voyages en commun, l’un aux États-Unis en 1909, l’autre à Palerme un an plus tard, laissent paraitre, de manière plus ou moins feutrée, les composantes potentiellement explosives d’une relation pleine de contradictions. Ferenczi, déjà expert pour ce qui est de l’auto-analyse, n’est pas sans repérer ce qui deviendra symptôme dans leur relation, son désir infantile d’être gratifié par le père et en retour la bienveillance protectrice mais autoritaire de l’aîné. Si, durant ce premier voyage, cadre d’une amitié naissante, les choses évoluent sans accrocs majeurs, il n’en va pas de même en Sicile où Freud manifeste sa volonté de dicter à son compagnon, en lieu et place d’un véritable échange intellectuel, ses élaborations théoriques : devant le refus opposé par son cadet, qui ne supporte pas ce rôle de scribe, Freud se raidit et rompt l’échange. La blessure sera plus que douloureuse pour Ferenczi en plein transfert : elle ne cicatrisera jamais complètement.
Néanmoins, le transfert du jeune Hongrois est bien enraciné ; s’y déploient aussi bien sa passion pour la psychanalyse, sa clairvoyance institutionnelle – à certains égards, il a des conceptions prémonitoires de ce que Lacan tentera de faire avec son École en 1964, une institution purement analytique –, que ce qui ne cessera de le déchirer, ce partage « entre la femme qu’il pense aimer et toutes les autres femmes qu’il ne cesse de désirer », écartèlement qu’au départ Freud, qui reçoit les confidences de son disciple, n’est pas loin de considérer avec bienveillance. Mais progressivement les lignes de tension vont s’installer : par ses exigences incessantes d’une psychanalyse sans concession, poussée toujours plus loin, le développement sans limite des associations d’idées qu’il déverse sur le Viennois, confessions envahissantes auxquelles Freud cherche plus d’une fois à se dérober, quitte à commettre par des interventions intempestives auprès des protagonistes femmes de son compagnon des erreurs qui ne feront qu’envenimer les choses, Ferenczi devient pour Freud, qui ne peut se défaire complètement de son transfert et du contre-transfert qui l’accompagne, une charge envahissante. Qu’importe, le Hongrois en redemande, on peut même dire que les réticences freudiennes exacerbent ses exigences, qui débouchent en 1912 sur une demande d’analyse personnelle dont Yves Lugrin nous restitue les scansions, celles d’une articulation entre une « demande de soins » et l’acharnement à recevoir des réponses – « j’aimerais que vous m’instruisiez à ce sujet » – sur le point de savoir si la détermination ultime de cette névrose qui le ronge est d’ordre organique ou psychique, question à laquelle il cherche constamment à apporter lui-même des éléments de réponse.
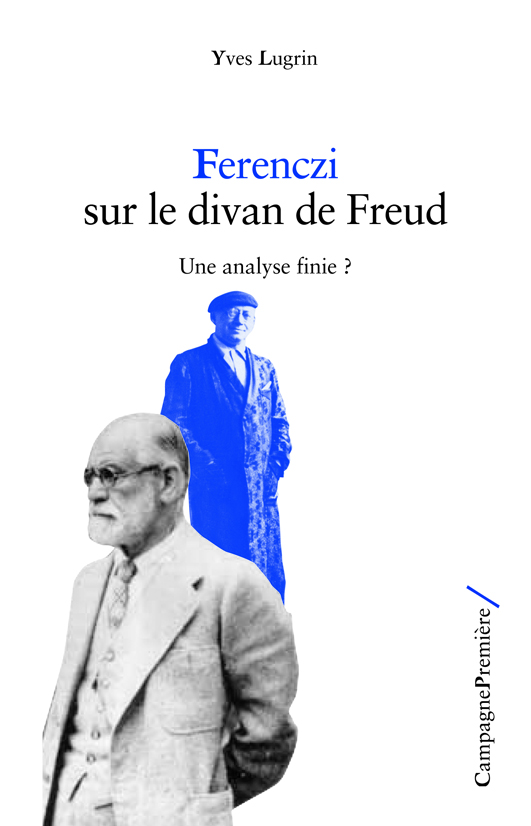
Freud s’est trouvé contraint de répondre positivement à cette demande d’analyse, mais il ne va cesser, au fur et à mesure des visites de Ferenczi à Vienne pour des séances intensives et débordantes, de redouter un envahissement reléguant au second plan les affaires institutionnelles de la psychanalyse qui connaît alors les tourments de la rupture avec Jung. Il est vite las de cette litanie de plaintes et de questions, les choses inévitablement vont mal tourner.
Le bonheur de ce livre réside dans la restitution minutieuse des tumultes de cette analyse, dans le récit des digues que Freud s’efforce de construire pour canaliser l’impétueux torrent ferenczien jusqu’à en venir, n’en pouvant plus, à la décision d’arrêter cette analyse « interminable ». Ferenczi ne cessera de lui reprocher cette ultime brutalité alors même que son désir de connaître, de pousser l’analyse vers un horizon indéfinissable, et son espoir d’apaiser ses souffrances névrotiques ne sont et ne seront jamais comblés, pas même par son mariage, plus que souhaité par Freud, avec sa compagne, Gizella. Pour répondre au sous-titre du livre, on ne peut que dire non, il ne s’agit pas d’une analyse finie. Mais pouvait-elle l’être ? L’analyse n’est ni une science ni un auxiliaire médical infaillible.
Cette relation unique dans l’histoire de la psychanalyse apporte, grâce au décryptage exigeant qu’en fait Yves Lugrin, un enseignement clinique qui mériterait d’être aujourd’hui mieux pris en compte. À côté de ce versant qui laisse apparaître les difficultés de la pratique analytique, cette véritable aventure fourmille de réflexions sur les impasses et contradictions institutionnelles qui ponctuent l’histoire du mouvement psychanalytique : ainsi de l’opposition entre le courant dogmatique berlinois et les audaces hongroises, point sur lequel Freud ne tranchera pas forcément avec bonheur; de la question de la formation des analystes aussi bien, question sur laquelle, là encore, Ferenczi anticipe sur les avancées lacaniennes.
Un regret, à la lecture de ce travail exigeant : l’absence de notes et de références bibliographiques, absence qui n’est guère généreuse pour un public qui n’est pas nécessairement ferré sur cette histoire et dont le désir d’en savoir plus n’aurait rien d’illégitime.