Cet entretien a été réalisé lors du passage de Kamel Daoud en France au mois de juin dernier. C’était en pleine canicule et il faisait nettement plus chaud à Paris qu’à Oran où il vit. Il a parlé des personnages de son roman (dont on peut lire ici le compte-rendu), Hadjer et Djemila, femmes recluses qui paient pour des fautes qu’elles n’ont pas commises. « L’une est dite vieille fille, donc empêchée de son corps. Et l’autre répudiée, donc interdite d’avoir un corps ».
Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes. Actes Sud, 336 p., 21 €
Kamel Daoud a parlé aussi d’Amitabh Bachchan, la star absolue du cinéma indien, qui fait une apparition surréaliste dans cette histoire algérienne. De son goût pour la calligraphie, dont il aime « le tracé, le rapport entre la matière, l’encre, et le sens, l’écriture physique, qu’on peut toucher ». Mais aussi des figures bibliques et de son père, des Mille et Une Nuits et de la mort, du village de son enfance, des mythes et des livres sacrés, de la lecture comme accès au dévoilement du féminin.

Kamel Daoud © Renaud Monfourny
Quel est le sujet de Zabor ?
C’est la langue. Comment on l’apprend, comment on l’arrache, comment elle libère. La langue comme désir et comme esthétique. Quand je dis langue, je dis aussi écriture. Comment, avec l’écriture, faire acte de résistance face à un livre sacré qui veut tout expliquer, qui ne veut pas redonner la parole à l’humain.
Bien sûr, il y a d’autres sujets : la sexualité, le rapport au père, l’infanticide. Si on résume, la question se pose ainsi : est-ce qu’un homme peut écrire un livre sacré ? Mais je ne voulais pas écrire un livre complexe, je voulais qu’il soit à la fois simple et chargé de sens. Un livre qui commence par captiver pour qu’ensuite on se trouve obligé de réfléchir un peu.
C’est aussi un livre très biblique, non ? Un lecteur attentif reconnaîtra Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Jonas (Younès) et la baleine, et surtout Abraham (Brahim) et Ismaël…
Il y a des figures qui me fascinent parce qu’elles incarnent mes interrogations sur le monde. J’ai toujours été frappé par le geste d’Abraham. Comment peut-on arriver à l’infanticide au nom de l’invisible ? Je pense que c’est la grande tragédie du retour du fanatisme religieux : on en arrive à tuer l’homme au nom de l’invisible. On tue ce qui est vivant au nom de ce qu’on ne perçoit pas.
Quant au texte biblique, c’est un texte fondamental dans ma culture. Lorsqu’on parle de récit coranique, on ne parle pas d’une mythologie accessoire. Le mythe est un récit qui dit vrai. L’homme a été confronté à de grandes questions et les catalogues de ces questions, ce sont nos mythologies. Qu’elles soient mésopotamiennes, hindoues ou bibliques, c’est la même chose.
Les mythes me fascinent. J’avais envie d’y réfléchir, de les interroger, de les pervertir aussi.
Cette idée de tourner autour du texte sacré pour le démanteler et le surmonter m’est essentielle. Je suis l’enfant d’une culture qui a pesé sur moi, je veux m’en débarrasser, m’en libérer. Et le seul moyen de m’en libérer, c’est l’écriture. Que ce soit perçu comme un jeu esthétique en Occident, je peux le concevoir. Mais, de l’autre côté, ce sera perçu pour ce que c’est : un acte de rébellion contre une explication sacrée du monde.
Le texte sacré, c’est une question de vie ou de mort actuellement. Je parle d’hérésie, là. Quand on écrit un roman sur l’hérésie, ce n’est pas tout de suite saisi dans votre culture, parce que vous n’avez pas l’idée qu’on puisse tuer quelqu’un parce qu’il ne croit pas. Mais, dans la géographie où je vis, c’est une question de vie ou de mort. Triturer le texte sacré, tourner autour, le contourner, l’enjamber, ce n’est pas une question d’esthétique, c’est une question vitale.
Dans Zabor, la religion est abordée de manière assez latérale, et en même temps elle est omniprésente. Même si elle apparaît comme un mythe, un peu à la manière des Mille et Une Nuits.
Absolument. Il y a quelque temps, j’ai lu une citation, en exergue d’un roman espagnol dont j’ai oublié le titre, qui dit à peu près : « Imaginez un monde où Les Mille et Une Nuits serait un livre sacré et l’histoire de Jéhovah un conte pour enfants. Alors, on décapiterait les gens qui remettent en question l’histoire de Shéhérazade et les enfants rigoleraient avec les histoires de Job et de Jéhovah ». J’avais été bouleversé. Si l’histoire s’était déroulée de cette manière, on aurait eu des églises Shéhérazade, on aurait tué pour Shéhérazade et rigolé avec Jéhovah.
Dans Zabor, il y a aussi un certain Aïssa (Jésus) qui choisit de s’appeler Hamza. Qui est-il ?
Il est l’antagoniste de Zabor, le jumeau maléfique qui utilise un livre pour asservir les autres, face à quelqu’un qui écrit pour se libérer. C’est un peu l’archétype de toute la maladie du livre qu’on voit maintenant. Tout intégrisme est une maladie du livre. Que ce soit le livre rouge, le livre vert, le livre sacré, on est toujours dans cette interprétation maléfique du livre qui finit par vouloir s’imposer aux autres par le meurtre, la violence ou l’attentat. Si vous faites le bilan, on a énormément tué au nom du livre.

Le personnage principal est donc Ismaël, qui décide un jour de s’appeler Zabor. Or, le Zabor, c’est un des trois livres saints, le livre des Psaumes de David, Daoud en arabe. Le fait que Daoud soit votre nom de famille a-t-il joué un rôle dans votre envie d’en parler ?
En Algérie, pour dire : « Mais qui va te croire ? », il y a une expression : « À qui tu vas raconter tes Psaumes, ô David ? » Ça m’a toujours amusé, cette idée de prêcher dans le désert.
Vous faites référence à la Bible, au Coran et au Zabor, le livre des Psaumes. Serait-il exact de dire que vous donnez la préférence aux Psaumes ?
Oui. Parce que c’est un livre chanté, j’aime cette idée ou… je ne sais pas… parce que c’est lié à mon nom. Parce que c’est un livre sacré qui n’implique pas encore une obligation de prendre parti pour le Coran ou pour la Bible. C’est peut-être un livre sacré médian.
Pour en revenir aux Mille et Une Nuits, c’est une des mythologies évoquées dans le roman, de manière explicite pour le coup… mais inversée : un homme raconte pour sauver la vie des autres. Vous pensez que c’est le rôle de l’écrivain en général ?
Je pense que le rôle de l’écrivain en général est de maintenir le sens. Dans la guerre, les geôles ou le goulag, on écrit. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner du sens, de maintenir la cohésion du monde autour de soi. Écrire qu’une femme raconte pour sauver sa vie, ou qu’un homme raconte pour sauver la vie des autres, c’est une métaphore pour exprimer l’idée simple que l’écriture est vitale et que la fiction aide un peu à entretenir la vie. Et puis regardez : il y a littérature dès que trois choses sont réunies : la nuit, le voyageur et le feu. Dès qu’on met les trois ensemble, il y a quelqu’un qui raconte, parce que c’est nécessaire. Pour conjurer la nuit, pour reposer le voyageur et pour peupler un peu le vide.
J’ai découvert que, en 2015, vous aviez écrit un court texte qui est comme le germe, le noyau de ce livre.
J’ai toujours fait ça. Je publie une chronique et deux ans après j’en fais un roman. Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014) est né d’une chronique. Zabor aussi. Quand j’ai une idée, j’ai l’impression que, pour ne pas la perdre, ou pour lui donner corps, je l’écris en chronique, je la publie et j’y reviens ensuite sous la forme d’un roman. Pour Meursault, j’avais écrit la chronique en mars 2010 et le livre en 2011. Pour Zabor, la chronique en 2015 et le livre début 2017. C’est comme si je déterrais une idée : au début, il y a juste une partie et, plus je creuse, plus ça se développe.
Vous écrivez : « Lire, chez nous, se confondait avec le sens de la domination, pas avec le déchiffrement du monde ».
Lire, c’est lire le livre sacré. Un prêtre qui lit la Bible, face à des gens qui ne la lisent pas, est dans une position de domination. Zabor parle de ces gens qui connaissent le livre sacré par cœur et qui incarnent cette culture : celui qui possède le livre domine les autres. Dans ce cas, la lecture n’est pas liée à l’envie de déchiffrer le monde, mais de dominer. C’est le propre des livres sacrés : ils expliquent le monde une fois, définitivement, et ils empêchent toute autre explication. Ils sont dans une stratégie de domination, pas de cohabitation.
Mais Zabor découvre une autre forme de lecture, qui lui donne accès à la sexualité, au dévoilement du féminin, à la connaissance…
Imaginez, vous vivez dans un village où il n’y a rien. Un jour, vous vous mettez à lire et, tout d’un coup, le monde est là. Lire, c’est surmonter la pauvreté de son propre monde. C’est aussi un accès à l’altérité. Lire est essentiel. La preuve, on demande toujours : « Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? » Jamais : « Quelle paire de chaussures ? » ou « Quel genre de jus d’orange ? » Pourquoi ? Parce que la confrontation entre l’île déserte et le livre est fondamentale. On peut surmonter l’insularité et le désert avec un livre, pas avec une paire de chaussures. Lorsqu’on emporte un livre sur une île déserte, on a l’impression qu’on a les moyens de repeupler l’île. Robinson Crusoé a tout réinventé, mais il avait pris la Bible avec lui.
Revenons à la langue. Zabor va à l’école, il apprend à écrire le français et l’arabe ?
Pas exactement, la priorité est donnée à l’arabe, même si on lui inculque des rudiments de français. La priorité est donnée à la langue de l’enseignement de la loi. C’est par la suite qu’il découvre qu’il y a une langue alternative, clandestine, une langue du corps et du désir.
Et apprenant l’arabe de l’école, il voit que ça ne colle pas avec l’arabe de la vie quotidienne.
Il découvre qu’il y a un vide, que la langue quotidienne est pauvre. L’arabe de l’école est riche, mais il parle beaucoup de la mort, pas du vivant. La langue arabe de l’école nous enseignait l’histoire, les martyrs de la guerre de libération, les prophètes, les gloires d’antan, l’âge d’or, mais elle ne nous parlait jamais du vivant, de ce qui est maintenant, du nu, du cru et du cuit.
Parlant de l’arabe, Zabor dit : « Je souffrais de ne pas posséder une langue vive, puissante et riche ». Il ajoute : « Je découvrirais plus tard que c’est une langue riche, mais enseignée par des gens frustes au regard dur ». C’est aussi votre expérience ?
Absolument. Quand on oblige une langue à parler tout le temps d’un cadavre, elle finit par en avoir la couleur et le pourrissement. Et quand on prend une langue pour parler du désir, elle finit par en épouser les formes.
Cet enseignement de l’arabe, où l’avez-vous reçu ? Dans un village qui ressemble au village de Zabor ?
Plus que ça : Aboukir, le village de Zabor que je décris dans le livre, est précisément le village de mon enfance, dans l’ouest de l’Algérie. Aboukir (aujourd’hui Mesra) avait été fondé par des communards qui lui avaient donné ce nom en référence à l’Aboukir d’Égypte.
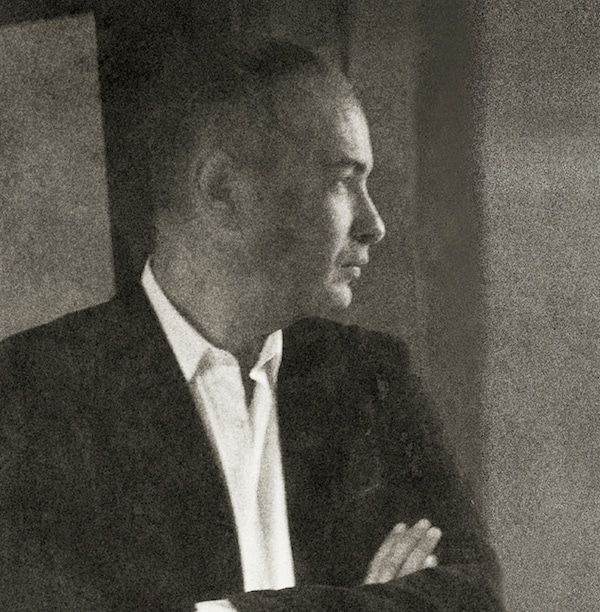
Kamel Daoud
Vous dédiez le livre à votre père qui vous a « légué l’alphabet » ; l’alphabet français ou l’arabe ?
Français. Mon père était mon seul lecteur, c’est le seul qui ait lu ce que j’écrivais, jusqu’à sa mort. Il n’a pas eu le temps de lire Meursault, il est mort au moment de sa publication en France. C’était un ancien militaire, très prude, très réservé. La seule langue dans laquelle il me communiquait ses sentiments, paradoxalement, c’était le français. Que ma mère ne maîtrisait pas. Je me souviens très bien du jour où il m’a enseigné l’alphabet. J’étais à la maison, il ne vivait pas avec nous. Il est venu et m’a vu en train d’écrire maladroitement les premières lettres. Et il m’a véritablement enseigné l’alphabet. Et là, je parle du moyen de déchiffrer le monde. Je l’ai dit, il était mon seul lecteur, mais un lecteur muet. Il n’a quasiment jamais commenté mes livres, mes chroniques ou quoi que ce soit, mais il les lisait tous les jours. Il n’a jamais rien dit, sauf trois ou quatre jours avant sa mort.
Et vous savez pourquoi il ne disait rien ?
Je crois que cette partie-là de sa vie – le français, la maîtrise de la langue, son rapport aux livres – relevait de son intimité. Ce qui est tu l’est en français. Ce qui est dit l’est en algérien. Je crois qu’il assumait son rôle de père dans cette langue algérienne. Sa sensibilité passait par la langue française, mais c’était un homme qui n’exprimait pas sa sensibilité, donc il se taisait. Et puis nous avions depuis toujours un rapport très conflictuel, très tendu. Il y avait chez lui une sorte de fierté, de rigidité aussi. Comme chez moi. J’ai fait de la littérature un acte de rébellion aussi contre lui.
Il y a des romans français qui apparaissent assez miraculeusement dans l’univers de Zabor, dans ce village loin de tout. À vous aussi, le français est apparu sous la forme de livres abandonnés par leurs anciens propriétaires français ?
C’est exactement mon histoire, c’est comme ça que j’ai découvert la langue française : Zabor est une autobiographie fabulée. Comme Zabor, j’avais très peu de livres, alors j’imaginais des histoires à partir de titres de romans (Paris est une fête, Vol de nuit, Les raisins de la colère, La peste…) Les titres, je les trouvais à la fin des quelques livres que je possédais. En dernière page, il y avait toujours une liste des ouvrages « à paraître ».
Ce rapport au français est sans doute difficile à comprendre pour vous qui êtes née avec cette langue. Moi, je suis né par cette langue. Je suis né au voyage, à la liberté, à la sexualité, à l’altérité, au reste du monde par cette langue, le français. Pour moi, ç’a été toute une aventure pour l’acquérir, la définir, la maîtriser, la sculpter, la dominer, me l’approprier. Pour quelqu’un dont c’est la langue maternelle, c’est bien sûr aussi une aventure de la maîtriser pour l’écrire, mais ce n’est pas le même capital de départ. Et donc pas le même sens fabuleux de l’aventure. Quand on est dans ma position, il s’agit de maîtriser une langue qui est l’expression de votre intimité mais aussi de votre clandestinité. Parce qu’elle n’est pas parlée, elle n’est pas là pour dire votre vie, mais ce que vous cachez. En même temps, ce roman est un hymne à la fiction et à l’art ou à l’envie ou à la nécessité d’écrire. Et ça, c’est extensible à toute aventure d’écriture.
La manière dont Zabor apprend la langue m’est personnelle. Tout comme l’est sa construction du dictionnaire. Jusqu’à vingt ans, je prononçais la chair de l’orshidée, parce que je ne savais pas. Encore aujourd’hui, je fais parfois des erreurs, parce que les mots, je les ai appris seul. Au début, c’était très difficile. Dire « feu Bernard » ou « une chapelle ardente », c’est difficile, parce que ça n’existe pas dans ma culture.
Zabor, c’est l’histoire de ma construction personnelle du dictionnaire. Mais la construction du dictionnaire est une aventure linguistique que chacun fait à sa façon. Chacun fait son Zabor.
Dans ce roman, vous dites au moins deux fois : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort ». Pourquoi le répéter ?
À la fois parce que c’est la croyance profonde du personnage. Et parce qu’il doute. La foi de Zabor s’accompagne d’un doute, il est obligé de se répéter pour être sûr : je fais quelque chose d’utile.
Quand Zabor écrit parce que c’est « la seule ruse efficace contre la mort », il parle de la mort des autres, peu de la sienne. L’écrivain, lui, écrit-il contre sa propre mort ou contre celle des autres ?
À un moment, Zabor se demande : « J’entretiens la vie des autres, mais qui va entretenir ma propre vie ? » Mais quand il écrit pour sauver la vie des autres, sa propre vie devient nécessaire. C’est une manière de surmonter la mort pour lui-même.
Mais vous, vous écrivez contre votre propre mort ? Contre celle des autres ?
Vous voulez mon intime conviction ? Je pense qu’on a tous des certitudes magiques, des certitudes qu’on met de côté, qui reviennent, qu’on habille. Mais cette certitude-là, que l’écriture peut contrer la mort, je pense que c’est une certitude magique profonde chez la totalité des écrivains. Il n’y a pas d’écriture sans fantasme d’éternité.
Propos recueillis par Natalie Levisalles












