Le Collège de France, créé il y a cinq siècles par François Ier, est la plus prestigieuse institution académique en France. Il a comme devise Docet omnia et comme mot d’ordre qu’on y enseigne la science en train de se faire. Mais les règles du choix des noms de ses chaires ont donné lieu, au fil des siècles, à des politiques complexes, dont cet ouvrage collectif retrace l’histoire. On y apprend autant sur les partages du savoir universitaire en France que sur les institutions qui le produisent.
Wolf Feuerhahn (dir.), La politique des chaires au Collège de France. Préface d’Antoine Compagnon. Les Belles Lettres/Collège de France, 560 p., 25 €
Le Collège de France n’est pas l’Académie de Lagado, où Gulliver rend visite à des chercheurs qui ont toute liberté de se consacrer à leurs marottes, l’un cherchant à extraire de la lumière des concombres, l’autre à retransformer des excréments en la nourriture dont ils proviennent, un autre encore ayant inventé une machine pré-oulipienne capable de produire au hasard des combinaisons de mots et telle que « la personne la plus ignorante sera, pour une somme modique et au prix d’un léger travail musculaire, capable d’écrire des livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de mathématiques et de théologie, sans le secours ni du génie ni de l’étude ». Le Collège de France n’est pas non plus le Centre national de la recherche scientifique, où l’on est chercheur à vie et où l’on n’enseigne pas. Mais il n’est pas un établissement universitaire comme un autre, puisque les cours sont publics et qu’on n’y délivre pas de diplômes.
Les savoirs enseignés au Collège sont en principe ceux qui le sont dans leurs dénominations usuelles à l’université : chaires de grec, de byzantinologie, de mathématiques ou d’histoire médiévale, par exemple. Mais on y enseigne aussi des disciplines qu’on ne trouve pas à l’université, et le savoir change : qui pourrait aujourd’hui occuper une chaire d’éloquence latine ou une chaire de droit de la nature et des gens ? Et les chaires du Collège ne sont pas comme les fauteuils numérotés de l’Académie française auxquels on est élu en sachant que c’est un cardinal ou un parolier qui vous précède. Une règle complexe veut que, pour faire acte de candidature, on rédige un projet de recherche et d’enseignement, mais aussi qu’on imagine un intitulé de chaire derrière lequel se profile le candidat et ses travaux, qui sera ensuite validé par l’assemblée des professeurs (qui d’autre que Claude Lévi-Strauss pouvait en 1959 être élu dans une chaire d’anthropologie sociale ?). Cette règle conduit à modifier, par des transformations subtiles, les intitulés initiaux, en sorte que, comme la reine de Blanche-Neige qui interroge son miroir, le candidat pourra se mirer lui-même dans son propre profil.
Mais ce ne fut pas toujours le cas. En lisant cet intéressant ouvrage collectif, qui s’inscrit dans une série de travaux sur l’histoire de cette institution, on apprend qu’il fut un temps où les chaires du Collège royal étaient comme des charges d’avocat ou d’avoué, héréditaires. Le fils faisait alors devant l’assemblée des professeurs l’éloge de son père (ainsi, Louis Havet est élu en 1885 en « philologie latine » sur la chaire d’éloquence latine d’Ernest Havet, et en 1931 Léon Brillouin est élu à la chaire de physique générale et mathématique à la suite de son père Marcel Brillouin). De telles coutumes nous semblent exotiques et pour le moins un peu en deçà des idéaux d’un savoir détaché des contingences sociales et politiques que porte cette institution. Mais sont-elles vraiment aujourd’hui si désuètes ? N’avons-nous pas lu jadis Les héritiers de Bourdieu et Passeron, qui n’a vieilli qu’en apparence, et ne savons-nous pas que, malgré nos règles de démocratie et de méritocratie dans la recherche et l’université, il existe encore des dynasties scientifiques et littéraires, même si elles sont moins visibles aujourd’hui ?
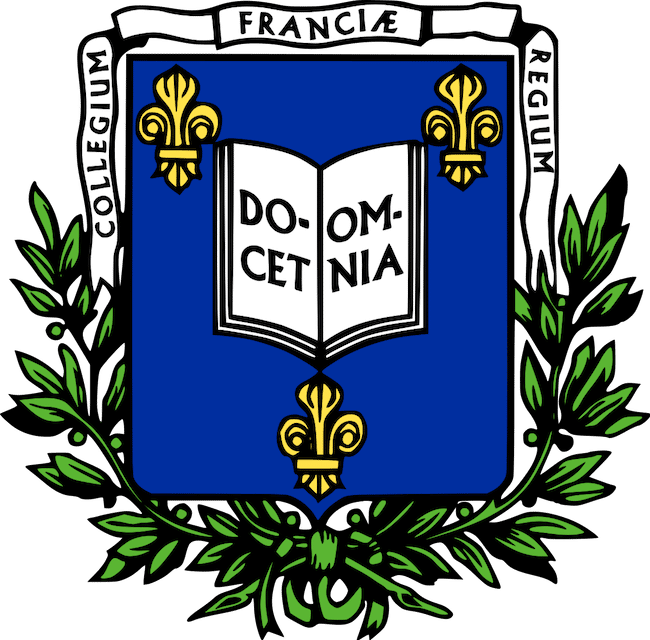
Les manières dont les intitulés de chaire au Collège de France changent au fil des siècles sont donc tout sauf anecdotiques. Elles révèlent non seulement les voies quelquefois impénétrables de « la science en train de se faire », mais aussi les déplacements tectoniques des savoirs et leur découpage au fil du temps – pour reprendre des expressions du directeur du volume – et les enjeux de politique universitaire et de politique tout court qui ont entouré les élections de professeurs. Les épisodes fameux – comme la suspension d’Ernest Renan de sa chaire d’hébreu en 1864, la nomination d’Alfred Loisy en 1909 – et d’autres moins connus détaillés ici, comme la formation d’une chaire de « science coloniale » et la non-élection de l’antidreyfusard Ferdinand Brunetière, ont des ressorts politiques et religieux. D’autres cas – comme la succession d’Étienne Gilson dans la chaire d’histoire de la philosophie confiée à Martial Guéroult au détriment de l’historien des sciences Alexandre Koyré – sont plus institutionnels mais néanmoins lourds de conséquences, dans la mesure où, à défaut d’avoir un véritable impact sur la production des thèses, les élections au Collège de France ont un pouvoir symbolique (dont témoignent les gloires de Bergson, de Foucault ou de Barthes, par exemple) et une influence sur les voies suivies par la recherche. On trouvera dans ce volume des études originales et savantes sur le devenir des chaires depuis le XVIe siècle, sur les jeux subtils entre les successions thématiques des chaires à partir de leur titulaire ou de leurs intitulés aussi bien dans les lettres (grec et latin, rhétorique) que dans les sciences (archéologie, mathématiques, géographie). Beaucoup de ces études (notamment celle de Jacqueline Carroy, Annick Ohayon et Régine Plas sur la psychologie) dessinent en filigrane l’histoire et le destin de plusieurs disciplines (les luttes entre philosophie et psychologie, puis entre psychologie et sociologie, jusqu’au triomphe des neurosciences).
Pourtant, en ce qui concerne la sociologie de cette institution si spéciale, je continue de penser que le témoignage de Maurice Halbwachs [1] nous en apprend plus sur la généalogie de la constitution des chaires que les discours savamment non nombrilesques de Pierre Bourdieu (Leçon sur la leçon) ou de Michel Foucault (L’ordre du discours). On peut aussi s’interroger sur les limites d’une analyse pour ainsi dire entomologique de cette institution, telle qu’elle est ici pratiquée. Chaque discipline y est analysée à travers ses étiquettes de chaires et les individus qui les occupent, sans que les œuvres, les personnalités, et surtout les programmes de recherche qu’ils ont portés plus ou moins bien, avec plus ou moins de succès public – le seul visible aux yeux de ceux qui n’appartiennent pas à l’université –, soient exposés ou seulement interrogés.

L’historien et le sociologue des institutions s’intéressent à la distribution des cartes, aux mises, aux levées des acteurs et aux coups qu’ils abattent. Mais en est-il de la production du savoir comme d’un jeu de cartes ? Comme le rappelle Wolf Feuerhahn, la singularité de cette institution ne peut faire oublier que le Collège fait partie du « jeu » universitaire français et international. Dès sa création, il s’est inscrit dans une relation de rivalité avec la Sorbonne, qui incarnait une université soumise à l’Église ou au pouvoir politique et un enseignement figé. Mais les autres institutions d’enseignement supérieur connaissent des débats tout aussi âpres et significatifs dans le choix de leurs professeurs, et ne sont pas toujours figées. Il suffit de rappeler que Durkheim, Poincaré ou Le Goff par exemple ne furent pas professeurs au Collège de France. Il n’y a aucune raison de penser que les discussions qui président au choix des chaires du Collège diffèrent tellement, en dépit de l’insularité de cette institution, de celles qui ont cours ailleurs, d’autant plus que la plupart de ses professeurs sont issus de l’université (et plus rarement, comme Paul Valéry ou Yves Bonnefoy, du monde des lettres). Ainsi, dans une étude intéressante sur le succès du thème « comparatiste » dans les noms des chaires (anatomie comparée, grammaire comparée, littérature comparée, anthropologie comparée, etc.), Pascale Rabault-Feuerhahn suggère-t-elle que Gilles Gaston Granger, qui occupa une chaire d’« épistémologie comparative » de 1986 à 1990, a pu adopter cet intitulé par simple souci d « affichage ». Mais c’est oublier que ce philosophe avait durant vingt ans enseigné et illustré ce qu’il dénommait déjà « épistémologie comparative » à Aix-en-Provence, et que le choix du titre de sa chaire n’avait rien de cosmétique ou de stratégique.
Il y a une limite dans la recherche des motivations des universitaires pour le choix des titres de leurs chaires dans les comptes rendus des assemblées des professeurs, car, même si les discussions qui ont pu mener à tels choix d’intitulés ou de personnes ne sont pas publiques ni consignées dans les archives de l’institution, on peut supposer que ces choix ont été motivés par des discussions scientifiques et des échanges d’arguments entre les pairs, et non pas simplement par des stratégies de pouvoir ou par le conservatisme [2]. La nécessité d’une histoire et d’une sociologie basées sur les raisons des acteurs se fait ici d’autant plus sentir qu’on a affaire à des acteurs du domaine du savoir.
-
« Ma campagne au Collège de France » (1944) in Revue d’histoire des sciences humaines, 1999, 1.
-
Ainsi, deux auteurs du volume voient dans l’élection de Guéroult contre Koyré la marque du seul conservatisme. Mais peut-être les partisans de Guéroult eurent-ils aussi des raisons scientifiques de le préférer à Koyré.











![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)
