Lire Kenneth White est toujours un étonnement. Rien en effet n’est plus éloigné de sa démarche que l’esprit de système, avec ses codes rigides, indéfiniment rabâchés, auxquels notre civilisation déclinante nous a habitués. Il sait que nous vivons dans un « monde flottant » dont il devient urgent de réinventer la navigation. S’il nous surprend ainsi, c’est qu’il ne parle pas de philosophie en philosophe, de littérature en littérateur, de société en sociologue, d’économie en économiste, mais il nous en parle en poète qu’il est viscéralement, intensément, et même là il serait difficile de le rattacher à un courant. Ce poète aime les chemins de traverse.
Kenneth White, Lettres aux derniers lettrés. Isolato, 130 p., 20 €
Le livre qu’il vient de publier aux éditions Isolato, Lettres aux derniers lettrés, en est une nouvelle fois l’illustration. Prenant appui sur Toynbee qu’il revisite, Kenneth White dresse un constat alarmant de la civilisation occidentale. De cette « désintégration » en passe de devenir universelle, il rappelle les étapes successives à travers l’Histoire et sur les différents plans, religieux, humaniste, politique, économique, technoscientifique, intellectuel. Le degré zéro est atteint, selon lui, avec la culture de masse où, plutôt que de privilégier la notion d’œuvre, avec ce qu’elle nécessite d’élévation de la part du lecteur ou du regardant, on préfère livrer au public des produits à faible valeur ajoutée intellectuelle ou sensible, mais à forte audience médiatique. Seule importe la capacité à faire de l’argent, quitte à contribuer à un « infantilisme généralisé ».
« La question qui reste est celle-ci : que faire dans tout cela, avec tout cela, éventuellement au-delà de tout cela ? Quelque chose comme une évolution créatrice (j’emprunte le terme à Bergson) est-elle possible », s’interroge alors l’auteur. Comme il le fit dans d’autres livres, Les affinités extrêmes ou La figure du dehors, c’est, dans un premier temps, vers de grands écrivains porteurs de sens, extirpés du fatras d’une littérature à vocation le plus souvent sociologisante, sentimentale ou soporifique, qu’il se tourne. Si ceux qu’il évoque sont universels, c’est d’abord parce qu’ils sont singuliers, représentatifs de la culture de leur pays tout en se situant dans « un espace-temps plus large ». Mais Kenneth White ne les interroge pas dans leurs écrits en tant que tels, il ne fait pas du commentaire de texte. Il cherche plutôt dans une œuvre ce qui sort de la littérature ou de la philosophie pour voyager ailleurs ou autrement, ce qui va vers un élargissement, une synthèse ou une voie nouvelle.
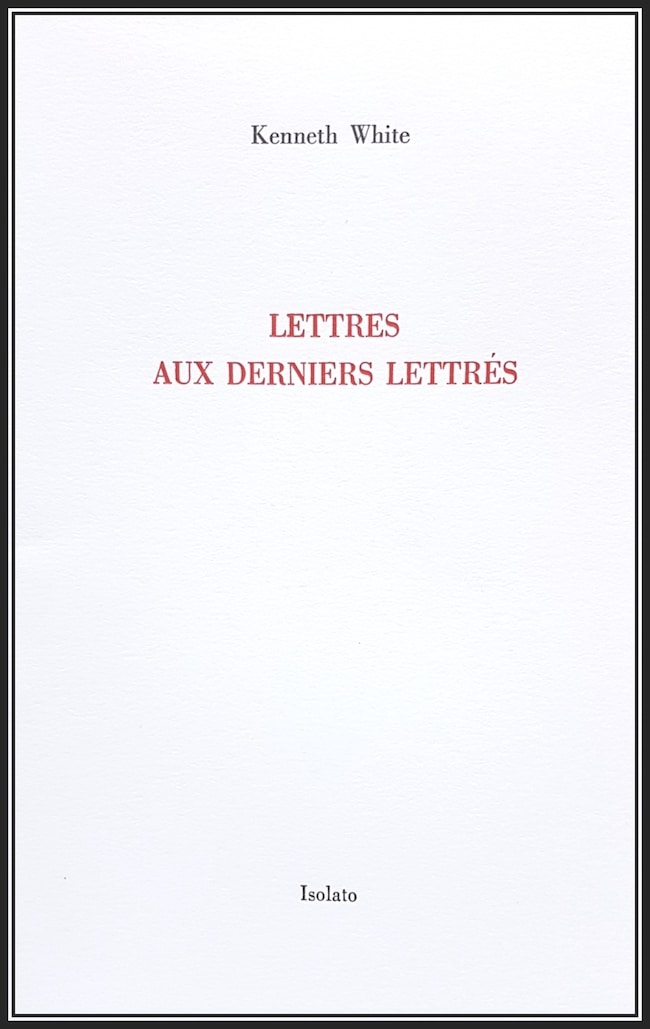
Ainsi, selon les apparences, personne n’est plus slavophile que Dostoïevski ; pourtant, toute sa jeunesse a été pétrie de littérature française et, à la fin de sa vie, dans son « Discours sur Pouchkine », il prêche la réconciliation avec le « parti des Occidentaux » et se prend à rêver d’un « homme universel ». C’est cette ouverture qui intéresse Kenneth White, même si, messianisme oblige, cet « homme universel » prôné par Dostoïevski présente toutes les caractéristiques du « Russe universel ». Chez Goethe, White retient le concept de Weltliteratur, de « littérature mondiale », que l’écrivain allemand a surtout évoqué dans sa « Préface à la traduction allemande de la vie de Schiller », écrite en anglais par Carlyle, et dans ses multiples notes où il célèbre, avec une rare pertinence et une érudition impressionnante les littératures du monde entier.
Mais c’est la démarche scientifique de Goethe qui passionne White, il y discerne les prémices d’une poésie-monde dont il se sent proche. Il ne s’agit pas seulement pour le poète de « peindre l’homme intérieur », il lui faut aussi apprendre à connaître le « dehors », la nature, dans son flux incessant, en faisant abstraction de la subjectivité. Ainsi que l’écrit Goethe : « Du moment que nous considérons un objet en lui-même, ou en rapport avec les autres, et qu’il ne nous inspire ni désir ni antipathie, alors nous pouvons, à l’aide d’une attention calme et soutenue, nous faire une idée assez nette de l’objet en lui-même, de ses parties et de ses rapports. » Dans cette approche, même si elle n’est pas statique – la vision de Goethe est dynamique –, l’homme et le monde restent encore séparés. Kenneth White va plus loin. Il remet en question cette croyance que « le développement se fait de l’intérieur vers l’extérieur » et qu’il faut réduire le monde, par les techniques, à l’utilitaire. Il préconise une conception plus subtile : « Au lieu d’aller de l’intérieur vers l’extérieur, le développement va de l’extérieur à l’intérieur. Un poisson ne préexiste pas à l’eau, il est dans l’eau et par l’eau. C’est l’extérieur, la détermination de l’élément extérieur, qui lui donne son existence. Et la même chose s’applique à l’homme. Il ne s’agit pas d’un simple déterminisme social, mais de l’ouverture à des influx, à des influences, à des inspirations, en vue du développement maximal de l’être. »
Le monde se réinvente à chaque instant. Ce n’est pas un chaos, mais un ordre en mouvement que nos concepts habituels sont inaptes à décrire. « Si le savoir, si la vision du monde n’avance pas, écrit White, c’est qu’elle est bloquée par une terminologie conventionnelle. Un autre langage est nécessaire, qui donne une idée plus grande et plus ouverte de l’univers : un langage maximal, avec un nouveau lexique. » C’est dans cet esprit qu’il cherche à développer ce qu’il appelle « l’écriture géopoétique ». Comme avec Nietzsche pour la philosophie, avec Rimbaud pour la littérature, il faut sortir des cadres de la pensée, adopter un « nomadisme intellectuel », prendre des chemins de traverse pour découvrir un nouvel espace : « Je dirais aussi que l’écriture géopoétique, c’est d’abord la tentative de se situer dans le plus large espace possible. C’est le moyen d’ouvrir un monde. » Ce qui implique d’en revenir à la perception, qui est chez Kenneth White une perception poétique, pour reconsidérer d’un œil neuf toutes les sciences, humaines ou dites exactes, et tous les arts. Immense chantier.











