
Jorge Luis Borges
Intellectuellement, nos vingt ans furent placés sous le signe de Nizan. Moins Les chiens de garde, qui me passait au-dessus de la tête, qu’Aden Arabie avec la longue préface de Sartre. Obsédé par l’idée que je ne pouvais être au « plus bel âge de la vie », j’étais abominablement sérieux. Sans doute le suis-je encore.
On me dit que je devais lire Borges, en l’occurrence il devait s’agir de L’Aleph. Je me nourrissais déjà de philosophie grecque et, dans ce livre dont on m’avait assuré qu’il me séduirait, j’ai rencontré une bourde ou ce qui me parut tel, concernant, je crois les pythagoriciens. Je ne sais plus exactement de quoi il s’agissait mais j’ai un souvenir très précis de l’espèce de scandale intellectuel que suscita en moi cette découverte d’une erreur, d’une approximation pour le moins, chez un auteur que l’on me vantait comme érudit. Il me fallut plusieurs années pour retourner vers Borges, que j’ai lu depuis avec passion.
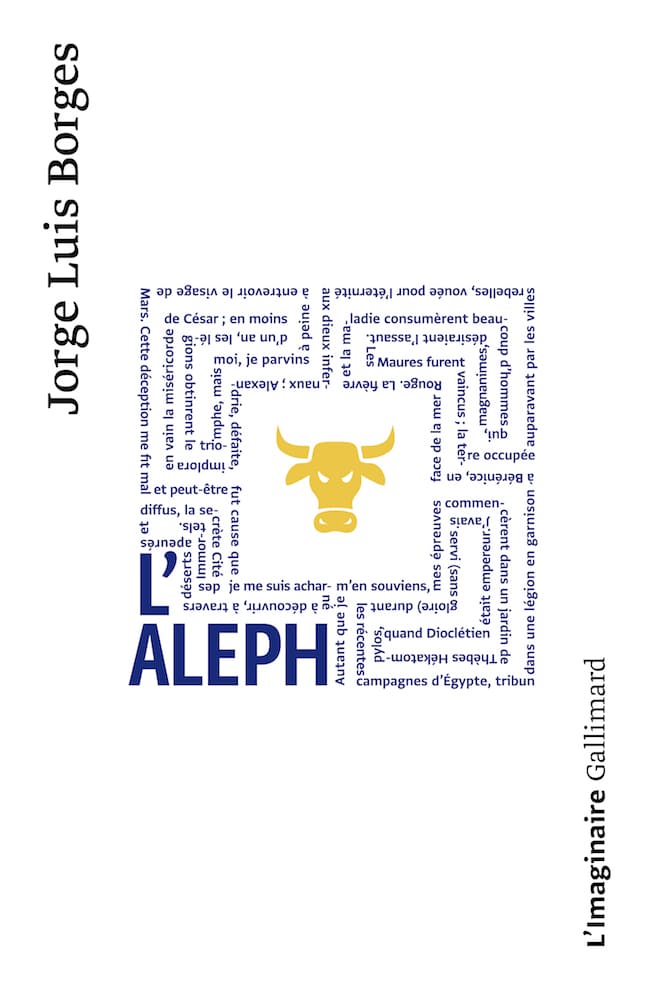
Pour autant que je m’en souvienne, je n’avais pas tort de voir dans ce détail une erreur. Mon tort était ailleurs, c’était de n’avoir rien compris à la démarche de Borges, ni, sans doute, à tout un pan de la littérature. Ce qu’il en est de l’imaginaire.
Avec le temps, j’espère être devenu un peu moins bête. Mais, bien sûr, je n’ai plus vingt ans.












