On pourrait établir une liste des personnages à la langue coupée. En littérature, outre les figures muettes de Samuel Beckett, il y a bien sûr l’enfant Canetti dans La Langue sauvée et Vendredi, l’esclave torturé de Foe, de John Maxwell Coetzee. Il serait possible d’y ajouter par métaphore le narrateur de L’oubli, le nouveau roman de Philippe Forest. Dans son sommeil, il a laissé un mot. Un morceau de langue lui manque. Tout commence par cette lacune. Du moins l’affirme-t-il au départ, avec une si grande conviction, une telle foi dans le langage, qu’elle lui cache la profondeur de sa perte. Celle-ci apparaîtra avec la vraie découverte de son initiation négative : que les mots restants ne révèlent pas le souvenir, mais au contraire consolident l’oubli, la mémoire vraie. Et donc qu’une langue amputée n’est pas inutile pour autant.
Philippe Forest, L’oubli. Gallimard, 235 p., 19 €
Ce n’est peut-être pas un mot qui manque à cet homme, et lui-même ne correspond peut-être pas à celui qui l’a perdu. Son identité n’est pas vraiment l’affaire : son aventure le dépasse. « Quelque chose a eu lieu. Cela vous revient par surprise. On l’a vécu, on l’a rêvé. Puis on l’a oublié. Jusqu’à ce que, au sein même du présent, s’ouvre une sorte de petite porte donnant sur le jadis. » Un double récit s’ouvre alors, celui d’une enquête et celui d’un voyage.
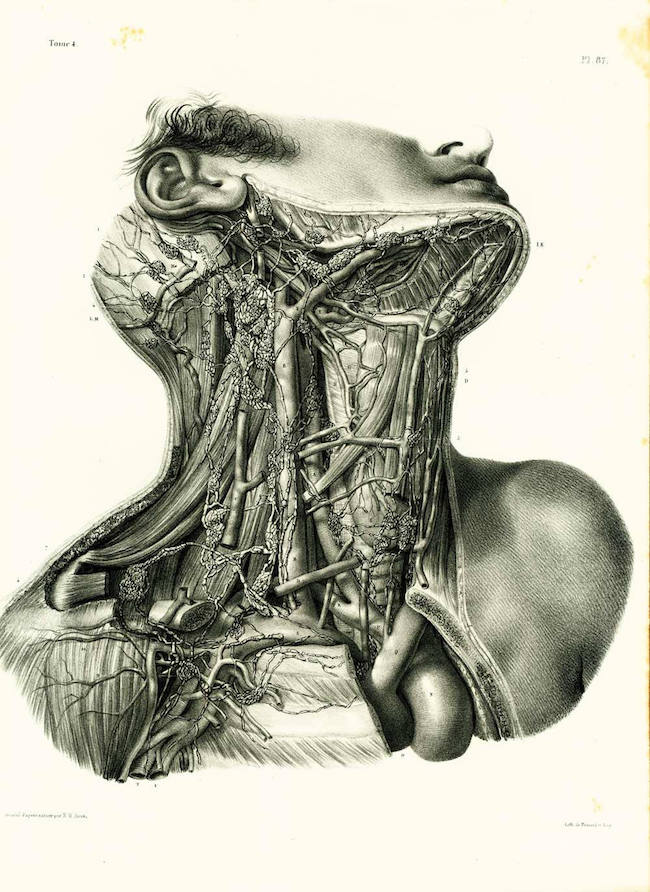
Dans le premier, introspectif, obsessionnel, le jeu de piste organisé autour du mot perdu appelle le lecteur à repérer des indices. L’oubli prend l’apparence d’une chasse au trésor, menée par un enfant solitaire et inquiet. L’enquête ne se déroule pas sans mélancolie, ni sans excitation. Que se passe-t-il lorsqu’un mot, une idée disparaît ? Pour quelle raison certains mots – pas n’importe lesquels – restent-ils accrochés, un instant, parfois plus longtemps, le temps qu’ils veulent, et sans qu’on puisse parfois les rattraper, sur le bout de la langue ? Si on les prend au sérieux, de tels événements, ordinaires mais essentiels, peuvent donner accès à un envers du langage, à sa part absente, souterraine. Le narrateur, qui compare sans cesse son aventure à une maladie, semble peu à peu quitter une longue convalescence. L’oubli raconte cet éveil, ce difficile ré-apprentissage : trouver ses mots sous la gangue de l’ordinaire, de l’usuel.
« Le langage reprenait progressivement l’apparence insolite que je lui avais trouvée enfant lorsque je l’avais découvert. » À l’âge adulte, des mots butent les uns contre les autres, signalent une zone de douleur à dénouer. Écorchée à vif, la langue elle-même a été meurtrie, privée d’une partie essentielle. L’expression fait erreur, elle se joue de nous, il y a méprise : les mots qu’on cherche ne se trouvent pas sur le bout de la langue, mais au-delà. Le morceau de langue arraché s’est éloigné. Les membres amputés, atrophiés, dénotent le passé invisible d’un homme. Celui de L’oubli a une langue coupée. Elle cicatrise avec lenteur.

Philippe Forest © Catherine Hélie
Privé de cette partie de lui-même contenue dans le mot en-allé, il ne le cherche bientôt plus de manière directe. Il passe par des détours. Il observe ce qui peut rattacher son expérience à celle des autres. Nous sommes reliés par la dégradation des mots : « Partout, le langage dont usaient les hommes partait en lambeaux. » Sur le bout coupé de leur langue, tous les hommes ont laissé un peu de langage et de passé. « Le mot que tous les hommes, un jour, avaient semblablement égaré était-il le même ? Ou bien : s’agissait-il d’un mot chaque fois différent et propre à la personne qui l’avait perdu ? »
Le second récit entrelacé dans L’oubli, qu’on dira de voyage, se situe à une lisière. C’est une île indéterminée, longée de ferrys qui la rattachent au continent, et où la présence du grand océan jaillit d’une baleine échouée sur la plage. Dans cette terre abandonnée aux artistes, tout se passe à un seuil séparant, ou reliant, la veille au sommeil, le monde des jours et celui des nuits. Rien, dans cet espace frontalier, n’est jamais clos, ni fini ; tout commence toujours. La libraire, la femme aimée, le peintre, chaque présence humaine ne fait qu’apparaître. « On a toujours intérêt à en dire aussi peu que possible, je crois », dit ce narrateur qui pourrait être le même que le précédent (il en a le ton grave) et un autre (il n’est plus obsédé par les mots, mais par les images). Dès le départ, Philippe Forest dissimule l’autre jeu de piste du roman, vaste devinette narrative, cache-cache général où circulent l’auteur de L’enfant éternel (Gallimard, 1997) et celui de Crue (2016), l’autobiographe endeuillé et le créateur d’étranges fables.

Les mots qui restent à cet homme ne sont pas à jeter. Comme la queue du lézard, une langue coupée bouge encore. Il n’écrit pas à défaut. Il lutte à l’aide de ses membres valides pour organiser un récit minimal, évanescent, lacunaire. Tout le texte est ainsi : respectueux de la perte advenue, et donc inopérant pour toute entreprise totalisante. L’énergie de la perte le fait tenir debout. On ne dira pas le magnifique retournement au cœur de L’oubli. Dans la continuité de l’île, il ne clôt aucune signification. Il laisse la possibilité au lecteur d’y déposer son passé. Mais s’agit-il de mots en moins, ou plutôt de mots de trop ? La bonne place de certains morceaux de langue, saturés, abîmés, périmés, se trouve peut-être dans un coffre d’oubli. Là où, plus ou moins volontairement, des hommes blessés les laissent reposer.












