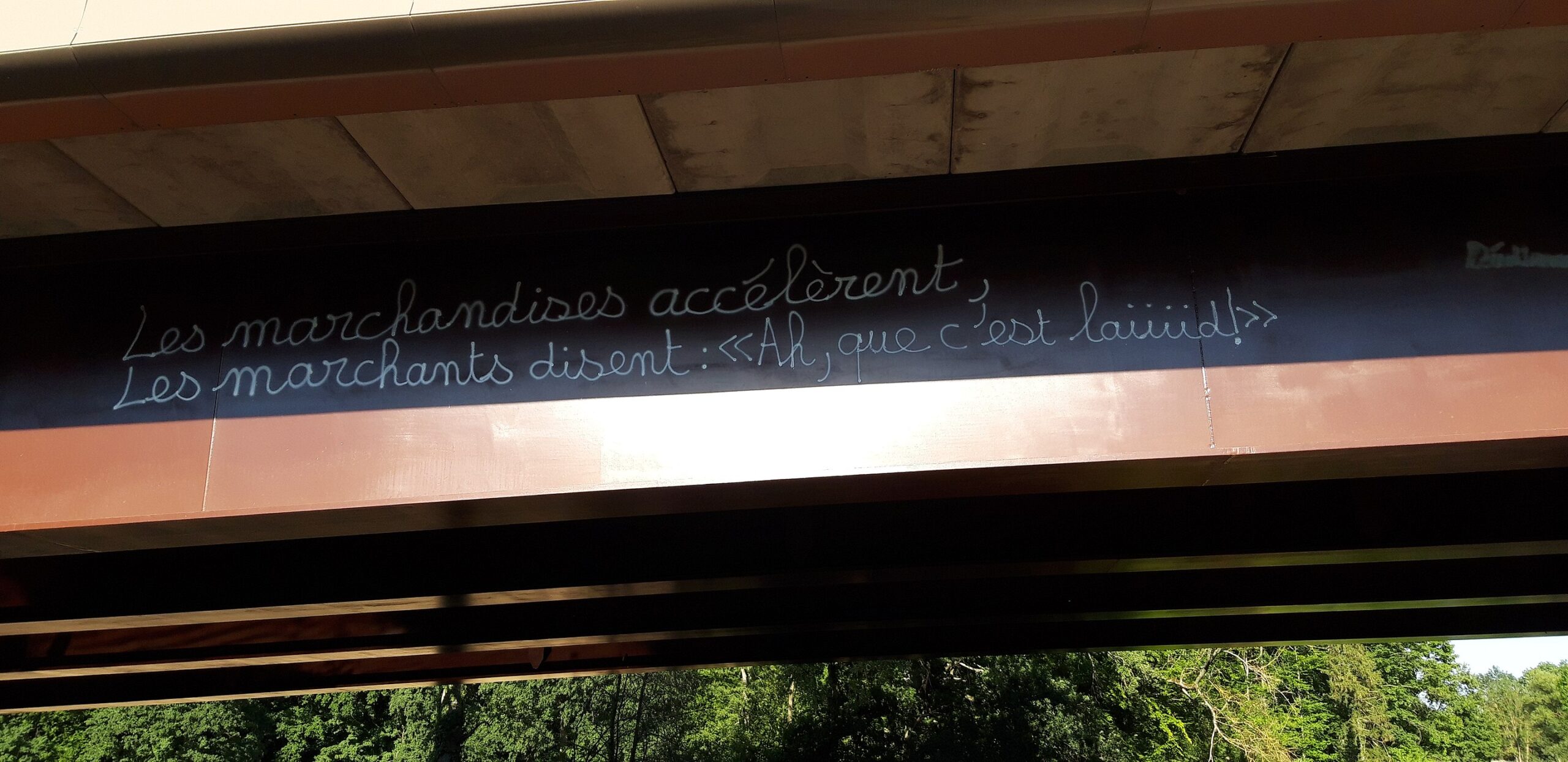À force de répéter que l’histoire est écrite par les vainqueurs, on en vient à oublier de s’interroger sur les défaites que ne manquèrent pas de subir même les plus puissants conquérants. Il est vrai que, s’agissant d’un passé aussi lointain que la Rome antérieure aux guerres puniques, l’historien est privé de tout document écrit à peu près contemporain des évènements. Tite-Live, à qui l’on fit longtemps une confiance aveugle, écrit plusieurs siècles après les faits.
Mathieu Engerbeaud, Rome devant la défaite (753-264). Les Belles Lettres/Ministère de la Défense, 596 p., 29,50 €
Voilà pourquoi l’historien doit, avant même toute considération idéologique sur la volonté des Romains de se présenter en éternels vainqueurs, se demander ce qu’il peut savoir de ces défaites si mal connues. Car, durant ce premier demi-millénaire de Rome, nul étranger ne s’intéresse à ce qui se passe en Italie, fût-ce pour dénoncer l’impérialisme de cette cité. Alexandre n’a même pas eu l’idée qu’il aurait pu être fructueux de tourner ses armes vers l’ouest plutôt que vers l’est. Point donc de textes qui nous soient parvenus, dénonçant le comportement des Romains entre 753 et 264 av. J.-C. Et, à supposer qu’une stèle, une série monétaire, un ex-voto, une fresque dans une tombe, glorifie tel vainqueur de Rome et que cette interprétation soit assurée, on n’aurait pas de raisons de penser que cette contre-propagande serait plus fondée en vérité que ce qu’écrit Tite-Live. Comme il est de l’essence d’un roi d’être toujours vainqueur – puisqu’il tire sa légitimité de sa puissance guerrière –, les propagandistes des rois qui se sont opposés à Rome les présentent en vainqueurs, ce qui ne saurait prouver que Rome a été vaincue par eux. Il va de soi que les rois de Rome – même Tarquin – ne peuvent pas non plus avoir subi de défaite militaire. Celle de Romulus face aux Sabins nous paraît manifeste puisque le fondateur est contraint de partager son pouvoir avec un souverain étranger, Titus Tatius. Pourtant, Tite-Live donne à ce désastre « une dimension valorisante car le récit de cet évènement aboutit à renforcer la cohésion de la cité ».

Les Gaulois en vue de Rome, par Évariste Vital Luminais
Une autre difficulté pour l’historien d’aujourd’hui tient au fait que les Anciens n’ont pas de concept de la défaite comparable au nôtre, alors que, bien sûr, ils en ont un pour la victoire, cette déesse sous les auspices de laquelle travaillent les sénateurs dans la Curie. Ce n’est pas seulement que manque le mot, il y en aurait même plusieurs, c’est surtout qu’ils ne se représentent pas la guerre comme nous le faisons depuis la Renaissance, avec ces belles batailles décisives au soir desquelles on sait qui est vainqueur et qui vaincu. Le risque est donc grand de l’illusoire clarté, y compris quand il arrive que les historiens évoquent sans ambiguïté une défaite, comme la prise de Rome par les Gaulois ou les Fourches Caudines : il semble bien que l’on puisse à leur propos parler d’une « fabrication livienne des désastres ». Insister sur une défaite peut en effet apparaître comme une manière « d’amplifier la victoire prochaine ».
Certains cas sont encore plus troublants, car il arrive que les mêmes affrontements soient présentés selon des logiques contradictoires. Ainsi de la bataille des « bois Aorniens » qui, en 311, oppose l’armée romaine aux Samnites. Ceux-ci tendent une embuscade dans une forêt très dense, en utilisant un troupeau comme appât. Dans la version de Tite-Live, le consul Bubulcus voue un temple à la déesse Salus, grâce à quoi le cours de cette bataille mal engagée s’inverse et les Romains tuent 20 000 Samnites. Dans la version du Byzantin Zonaras, sans doute inspirée de celle de Dion Cassius, ce sont les Samnites qui massacrent toute l’armée romaine jusqu’au dernier soldat. La tâche de l’historien d’aujourd’hui est alors de chercher à identifier l’origine de cette contradiction. Dans le cas précis, l’explication est peut-être à trouver dans l’image négative, à l’époque impériale, des descendants du consul Bubulcus après que l’un d’entre eux a participé aux Ides de mars. Populaire sous la République, ce lignage ne l’est plus quand l’Empire se réclame de César : la gloire portée par le nom d’un tyrannicide apparaît comme une menace pour la stabilité du régime.

Il arrive tout de même que Rome subisse une défaite incontestable ; il s’agit alors d’en évaluer le retentissement. Si l’on prend l’humiliation des Fourches Caudines, il n’est pas difficile de mesurer le poids de la honte ressentie par ces soldats qui y ont perdu leur uirtus. Tite-Live s’attarde longuement à décrire la réaction des soldats romains vaincus. Trop peut-être car il semble bien qu’on soit là devant la construction de la défaite exemplaire. Non que l’humiliation n’ait pas eu lieu mais il est probable qu’au fil du temps elle ne soit que la dernière répétition d’un épisode en rien exceptionnel. Et l’on peut penser que « l’interprétation de cet épisode à la fin de la période républicaine a considérablement aggravé la portée de cette défaite ». Une humiliation en 321 ne saurait avoir la même portée que si elle s’était produite un demi-millénaire plus tard, quand Rome serait maîtresse de la totalité du monde connu. On voit bien quelle peut être la portée idéologique de la mise en scène appuyée d’une défaite comme celle-là ou comme le sac de Rome par les Gaulois : l’orgueil national est en jeu, certes, mais il s’agit surtout d’insister sur « la capacité des Romains à s’unir dans la crise après avoir surmonté une première phase de panique ». Telle est la leçon qu’il convient de tirer des pires défaites, que les historiens des époques postérieures mettent en scène pour exalter le patriotisme.
C’est ainsi que, paradoxalement, la défaite « participe à la construction d’un discours impérialiste ». Dès Polybe, contemporain des guerres puniques et familier de Scipion, la capacité de « surmonter chaque défaite est perçue comme une spécificité romaine » qui explique l’extension de son imperium. La question se pose évidemment de savoir dans quelle mesure il s’agit bien là d’une spécificité romaine plutôt que d’une mise en scène historiographique élaborée après coup, par des historiens qui voient réalisée cette expansion. Rome aurait ainsi appris à transformer ses défaites en autant de leçons militaires et morales. Cette posture victorieuse est à la fois anachronique – les historiens de l’époque impériale attribuent à la Rome des premiers siècles une prééminence politique et militaire que celle-ci était loin d’avoir d’ores et déjà acquise – et fondée sur l’évidence que tous les adversaires d’un moment finiront par lui prêter allégeance. La pax romana doit être méritée par le vaincu, à qui elle sera accordée s’il accepte les conditions imposées par les Romains. Dès lors que tous auront prêté allégeance, la paix sera possible.

Les Sabines, par Jacques-Louis David (1799)
Ce discours historiographique, qui met en scène la capacité qu’ont les Romains de surmonter les défaites grâce à leurs vertus traditionnelles et à leur pragmatisme, est un bon moyen de justifier l’hégémonie de Rome et de la faire accepter par les descendants des nombreux peuples vaincus qui, en Italie d’abord, ont acquis la citoyenneté. En ce sens, on est clairement devant des constructions idéologiques dont la fonction n’a rien de mystérieux, mais qui sont beaucoup plus subtiles que l’idée simple selon laquelle ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire. Sans doute le font-ils, mais pas forcément pour se présenter en éternels vainqueurs : il peut être plus profitable d’insister sur quelques défaites subies afin de montrer la force morale et politique de ceux qui sont aptes à dépasser les pires désastres.
En analysant avec une grande finesse la présentation que l’historiographie romaine nous a transmise de la défaite, Mathieu Engerbeaud fait bien plus que nous livrer une belle étude historique sur des faits mal connus ; il signe une admirable réflexion sur la discipline historique et les usages qui peuvent en être faits. Même si ce n’est pas l’objet du livre, il n’est pas interdit de penser à la façon dont tels impérialismes modernes savent eux aussi mettre en scène leurs propres défaites afin de présenter la manière dont ils les dépassent comme autant de preuves de leur propre supériorité. Eux aussi ne font jamais que des guerres justes…