L’ouvrage que l’anthropologue colombienne Mara Viveros consacre aux « couleurs de la masculinité » fera date. Spécialiste des études de genre [1], qui se cantonnent souvent à l’étude de la condition des femmes, elle entend faire reconnaître la masculinité comme thème de recherche légitime. Elle part pour cela de l’expérience des hommes colombiens, mais la force théorique de ce qu’elle propose et l’ensemble de ses éléments d’analyses sont transposables, avec les amendements nécessaires, à toutes les sociétés humaines. Elle pose d’emblée qu’il existe de nombreuses masculinités, que celles-ci se construisent de façons différentes et différenciées, selon les rapports sociaux (de classe, d’âge, de race, d’ethnicité, de couleur de peau et, puisqu’il est question de la Colombie, de région). C’est cet entrecroisement qu’on appelle aujourd’hui « intersectionnalité ».
Mara Viveros Vigoya, Les couleurs de la masculinité. Expériences intersectionnelles et pratiques de pouvoir en Amérique latine. Trad. de l’espagnol (Colombie) par Hélène Bretin. La Découverte, 231 p., 19 €
La question de la race et de la couleur de la peau, qui devient aussi, pour Mara Viveros, couleur du genre et couleur de la sexualité, est essentielle dans un pays comme la Colombie qui est une société pigmentocratique. Les classes sociales, mais aussi les régions, y ont des couleurs de peau « dans le sens où, généralement, les personnes et les familles les plus dotées en capitaux (social, culturel, scolaire, économique, symbolique, etc.) sont plus ‟claires” et inversement, celles qui en sont moins dotées sont plus ‟sombres” ». Les représentations que se font les hommes de ce qu’ils vivent, la manière dont ils se comportent dans leur travail, en famille, mais également en politique, sont liées aux classements ethno-raciaux et sociaux qui leur assignent des places différentes et inégales.
Le discours multiculturaliste tenu par l’État masque ces rapports de domination, tout comme la notion d’Amérique latine, issue du processus d’indépendance initié au XIXe siècle par les élites créoles descendantes de la population européenne, a permis, avec sa proposition de latinité, « d’effacer ou de dévaluer la participation des indigènes et des afrodescendants à ces nations ». À la suite du Cubain José Marti, Mara Viveros préfère parler de « Notre Amérique », pour distinguer cet espace géographique et culturel de l’Amérique anglo-saxonne. Bien des stéréotypes circulent à son propos, et d’abord celui du « machisme latino-américain », terme mystificateur qui constitue le sexisme des hommes en phénomène de nature. Mara Viveros montre au contraire que la domination masculine est « un processus paradoxal, kaléidoscopique, dynamique et historiquement déterminé dans lequel interviennent de multiples variables qui ne s’additionnent pas nécessairement et peuvent être distinctives ».
Certes, il existe des normes hégémoniques de la masculinité, des idéaux de la masculinité qui, dans Notre Amérique, ont été construits en lien avec ceux de la race et de la nation. Cette masculinité hégémonique et blanche, c’est celle qu’a incarnée le président colombien Alvaro Uribe, « l’homme que les Colombiens ont élu parce qu’il porte le pantalon ». L’image qu’Uribe donnait de lui était celle d’un homme austère, discipliné, infatigable, avec une capacité de travail exceptionnelle, mais aussi celle d’un père et d’un guerrier prêt à mener une guerre totale pour défendre une nation féminisée et soumise aux menaces de son ennemi intérieur (la guérilla). L’emprise de cette image a été tellement forte que c’est grâce à elle, selon Mara Viveros, que tous les scandales liés à Alvaro Uribe ont glissé sur celui qui a été surnommé le président Teflon (sur qui rien n’attache).

Mara Viveros Vigoya
Originaire de la zone caféière, dite paisa, de la Colombie, marquée à la fois par un pourcentage plus important que dans le reste du pays de population phénotypiquement blanche, avec une sous-culture d’élite persuadée d’appartenir à « une race vigoureuse et entreprenante », excluant l’héritage africain ou indigène, Uribe a repris un certain nombre de traits de l’identité masculine qui y prévaut. Il en a tiré d’importants bénéfices politiques. Tous les hommes n’adhèrent cependant pas à ces normes de masculinité. C’est le cas, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes dominés, paysans, « Indiens », Noirs, mais aussi des dissidents sexuels ou des personnes en situation de handicap.
À côté de cette masculinité hégémonique qui tend à imposer et à reproduire ses normes et son code d’honneur sexuel qui pèse lourdement sur les femmes, existent d’autres masculinités. Mara Viveros évoque ainsi, à propos de certaines lesbiennes dont les manières de faire « s’apparentent plus à la masculinité qu’à la féminité », la possibilité de penser la masculinité sans hommes biologiques. Elle évoque aussi les hommes trans et « leur rapide capacité d’indifférenciation sexuelle ». Ces sexualités et ces multiples expériences identitaires ne peuvent cependant pas être comprises hors des contextes sociaux et culturels dans lesquels elles s’expriment.
Mara Viveros consacre surtout un long et très important chapitre aux masculinités noires ou plutôt aux corps noirs masculins. Car c’est à partir de leur corps, de la couleur de leur peau et de leur façon d’occuper l’espace que les hommes noirs sont perçus en Colombie. Elle rappelle comment, à partir du siècle des Lumières et de la division coloniale du monde, l’« Africain » devint la « personne de la peau », le sujet défini en termes épidermiques, face à l’Européen devenu la « personne de l’œil » et défini en termes scopiques. À ce « schéma épidermique racial » comme le disait Frantz Fanon, s’ajoutent une série de stéréotypes sur la sexualité des hommes noirs considérés comme des « êtres naturellement dionysiaques ». Mais aujourd’hui s’affirment des subjectivités noires qui ne se contentent pas d’affirmer que la peau noire est belle (« Black is beautiful »), mais qui pensent « au-dessous » de la peau. Elles s’expriment à travers des productions intellectuelles majeures et différentes performances artistiques, ébranlant, « ne serait-ce que temporairement, les fondements irraisonnés et violents de la réification ».
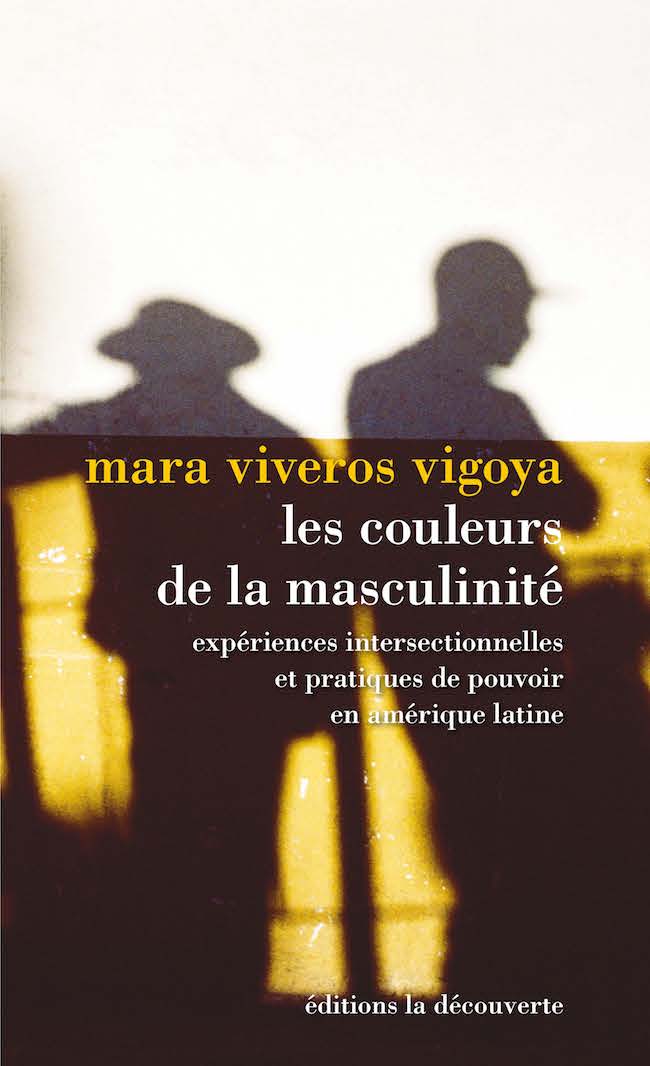
Reste la question majeure de la violence dont un grand nombre de femmes sont victimes en Notre Amérique, en particulier lors de conflits armés. Mara Viveros refuse l’idée qu’il pourrait y avoir une propension naturelle des hommes à exercer la violence. Elle rappelle que cette violence est inscrite dans l’origine même de cet ensemble politico-culturel : « L’histoire de la région est un bon exemple de la transposition entre la violence de type structurel issue de la conquête et de la colonisation, et la violence symbolique, domestique et intime dont furent victimes les femmes et les hommes colonisés, placés en position de subordination dans la hiérarchie des masculinités ». Les hommes dominés, soumis à la suprématie des hommes blancs, riches et hétérosexuels, agissent souvent « comme s’ils pensaient que renforcer leur masculinité et leur autorité sur les femmes était une condition essentielle de leur émancipation ». Tout projet visant à réduire la violence de genre doit prendre en compte la complexité et la multiplicité de ces facteurs. Le travail de Mara Viveros peut y contribuer ; son travail, mais également son expérience personnelle.
Mara Viveros interroge la société colombienne à partir de son propre vécu de femme noire, c’est-à-dire pas « juste » une femme. Comme les théoriciennes du Black Feminism qui l’ont précédée dans cette démarche, elle cherche, à travers ce qu’elle écrit, à construire des rapports d’alliance et non d’opposition avec les hommes de sa communauté et à comprendre simultanément les particularités du sexisme vécu par les femmes noires. Son livre, dont chaque chapitre peut être lu séparément, apporte des instruments théoriques fondamentaux. Mais il est riche, également, d’une expérience irremplaçable. Un grand livre. Une contribution décisive à ce que l’on appelle aujourd’hui le féminisme décolonial, et qui tient compte de l’ensemble des dimensions à travers lesquelles se font et se défont les vies humaines.
-
Il est peut-être utile de rappeler que le concept de « genre » permet de penser la construction sociale, historique et culturelle de ce que devrait être une femme ou un homme, et définit également ces catégories symboliques que sont le féminin et le masculin. Le genre se distingue donc du sexe biologique, et peut être également considéré comme un moyen d’articuler des relations de pouvoir, le masculin renvoyant généralement à la domination, alors que le féminin signifie et symbolise la soumission.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
