Le chemin s’allonge au fur et à mesure, le front se cogne à lui-même, celui qu’on cherche habite juste à côté. Attendre quelqu’un l’empêche de venir. On a beau s’approcher du château, on s’en éloigne d’autant, le but est son inaccessibilité même. Il n’y a pas d’aboutissement, pas d’accès chez Kafka.
Franz Kafka, Derniers cahiers. Trad. de l’allemand et présenté par Robert Kahn. Nous, 298 p., 22 €

Cet inaccès est la face visible de la « tension-vers » dont les personnages de ses récits sont constitués. Chaque pas est sa propre annulation. De même, comme le fait judicieusement remarquer Robert Kahn, le traducteur de ces Derniers cahiers : « le non-achèvement, en tant qu’il autorise toutes les lectures, est, on le sait bien, l’arme essentielle de Kafka dans son combat contre le monde, ce ‟jeu à somme nulle” puisque le lecteur gagne toujours »… et perd toujours. Le lecteur de Kafka est lui-même le centre de sa lecture, à travers lui s’établit, peut-être, le point d’origine, de fuite insaisissable de ce sentiment d’exister qui lui est propre et ne lui appartient pas. C’est bien pour cette raison qu’il n’y a pas, à vrai dire, de contresens dans les lectures de Kafka, universellement partagé.
L’effet d’intimidation sur lequel repose la science qui accompagne les « chefs-d’œuvre », comme on a coutume de les nommer, et en écarte tant de lecteurs, n’a jamais joué pour Kafka. Il a toujours glissé inentamé, intouché à travers tous les commentaires. Ce qu’il écrit est à ce point particulier qu’immédiatement reconnaissable, sans référence à autre chose et du coup parfaitement universel. Chaque lecteur de Kafka est tous les lecteurs à la fois, il a la certitude – c’est cela même le contenu de l’œuvre de Kafka – que l’autre le lit comme lui. Plus on lit Kafka, plus on est tenté de le lire encore et plus on le commente, plus on est pris du besoin de le commenter ; peut-être est-ce la raison de son universalité, il ne cesse de ramener à ce qu’on éprouve en le lisant : le contenu du texte est de ne pas être autrement écrit qu’il n’est écrit, il n’y a d’approche que par lui-même.
Kafka a, en effet, trouvé à chaque fois le centre exact de la cible, tout ce qu’il écrit atteint le lecteur très exactement là où il ne peut plus rien dire. On est « concerné » par Kafka puisqu’il arrive au départ de chacun, au point muet où se fait la parole du lecteur. Ce que raconte Kafka porte à chaque fois sur ce point informulable à l’origine du langage, derrière lequel on ne peut se retourner.
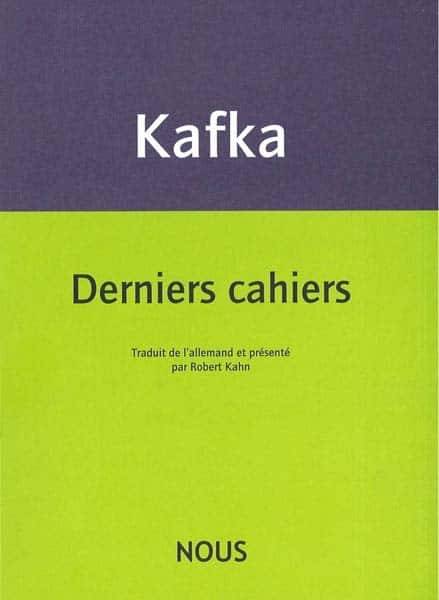
Rares sont les écrits qui atteignent ce degré de sidération où toute parole se défait et naît en même temps en un point de convergence en milieu d’être, car c’est bel et bien le point muet à partir duquel se fait toute parole. Kafka ne veut rien, ne proclame rien, ne délivre nul message et ne dit rien d’autre que ce qu’il raconte et ne raconte rien d’autre que ce qu’il raconte. Kafka ne dit rien que ce qu’il dit, sans arrière-monde aucun. Les fables plus ou moins longues, parfois inachevées, les « fragments » sont reliés entre eux par une unique démarche, ils ne parlent pas de la même chose, mais sont pareillement situés par rapport à cette démarche, selon une sorte de ligne brisée ; les directions se cassent ou s’annulent. C’est cela qui est à la fois si clair et si angoissant chez Kafka, ce qui est écrit annule à tout jamais ce qui n’a pas été écrit, tout comme Mozart annule à tout jamais Mozart. Une fois Mozart venu, il est trop tard, il n’y aura plus jamais d’avant-Mozart. Or, le découpage kafkaïen est d’une telle exactitude qu’il semble en quelque sorte mettre un terme à ce dont il est l’origine.
On ne peut formuler les fables de Kafka autrement qu’elles ne sont formulées. Si, d’habitude, bien des textes peuvent être « interprétés », ceux de Kafka se révèlent d’emblée comme échappant à l’interprétation, comme ces culbutos qui se relèvent toujours, d’où l’irrésistible besoin de commenter Kafka encore et encore qui reste inentamable, inépuisablement à la disposition du lecteur.

Ces Derniers cahiers constituent la seconde partie du volume 2 des Écrits et fragments posthumes des éditions Fischer. On retrouve partout cette continuité, cette constante présence de cette « tension-vers » qui contient par essence son inaboutissement. Ce volume réunit des récits aussi célèbres que « Le terrier », « Un artiste de la faim » ou encore « Joséphine la cantatrice », mais publiés aussi dans leur matérialité même, à partir des manuscrits conservés à la Bodleian Library d’Oxford, dans le respect absolu de leur présentation, de leur écriture, sans les titres explicites donnés par Max Brod.
Ces fragments sont parfois sans ponctuation, s’interrompent après un mot et sont longs d’une seule ligne ou de plusieurs dizaines de pages. Cette édition présente ces textes de Kafka exactement tels qu’il les a laissés à sa mort, à l’état brut si on peut dire ; on ne peut savoir quel aurait été leur état une fois achevés. La présentation par Robert Kahn tout comme sa traduction introduisent au cœur même de l’œuvre de Kafka telle qu’il la vivait.












