L’âge d’or du structuralisme semble loin derrière nous. Mais avons-nous réellement quitté cette époque ? Ne croyons-nous pas toujours que le monde est un livre, un palais de structures où de vivants piliers nous offrent une forêt d’énigmatiques symboles ? Ces trois livres illustrent la passion des structures, chez Proust, Rohmer, Deleuze. Mais faut-il vraiment aller chercher des images en s’emmêlant dans le tapis deleuzien ?
Jean-Claude Dumoncel, La mathesis de Marcel Proust. Garnier, 786 p., 49 €
Patrice Guillamaud, Le charme et la sublimation. Essai sur le désir et la renonciation dans l’œuvre d’Éric Rohmer. Cerf, 585 p., 30 €
Jean Pierre Ezquenazi, L’analyse de film avec Deleuze. CNRS Éditions, 208 p., 22 €
Le structuraliste par excellence n’est ni Jakobson, ni Lévi-Strauss, ni Barthes, ni Foucault, c’est Deleuze. Qu’on relise son article de 1967, « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? » (repris dans L’île déserte, Minuit, 2002). Mais c’est un structuraliste ambigu et atypique. Son Proust et les signes, paru un an avant les Éléments de sémiologie et le Sur Racine de Barthes (1965), a été souvent compris comme un manifeste structuraliste. Mais le structuralisme est essentiellement un nominalisme, et il appelle une sémiotique, discipline qu’on comprend souvent comme dissociée de toute ontologie et de toute référence à un monde extra-verbal. Or Deleuze ne proposait en rien une lecture nominaliste de Proust et il liait explicitement sémiotique et ontologie. Il voyait en Proust un platonicien, à la recherche d’Idées et d’Essences, et il s’intéressait tout autant à la production des signes qu’à leur interprétation. Il ne cherchait pas des structures, au sens d’images dans le tapis. Il traitait Proust comme un philosophe, et ses personnages, lieux et situations comme autant d’incarnations de concepts (bergsoniens). Il était structuraliste, mais pas, comme la plupart de ses contemporains, structuraliste de l’espace, mais structuraliste du temps. Son chiffrement de Proust, et de tant d’autres auteurs qu’il discuta, était basé sur des structures bergsoniennes. Il y a la durée, qui est qualitative, et qui est raison du temps et du mouvement, et que nous saisissons dans l’intuition. Les structures sont dynamiques, elles sont faites de forces et d’intensités.
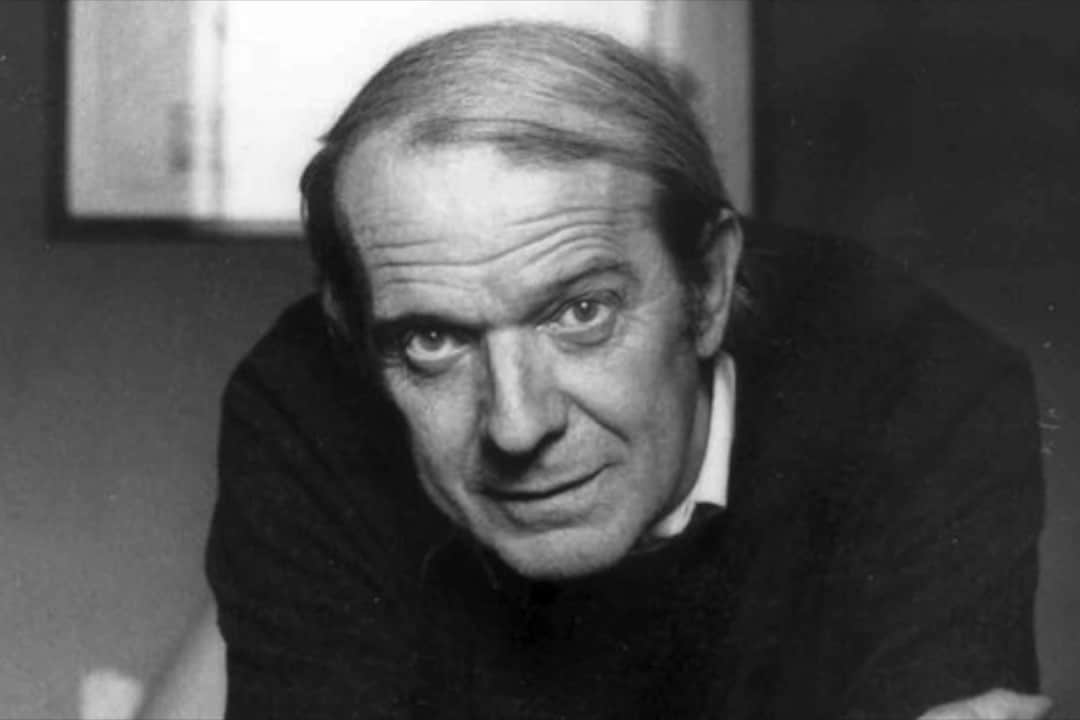
Gilles Deleuze
En bon deleuzien (il a consacré mainte étude au Maître), Jean-Claude Dumoncel part du livre de Deleuze sur Proust, et sa division des signes (signes de l’art, impressions et réminiscences, signes de l’amour, signes de la mondanité), mais il entend aller plus loin, en reconstruisant la Recherche, selon une formule de Barthes dans « Proust et les noms », comme « une mathesis générale, le mandala de toute cosmogonie littéraire ». Il vise à reconstruire cette mathesis, prenant au sérieux (c’est-à-dire au pied de la lettre) les métaphores mathématiques telles que « la plus émouvante des géométries » ou « algèbre des batailles », trouvant chez lui toute une logique modale des possibles, une logique du temps, une théorie des graphes, un traité des sections coniques enté sur le fameux cône bergsonien de Matière et mémoire, et ne cesse de plonger dans le texte de Proust des problématiques comme celle de l’identité personnelle selon Derek Parfit et, en fait, toute la philosophie de Platon à Whitehead et Deleuze. Charlus, les Guermantes, Saint-Loup, Albertine, Swann et Marcel tournent dans une grande farandole mathématico-logique aux côtés de Leibniz, Arthur Prior, Russell ou Hintikka.
Que penser de ce livre foisonnant et follement érudit ? Quand on le lit comme une sorte de répertoire raisonné et raisonnant des lieux, personnes et thèmes proustiens, réordonné selon des plans géométriques, l’exercice est fastidieux mais instructif, et il incite souvent à revisiter la Recherche, et il y a du charme et des trouvailles étonnantes dans les marottes du professeur Dumoncel. Mais si on le lit comme un ouvrage destiné à nous donner le chiffre caché de l’œuvre, il fait plutôt penser au projet de ce personnage de fou littéraire des Enfants du limon qui, pour trouver la quadrature du cercle, avait entrepris de mesurer toutes les margelles de puits, toutes les bouches d’égout, tous les cerceaux, tous les ronds de serviette, bref tous les cercles de la terre, un à un, armé de son double décimètre.

Les deux livres de Deleuze sur le cinéma (L’image-mouvement et L’image-temps) ont beaucoup stimulé les critiques de cinéma et toutes sortes de fous philosophiques. Mais, souvent, ce sont plutôt des livres de métaphysique bergsonienne et deleuzienne illustrés par des exemples filmiques que des livres qui offriraient une méthode de lecture des œuvres cinématographiques. Jean-Pierre Ezquenazi propose, quant à lui, une telle méthode. Selon son préfacier, Pierre Montebello, il ne s’agit pas de lire le cinéma à travers les concepts bergsoniens, mais bien plus de « reterritorialiser les concepts deleuziens sur le cinéma » : dramatisation, rythme, singularité, plissements, bifurcations. Cela veut dire, nous dit l’auteur, faire du cinéma un espace de tension, de forces, d’intensités. Mais à supposer qu’on comprenne ce que cela veut dire, cela nous donne-t-il une méthode de lecture ? Deleuze traite du cinéma comme composition de mouvements, idée intéressante et qu’il a brillamment mise en œuvre, mais j’avoue n’avoir jamais bien compris comment les mots-valises deleuziens comme « pensée mouvement » ou des notions comme celle de « dramatisation » ou de « plissement » pouvaient être appliqués à l’analyse de film. L’auteur donne des analyses « deleuziennes » de Kubrick (Barry Lindon) et de Cassavetes (The Killing of a Chinese Bookie) mais elles me semblent plus faire écho aux concepts bergsono-deleuziens que proposer une méthode (Ezquanazi donne en exemple l’analyse d’une séquence des Oiseaux par Raymond Bellour (Cahiers du Cinéma, 216, 1969), qui, elle, donne un vrai paradigme de méthode). Deleuze aime à citer Peirce et sa classification des signes (L’image-mouvement, p. 101). La sémiologie est une méthode de lecture, un peu trop quand on ne la couple pas à une ontologie. Mais ici la lecture est plutôt impressionniste.
Deleuze a remarqué très justement (ibid. p. 110) que Rohmer fait de la caméra « une conscience formelle éthique capable de porter l’image indirecte libre du monde moderne névrosé et d’atteindre le point commun entre cinéma et littérature ». Deleuze a tout à fait raison d’évoquer ici la notion de « style indirect libre ». La lecture que fait Patrice Guillamaud, lui aussi philosophe, de l’œuvre de Rohmer parle aussi de géométrie et d’organisation de l’espace, mais ses références sont plutôt stoïciennes et phénoménologiques (on lui saura gré de ne pas trop bergsoniser, fléau de notre temps et des autres). Il entend montrer que tous les films de Rohmer ou presque exemplifient une structure fondamentale et systématique, celle de la renonciation. Les personnages sont tous animés de désirs et de passions auxquels ils renoncent, tout en ayant conscience de leur nécessité. On a beaucoup parlé au sujet de Rohmer des thèmes du puritanisme et du libertinage, mais Guillamaud sonne plus juste en centrant les vingt-cinq films de Rohmer sur le thème du désir transfiguré et sublimé par un renoncement. Ma nuit chez Maud et Le genou de Claire sont paradigmatiques. Guillamaud livre un commentaire érudit, toujours d’une très grande finesse, à la fois sur ce thème, ses incarnations stylistiques et sa « structure processuelle ». C’est fort convaincant. Mais je me demande, là aussi, si trop de structure ne tue pas la structure. Moi aussi j’ai mon schème.

On connaît (par exemple en lisant les œuvres de Davidson et de Searle) le problème des « chaînes causales déviantes » en philosophie de l’action : un agent peut accomplir une action conforme à la raison qu’il avait d’agir, sans pour autant que cette raison soit la cause appropriée de son action. L’exemple canonique est celui d’un individu qui désire hériter de la fortune de son oncle, et décide de l’assassiner, mais qui, alors qu’il roule en auto en pensant à son futur crime, écrase accidentellement un passant, qui se trouve être son oncle. Bien des scénarios de Rohmer reposent sur le même schème. Le cas pur est celui de La boulangère de Monceau : le narrateur rencontre une jeune femme élégante, qui soudainement disparaît. Il noue une relation avec une autre jeune femme, boulangère de son état, mais, au moment où il a obtenu un rendez-vous avec elle, la première femme réapparaît, et lui apprend qu’elle a observé ses allées et venues, croyant en être la cause. Là-dessus le narrateur, ne la détrompant pas, abandonne lâchement la boulangère et s’en va avec la jeune femme élégante. Un schème voisin se reproduit dans Ma nuit chez Maud, où le narrateur, joué par Jean-Louis Trintignant, tombe amoureux d’une jeune femme blonde, mais rencontre ensuite Maud, une belle brune, et renonce à elle. Il propose plus tard à la blonde de l’épouser, mais celle-ci hésite car elle sort d’une liaison, avec un homme qui se trouvait être, le narrateur l’apprend à la fin, l’ancien mari de Maud. Le genou de Claire, où le séducteur Jérôme s’apprête à se marier, mais s’engage dans une tentative de séduction de Claire, dont il se promet de toucher le genou, y parvient par un chemin détourné et s’en va accomplir son mariage. Dans chacun des cas, le désir initial se trouve satisfait, mais par des voies obliques. Rohmer trouva dans La marquise d’O. de Kleist le parfait accomplissement de la chaîne causale déviante : alors qu’il entendait la sauver de reîtres violeurs, l’officier russe viole la jeune femme évanouie et l’engrosse (je ne sais pas si notre époque, qui est friande de dénonciations, apprécierait beaucoup ce scénario). Couverte de honte et chassée par sa famille, elle finit par céder aux avances de son violeur devenu son prétendant en tout bien tout honneur, et l’épouse. Dans chacun de ces cas, l’action initialement visée s’accomplit, mais par des voies qui échappent au contrôle des agents et malgré eux.
Cette lecture est, je l’avoue, bien simplette et naïve au regard des si subtiles et éclairantes analyses de Guillamaud, mais je me demande, avec René Pommier [1], si l’on a réellement besoin, dans les grandes œuvres littératuro-filmiques (la différence ne compte pas : comme disait Godard, tout est cinéma), qu’il s’agisse de Proust, d’Eisenstein, de Dreyer ou de Rohmer, d’aller chercher des structures cachées. Tout n’est-il pas là, bien clair pour qui veut lire ou voir ? Proust nous parle de l’amour, du temps, de la mémoire, de la société, et Rohmer n’en fait-il pas autant ? Le reste est tout aussi essentiel : c’est de la technique, de l’écriture, du montage.
-
René Pommier, Assez décodé !, Roblot, 1978 ; Roland Barthes, grotesque de notre temps, grotesque de tous les temps, Kimé, 2017.












