Tuff, de Paul Beatty, raconte l’histoire de Winston « Tuffy » Foshay, jeune délinquant de Spanish Harlem, qui se lance dans la campagne pour un siège au conseil municipal new-yorkais. Un chef-d’œuvre comique, polyphonique et dur.
Paul Beatty, Tuff. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru. Cambourakis, 352 p., 24 €
Il s’appelle Winston, comme le héros de 1984. Mais il vit dans un endroit bien réel et non pas dans une dystopie, quoique… Comme son homonyme, il a peu d’argent, d’où son patronyme (Foshay se prononce comme « fauché »). Mais si le protagoniste orwellien subvient à ses besoins quotidiens en travaillant pour l’État, Tuffy refuse de se compromettre avec le pouvoir. Tous deux seront emprisonnés et relâchés. Pour finir réconciliés avec Big Brother.
Qui est Big Brother ? Ici, il s’agit d’une célèbre association centenaire qui cherche à aider des enfants défavorisés en leur attribuant un mentor. Hélas, dans l’univers de Paul Beatty – comme chez Orwell – rien n’est comme il paraît, donc le mentor volontaire de Tuffy agit par intérêt plutôt que par altruisme : il cherche des entrées dans le ghetto afin d’écrire un article. Tuffy aussi est atypique par rapport à l’association : à vingt-deux ans, il n’est plus « enfant ».
Son mentor – un rabbin afro-américain du nom de Spencer Throckmorton – découvrira la géographie, les codes et le langage de ce microcosme qu’est East Harlem en même temps que le lecteur. Il a beau être noir, il n’a rien en commun avec son protégé, pour qui les seuls confidents sont ses amis d’enfance, ceux qu’il a connus avant l’âge de cinq ans. Tel un paysan, Tuffy a une conception bien archaïque des rapports humains, étroitement liée à la terre : un gouffre le sépare des êtres ayant grandi en dehors de son quartier, situé entre l’East River et Central Park, entre la 96e et la 125e rue.
Tuffy passe ses journées dans la rue, et prend ses décisions importantes sur le perron de l’immeuble de son meilleur ami, Fariq, où il discute avec sa bande et planifie leurs prochains coups, souvent illégaux. Comme dans le film Le Parrain, le débat idéologique tourne autour de la drogue : faut-il franchir la ligne et vendre des stupéfiants ? Fariq, musulman handicapé, y est favorable, point de vue partagé par Whitey, seul Blanc de la bande, toléré du fait qu’il a grandi dans le quartier, ce qui pourtant ne lui confère pas le droit d’employer le terme « négro ».

Depuis un incident relaté au début du texte, Tuffy a changé d’avis à ce sujet. Le lecteur l’a découvert inconscient et gisant sur le sol d’un squat à junkies de Brooklyn, où il était en mission en tant qu’homme de main pour une opération de vente de drogues qui a mal tourné. Pour le coup, Tuffy ne veut plus prendre de tels risques, d’autant plus qu’il vient de devenir père et est très amoureux de sa femme, Yolanda, qu’il a épousée par téléphone depuis la prison, après l’avoir rencontrée dans un restaurant Burger King où l’étudiante travaillait comme caissière.
Mais, en fin de compte, l’intrigue de Tuff est assez anecdotique, y compris la loufoque campagne électorale menée par Tuffy, financée par un don de quinze mille dollars de la part de son amie Inez Yomura, sexagénaire gauchiste, fille d’internés japonais de la Seconde Guerre mondiale et ex-associée de Malcolm X. Le véritable intérêt de ce roman remarquable réside plutôt dans la description poétique et détaillée d’un milieu peu présent dans la littérature américaine contemporaine, si ce n’est sous une forme sentimentale et faussement endurcie, correspondant aux préceptes des écoles d’écriture créative.
Paul Beatty, en revanche, est un poète : cela ne s’apprend pas. Sa poésie se situe aussi bien dans la musique de sa prose que dans sa puissante capacité d’observation, partagée entre son narrateur et ses lascars fictifs, dont les répliques sont drôles, caustiques et touchantes. Tuffy est un sociologue inné, comme on le voit, par exemple, lors de sa rencontre avec sa future femme dans le Burger King, « à côté de l’auberge de jeunesse, à l’angle de la 14e rue et de la sixième avenue » (situé dans cette édition, par erreur, à la 114e rue) :
« Un soda à l’orange s’il vous plaît.
– Quelle taille ?
– À peu près la vôtre. »
Yolanda rougit mais ne trembla pas. « Un gobelet moyen, dans ce cas. »
Winston se met à rire et, penché au-dessus du comptoir, se fraya un chemin dans la vie de la jeune femme. « T’es de Queens ? »
En temps normal, Yolanda aurait demandé au client de s’écarter pour la laisser prendre la commande suivante. Mais son regard allait de la tête de Winston à ses mains, elle était émerveillée par le grain soyeux de sa peau. « Ça se voit tant que ça ? demanda-t-elle.
– Les boucles d’oreilles dauphin, la frange scellée à chaud, plus d’argent que d’or à tes poignets. T’as peut-être même un petit quelque chose de Long Island. » Bien que Winston eût vu juste sur toute la ligne, Yolanda fit mine de ne pas être impressionnée et lui rétorqua un long « Et aloors ?
– T’es d’où exactement ? Hollis ? Kew Gardens ?
– Queens Village, près de la voie ferrée. C’est O.K. pour toi ? »
Ce héros autodidacte fait penser au professeur Henry Higgins de My Fair Lady, à sa capacité d’identifier le village natal d’un inconnu, à quelques kilomètres près, en fonction d’un accent. Les origines sont fondamentales pour cet observateur de l’esprit humain, les rues d’East Harlem son laboratoire. S’il y a une chose qu’il ne supporte pas, c’est l’inauthenticité. Il regarde avec scepticisme les autocars remplis de touristes européens qui investissent Harlem. Ainsi que les jeunes bobos new-yorkais qui passent pour acheter de la drogue et qui essaient de paraître complices en adoptant les gestes et l’argot des autochtones.
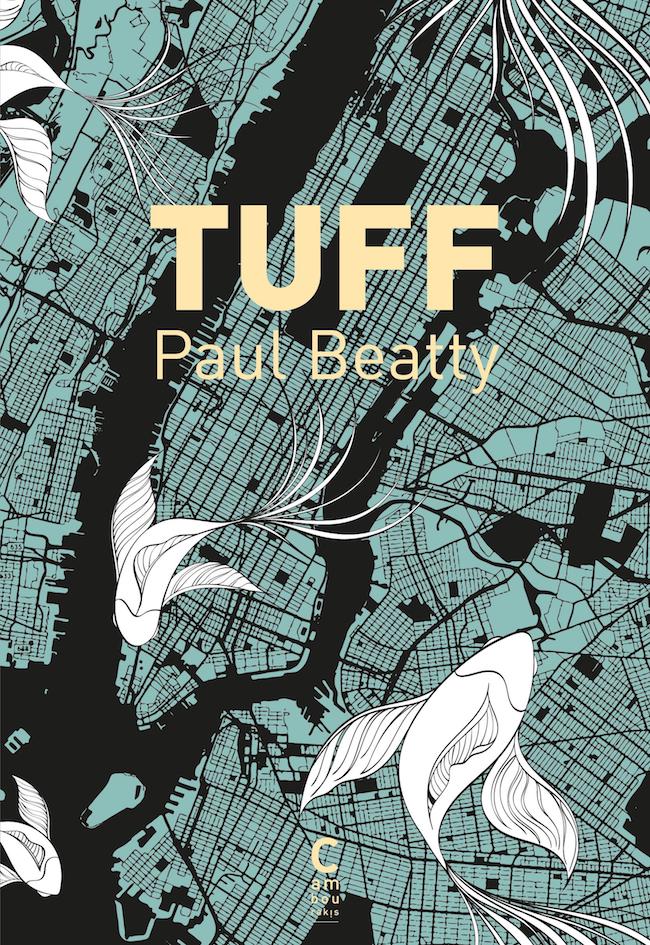
On se demande finalement si Tuff, tout en étant très critique des inégalités sociales et économiques, ne serait pas un roman communautariste (ce dont se défend l’auteur, lire son entretien avec Lise Wajeman sur Mediapart). Et si la vision winstonnienne – Winston Churchill ? –, ancrée dans un joyeux désespoir, ne se résume pas à la célébration de la glorieuse identité des habitants d’East Harlem. La question raciale pourrait ainsi s’avérer secondaire : la bande de Winston est multiethnique et multiconfessionnelle, ils se parlent entre eux dans le dialecte appelé « Black English », avec une forte infusion de mots espagnols. Dans le texte américain, la musicalité de ce dialecte, dans la transcription faite par Paul Beatty, est merveilleuse.
À ce titre, le seul discours prononcé par Tuffy pendant sa campagne électorale est révélateur. Il répond au speech de l’un de ses adversaires, German Jordan, professeur, astronaute et conseiller municipal sortant. Celui-ci a avoué qu’il a peur de garer sa Mercedes-Benz dans le quartier. Pour Jordan, les enjeux électoraux sont économiques et non pas ethniques : « Nous devons aujourd’hui, en tant que communauté, laisser la question raciale derrière nous et voir plus loin… »
Winston critique cette vision, qu’il prend pour une imposture élitiste : « J’écoutais pas trop, mais je l’ai entendu dire qu’il voulait qu’on laisse la question raciale derrière nous. Regardez-moi bien, continua Winston. Avec moi, vous avez que ce que vous voyez : un gros enfoiré de négro qui vient d’un environnement à petit budget. Si j’avais été dans l’espace, si j’avais écris des bouquins, si j’avais de la thune, et si je conduisais une Mercedes, moi aussi je laisserais la question raciale derrière moi. Je la laisserais loin derrière. Je me tirerais à dix mille de ce quartier de merde. Je vous laisserais tous vous démerder tout seuls. Ce négro, là, il vous dit qu’il flippe de garer sa Merco en bas de chez vous. Il veut que la rue soit assez sûre pour qu’il puisse y garer sa caisse. Comme s’il était le seul négro de la terre à avoir une belle caisse. Y’a plein de négros par ici qu’ont des Mercedes-Benz. »
Tuffy rappelle à ses auditeurs tout le soutien amical qu’il a porté à ses voisins depuis son enfance, avant de clore son plaidoyer : « Si vous voulez soutenir la jeunesse, votez pour moi mardi prochain. Et souvenez-vous : “Mi barrio, su barrio, nuestro barrio.” »
En adoptant l’espagnol à la fin de son speech, et en désignant Spanish Harlem par son appellation locale – El Barrio, « le quartier » –, Tuffy semble cautionner l’idéologie américaine par excellence : le communautarisme. Les habitants du quartier seraient-ils mieux protégés si chacun avait son Big Brother ?












