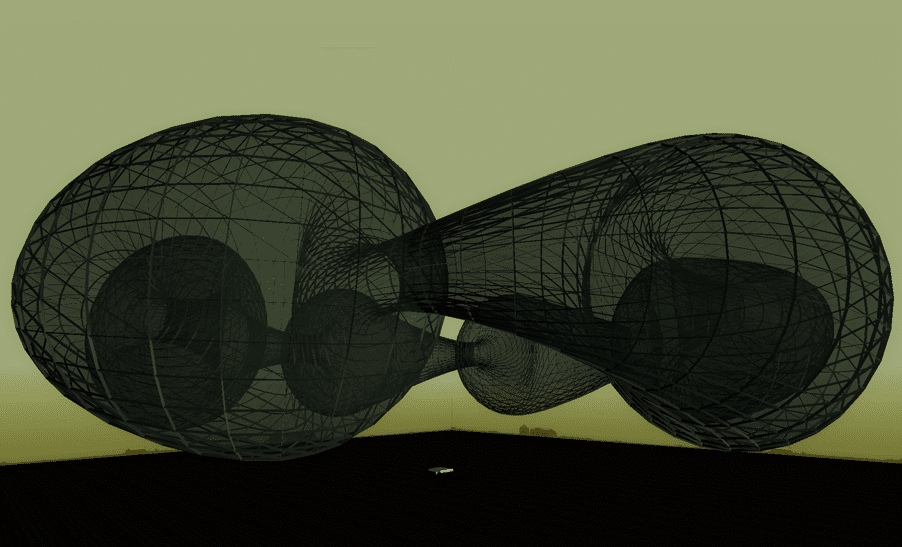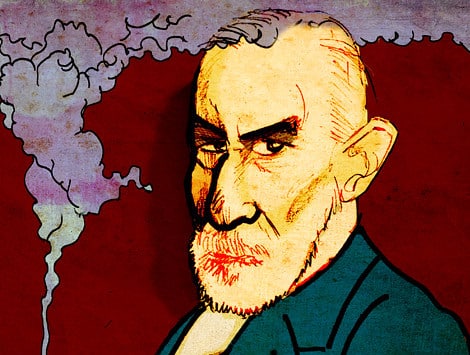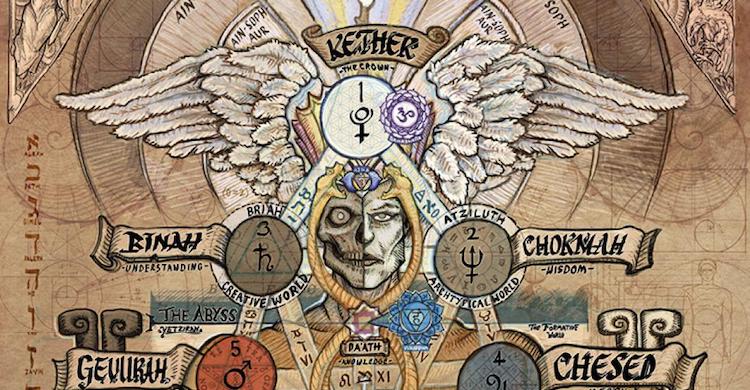Rosa Parks, bien après l’affaire du bus de Cleveland Avenue à Montgomery (Alabama), déclarait à ce sujet que beaucoup de gens se trompaient en affirmant que c’est parce qu’elle était simplement très fatiguée ce jour-là qu’elle avait refusé de céder (give up) sa place à un Blanc, alors que sa seule et unique fatigue c’était celle d’avoir à se soumettre (give in). Pourtant, elle n’avait pas attendu 1955 pour, au sein du NAACP, s’opposer au suprématisme des Blancs. À commencer par le droit de cuissage qu’ils s’arrogeaient sur n’importe quelle femme noire contrainte par eux à des rapports sexuels non consentis. Et c’est dès 1944 qu’elle s’illustra en défendant une mère de famille noire, Recy Taylor, raptée puis violée par six Blancs jamais condamnés sous le prétexte fallacieux qu’elle était consentante. C’est à cette problématique globale de la contrainte et du consentement que, sous d’autres angles, Patrick Faugeras s’est attaqué avec un groupe d’auteurs de disciplines très diverses.
Patrick Faugeras (dir.), L’intime désaccord. Entre contrainte et consentement. Érès, 311 p., 25 €
Dans l’avant-propos de l’ouvrage dirigé par Patrick Faugeras, Michel Plon cite dès la première ligne un passage de Céline tiré de Voyage au bout de la nuit – non sans avoir rappelé l’ignominie du personnage – évoquant la résignation, « cette qualité de base qui rend les pauvres gens de l’armée ou d’ailleurs aussi faciles à tuer qu’à faire vivre ».
Le philosophe Frédéric Gros introduit son propos, « L’obéissance et l’oubli du politique », en citant le court extrait d’un discours de l’historien américain Howard Zinn, dont on sait qu’il fut l’auteur d’une magnifique Histoire populaire des États-Unis, un actif militant des droits civils et un solide soutien du VVAW (Vietnam Veterans Against the War) : « Notre problème, ce n’est pas la désobéissance civile. Le problème, c’est l’obéissance civile […]. Notre problème, c’est que les gens sont soumis, partout dans le monde, face à la pauvreté, à la famine, à la bêtise, à la guerre et à la cruauté. Notre problème, c’est que les gens obéissent et que les prisons sont pleines de petits délinquants, tandis que les grands truands gèrent le pays ». Prononcés dans les années 1970, repris en 2012 par l’acteur Matt Damon, quelle étrange résonance ont aujourd’hui ces mots dans le trumpisme ambiant ! C’est à partir de cette affirmation de Zinn que Gros nous invite à sortir du dualisme philosophique classique au sujet de l’obéissance et nous démontre habilement « comment la diversification des formes de l’obéissance permet une intelligence accrue du politique ».
Parmi les auteurs convoqués par Patrick Faugeras, ils sont sept à aborder le sujet par le biais des exterminations de masse des « gens superflus » par le régime nazi. Françoise Davoine, dans « La banalisation du mal », lie son travail concret de psychanalyste sur le trauma et la psychose aux analyses d’Hannah Arendt développées dans Eichmann à Jérusalem et nous montre que la métaphore peut transformer la mémoire traumatique en mémoire politique. Le psychanalyste italien Giovanni Sias (« Propos sur la stérilité de l’époque contemporaine »), en s’appuyant lui aussi sur les travaux d’Arendt, fait l’hypothèse assez effrayante que l’éradication militaire et judiciaire du fascisme « lui a permis de se dissoudre dans le monde, d’être la solution d’un pouvoir diffusé dans les veines et dans les nerfs d’une humanité devenue désormais incapable de se réaliser dans l’histoire, comme si dans l’histoire tout avait été accompli et où il pouvait, outre son accomplissement, n’exister rien d’autre que le rien ». L’historien Thomas Faugeras se penche avec finesse sur le consentement des soldats pendant l’hécatombe de 14-18 et se pose la question de savoir si les Allemands étaient tous nazis en 39-45 (« Les enjeux du consentement. Une lecture historique »). Son père, Patrick Faugeras, psychanalyste, nous rappelle avec une précision chirurgicale le galop d’essai des exterminations hitlériennes : les « vies ne valant pas la peine d’être vécues » retirées « par compassion » à des handicapés mentaux allemands par des psychiatres et des infirmières qui n’eurent pas besoin qu’on les y contraignît. Des dizaines de milliers de morts entre 1940 et 1941 dans un contexte mondial somme toute assez acquis à la nécessité de l’euthanasie des grands infirmes (« Les jours et la nuit »). C’est d’ailleurs Patrick Faugeras qui avait rendu possible en 2002 la publication aux éditions Érès du livre d’Alice Ricciardi von Platen, L’extermination des malades mentaux dans l’Allemagne nazie. Johann Chapoutot, historien lui aussi, se penche sur les racines du pangermanisme et du nazisme (« Une ‟vision du monde” : à quoi le nazisme répondait-il ? »). Dans son article, « La Shoah, crime de ‟braves gens” ? », le psychiatre et psychanalyste Guy Laval estime qu’un régime totalitaire n’impose pas sa vision du monde par sa propagande active, mais que « sa structure perturbe l’appareil psychique dans le sens de la perte de sa dynamique : il garde ses capacités de raisonnement, mais perd sa faculté de jugement ». Marilia Aisenstein, psychanalyste, toujours à propos d’Eichmann à Jérusalem, évoque brièvement la difficulté à dire non.

En marge de ces assassinats de masse, Roger Ferreri, psychanalyste, dans un très dense et très beau texte (« Des dispositifs d’appropriation de la question de la valeur ou des pratiques de la haine de l’autre »), tente, avec beaucoup de science, de précision et de prudence, de « tirer enseignement de la brusque ou tranquille bascule vers la destruction de l’autre ». Il rappelle opportunément (ce que certains analystes semblent quelquefois méconnaître !) que « la théorie issue de la pratique de la parole dans le cadre d’un certain dispositif ne jouit d’aucun privilège de nature au regard des sciences humaines » et que « l’inconscient […] n’est producteur d’aucune vérité universelle non plus que de surplomb ». Sage conclusion : « En offrant leurs bords à la réflexion commune, les sciences humaines et la psychanalyse devraient nous aider à penser le politique de nos inscriptions dans la politique sans nous laisser espérer qu’elles pourraient s’y substituer ».
D’une certaine manière, par son constat du fait que « par petites touches, sous nos yeux, se construit en fait aujourd’hui une banalisation implicite des pratiques d’avilissement, semblables à celles que l’asile a érigées en techniques disciplinaires », Ferreri, qui est aussi psychiatre, fait la transition avec les textes de deux psychiatres, Jean-Christophe Coffin et Éric Bogaert, concernant les soins qu’on appelle encore aujourd’hui « sous contrainte » ou « sans consentement ». Mais aussi avec le texte d’Angelo Lippi, professeur d’organisation des services sociaux à Sienne et à Pise, actif militant de Psychiatria Democratica, à propos de l’œuvre gravé par un malade, Nannetti Fernando, sur un mur de l’asile de Volterra ; et avec le récit de Christine Dal Bon, psychanalyste à Rome, sur l’amnésique de Collegno.
Une sociologue du travail, Danièle Linhart, traite de « La subordination au travail», et un médecin du travail de la « contrainte au travail ». Alain Badiou nous propose une belle réflexion philosophique : « Maitres et esclaves chez Hegel ». Francis Hofstein nous parle de la violence et de la psychanalyse dans un petit article, du jazz dans un autre. Pierre J. Laffitte, universitaire en sciences du langage, met en question l’évaluation normative en milieu scolaire et évoque la pédagogie institutionnelle. Et Jacques Durand, journaliste, traite, lui, de la corrida.
C’est le texte de Bertrand Ogilvie, professeur de philosophie à Paris-VIII, que j’ai gardé pour la bonne bouche. Il s’intitule « Entre Nouveau Monde et Monde Nouveau ». Ogilvie vogue, ou valse – je ne sais comment dire – d’Ovide (« Video meliora proboque, deteriora sequor ») à Spinoza (« Pourquoi combattent-ils pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur salut ? »), en passant par Deleuze (« Comment arrive-t-on à crier : encore plus d’impôts ! moins de pain ! »), Freud, Winnicott, Rancière, Agamben et quelques autres, pour finir par proposer une forme de désobéissance aux obligations normatives, qui n’est pas la classique désobéissance civile, potentiellement source d’autres normes tout aussi contraignantes, ni la désobéissance passive du Bartleby de Melville (« I would prefer not to »), mais qu’il incarne dans le costume et sous le masque de Polichinelle. Pas seulement le personnage de la commedia dell’arte, mais le Polichinelle vu et reproduit sans cesse par Giandomenico Tiepolo, entre autres dans une fresque grandeur nature, Il Mondo Nuovo, sujet deux fois repris par la suite. Il termine cette première fresque en 1791, alors que les idées révolutionnaires changent Venise qui est en train de perdre sa domination sur la Méditerranée. Bonaparte va céder la Sérénissime à l’Autriche en 1796. La fresque de 1791 représente Polichinelle à la marge gauche d’une foule, vue de dos à l’exception de quelques-uns dont Polichinelle lui-même, foule qu’on imagine médusée peut-être par une lanterne magique que le peintre ne montre pas. Polichinelle, ici comme ailleurs, s’agite, fait et ne fait pas, est là sans y être, ne désobéit pas plus qu’il n’obéit, ne quitte jamais son masque, est « apte à tout comme à rien », ouvert à tous les possibles. Il illustre pour Ogilvie – et peut-être pour Tiepolo ? – le fait que du « Nouveau Monde au Monde Nouveau, la désobéissance opère un virage, elle se vide de tout contenu pour s’absenter de la scène du pouvoir où elle est attendue au tournant. Elle se déprend. Elle inquiète, en attendant mieux ». Mais c’est pour l’auteur cette instabilité, cette fragilité, cette impuissance, qui peuvent rendre possible toute révolution attentive à ne pas se « refermer en un ordre nouveau et à céder à sa violence autoconservatrice » en maintenant ouverte « la brèche qu’elle vient d’ouvrir, ou qui vient de s’ouvrir dans le réel ».