Ce livre pense l’imaginaire occidental de l’altérité à partir de l’exemple tragique des Hottentots et des Bochimans. L’auteur noue dans cet ouvrage érudit et subtil une double thématique. Celle des délires, à la fois paranoïaques et messianiques, que les Occidentaux ont développés à propos des peuples qu’ils ont repoussés, dispersés et pillés mais sans jamais véritablement les rencontrer. Comment et pourquoi quelques groupes de pasteurs et de pêcheurs d’Afrique australe, somme toute pas très différents des autres occupants anciens de la grande péninsule, ont-ils servi de supports majeurs à ces fantasmagories ?
François-Xavier Fauvelle, À la recherche du sauvage idéal. Seuil, 222 p., 20 €
François-Xavier Fauvelle part de très beaux rêves élaborés à propos des confins du monde : le rivage des Syrtes, le désert des Tartares, ceux d’Afrique du Sud, d’où respectivement Julien Gracq, Dino Buzzati et John Maxwell Coetzee imaginent des autorités blanches, civiles ou militaires toutes tendues dans l’attente des autres, de tous les autres, ces « barbares ». Ces hommes perplexes (le capitaine Marino, le lieutenant Giovanni Drogo, le Magistrat civil) tentent de repérer à l’horizon les bigbangs ethniques qui auraient précédé les États forts mais continueraient encore à agir en venant buter, parfois violemment, au pied de leurs anciens parapets.

Jacques Perrin dans « Le désert des Tartares », réalisé par Valerio Zurlini (1977)
C’est d’abord dans la Chambre des cartes aux confins du Farghestan, sur les remparts du fort Bastiani ou aux créneaux de la forteresse du Cap que s’enracine la conviction qu’il a bien dû exister quelque part, bien loin dans le temps et dans l’espace, des populations mystérieuses, en harmonie supposée avec leur milieu naturel implacable mais dotées de coutumes, de systèmes familiaux et rituels bien huilés, de combattants farouches, peuples purs qu’il faudrait exhumer du fatras actuel du monde, par-delà les villes, les ports et les tours de guet. L’enjeu est considérable puisqu’il s’agit pour nos impatients d’infinis de se gorger tout autant de l’exotisme que de la disparition de ces bribes d’humanité toujours décelables à l’horizon. La « recherche du sauvage idéal » nous exalte en ce qu’elle nous arrache à l’ordinaire et tout autant nous fait peur, comme si nous craignions de retrouver dans cette différence radicale reconstruite la part « barbare » de nous-mêmes.
Comme l’avait souligné Lévi-Strauss, « le barbare c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie ». Fauvelle est parti, dans ce livre, du fantasme des purs barbares dont la barbarie imaginée est constitutive de la nôtre. Ce livre vibrant remonte aux sources des sentiments d’altérité, de compassion, de répulsion et de nostalgie qu’inspirent aux conquérants les peuples qu’ils ont eux-mêmes rendus « primitifs ».
Et Fauvelle de retracer la valse des étiquettes sous lesquelles ces gens furent classés. Une distinction savante avait ainsi été esquissée à partir de la fin du XVIIIe siècle par des voyageurs-naturalistes mettant en exergue des indices de seconde main en provenance des missionnaires et des colons pour théoriser la dichotomie Bushmen-Hottentots/chasseurs-éleveurs, plus anciens/moins anciens dans la chaîne de l’évolution. L’enjeu fut ensuite rien de moins, au terme d’une classification fortement appuyée aussi sur la manipulation des squelettes (beaucoup d’ossements sud-africains, atteste Fauvelle, gardés dans les réserves des musées occidentaux) que « d’affiner la séquence des chaînons intermédiaires entre l’homme et les espèces inférieures, de ‟négocier” la frontière entre l’homme et l’animal ».

Ainsi naquirent dans l’imaginaire scientifique deux entités : celle des éleveurs hottentots et celle des chasseurs-cueilleurs bushmen. Toutefois, l’histoire des sciences de l’Autre n’étant pas cumulative mais faite d’incessants revirements idéologiques, à partir des années 1920 seront mises en avant des analogies linguistiques, comme l’usage partagé de ces phonèmes particuliers que sont les fameux « clics », pour regrouper les Hottentots-Khoekhoe et les Bushmen-San en un groupe unique, celui des Khoisan. En bloc, ces gens des Marches seront distingués à la fois des Noirs bantous et des Blancs colonisateurs. « Ce nouvel ethnonyme, explique, Fauvelle, est en effet créé en 1928 (sous la forme ‟Khoï-san”) par un biométricien allemand, Leonhard Schultze, afin de regrouper dans une même catégorie descriptive deux ensembles de populations d’Afrique australe : d’une part les Khoekhoe ou ‟Hottentots” (terme colonial péjoratif), d’autre part les San ou ‟Bushmen” ». Et, de fait, les Khoisan tomberont dans l’étrange catégorie des « Coloured » appliquée à des lignées auparavant classées comme « baastard » : « les Coloured ne sont ni Blancs ni Noirs, ils sont le fruit de tous les métissages survenus entre indigènes ‟khoesan” de l’ouest du pays, esclaves ou descendants d’esclaves majoritairement originaires de Madagascar et d’Indonésie, et colons d’origine européenne […], des Hottentots, des Bushmen, des Korana, des Namaqua, étiquettes qui ne désignent plus que des miettes de sociétés, des individus déclassés ». Et « comme ils sont maintenus au plus bas de la société on dira qu’ils sont indigènes ». Fauvelle, en archéologue et historien de l’Afrique du Sud, nous fait ainsi parcourir les imbroglios de ce palimpseste politico-racial d’où a émergé progressivement mais tardivement l’idée que les Coloured, toutes ethnies confondues, constitueraient un « peuple autochtone », en regard bien sûr des Blancs mais aussi, plus curieusement, des Noirs de langue bantou.
L’histoire du retour des reliques de Sarah Baartman nourrit cette revendication d’une reconstruction toute contemporaine d’appartenances ethniques mises en avant comme originelles. Devenue « Vénus Hottentote » dans la fantasmagorie cruelle des Européens, elle est « une personne, note Fauvelle, que rien, aucune instance ni aucune individualité, n’abrite ». Nous ne savons pas exactement quelle était sa langue maternelle, son appartenance ethnique, ni quel fut son parcours dans la région du Cap avant d’arriver en Angleterre en 1810 puis d’être exhibée dans les théâtres populaires par un certain Hendrik Caesar. Il serait tentant de voir dans cet homme un Afrikaner blanc mais l’historienne Yvette Abrahams, citée par Fauvelle (p. 72), met en avant des archives qui laissent penser qu’il s’agirait plutôt d’un Free Black, « Noir libre », c’est-à-dire d’un ancien esclave affranchi. Quant à Sarah Baartman, s’interroge Fauvelle, « venait-elle d’une de ces communautés déstructurées et dispersées par l’avancée de la frontière coloniale ? […] ou bien était-elle issue d’anciens groupes de métis ? ». On ne le sait pas précisément, même si on la rattache communément à la fois aux Khoekoe (par son père) et aux San (par sa mère). Cédée à un nouvel imprésario, elle arrive en France en septembre 1814 et meurt à Paris en novembre 1815. Elle y fut autopsiée, disséquée et « bocalisée » par le naturaliste et paléontologue Georges Cuvier (1769-1832) au Muséum d’Histoire Naturelle puis fut l’objet de nombreuses publications scientifiques. On ranimera plus humainement et politiquement le souvenir de cette femme au substrat inconnu en l’inscrivant, à partir des années 1990, dans un projet identitaire qui lui assigne une place qu’elle n’avait pourtant jamais eue auparavant, dans sa propre histoire et a fortiori dans celle de l’Afrique du Sud, celle d’une victime charismatique du mépris colonial, de la misère urbaine puis du voyeurisme scientifique positiviste.
François-Xavier Fauvelle décrit les cérémonies organisées pour accueillir le retour de France du corps de celle qui est devenue un des archétypes de la femme africaine dominée, sans que l’on sache précisément à qui doivent revenir ses restes. Et, en effet, divers furent en 2002 les notables politiques issus de reconstructions ethniques différentes se réclamant de la descendance de Sarah. Hommage lui est rendu, en Europe et en Afrique du Sud, par des « chefs ou autres dignitaires traditionnels prompts à revêtir parures et symboles tribaux et à s’exprimer dans des termes reconnaissables comme indigènes ». Les Griqua, descendants d’un véritable État dit « bastaard » apparu dans les années 1810 mais qui ont obtenu à l’ONU le statut de peuple premier et furent aussi les premiers « à faire valoir leur propriété symbolique sur la dépouille de Sarah Baartman », le porte-parole à Genève du Conseil national khoesan, puis les autorités politiques et culturelles d’Afrique du Sud post-apartheid, ont commémoré ensemble Sarah sans trop savoir d’abord où édifier sa tombe. Elle fut finalement enterrée sur les bords du fleuve Gamtoos, à Hankey, son village natal supposé mais en réalité siège d’une mission chrétienne fondée en 1822 alors que Sarah est probablement née en 1789 ! Fauvelle jette ainsi le trouble sur l’identité effective de Sarah Baartman.
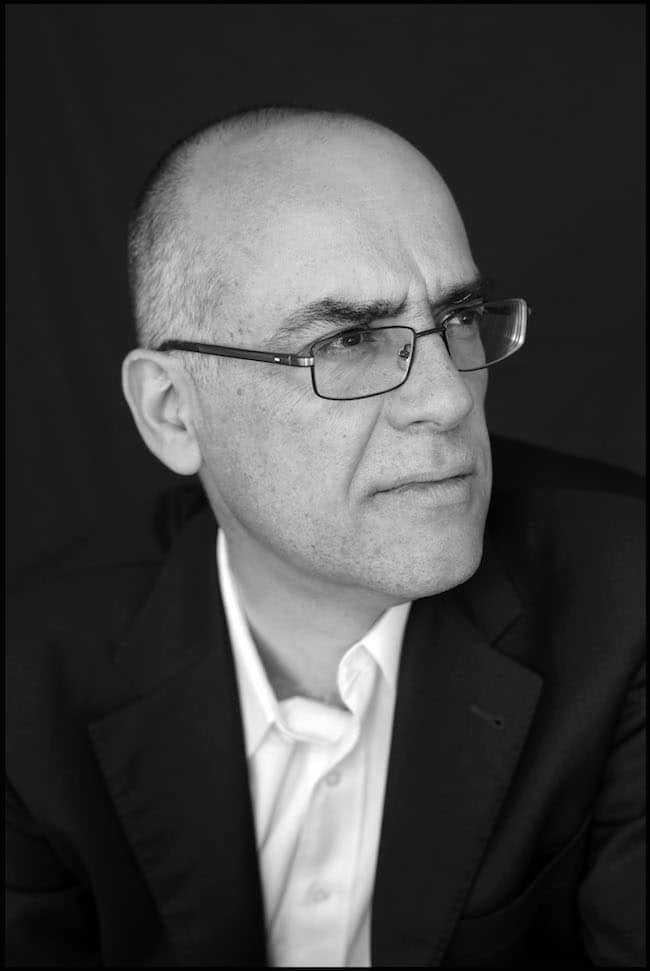
François-Xavier Fauvelle © E. Marchadour
De même, avant les gestes publics et très médiatisés qui ont entouré son retour au pays, personne ne s’était, faute de réalité ethnographique, revendiqué Khoesan. Mais c’est autour de ce nom que les groupes les plus méprisés, Hottentots, Bochimans et autres Coloured, affirment aujourd’hui légitimement « la prise de conscience d’une histoire commune, à travers tout le sous-continent austral, de disparition sociale, de marginalisation territoriale et d’élimination physique ». Les jeux de classement paléontologiques et ethnologiques, largement nourris d’utopies fantaisistes, évolutionnistes ou fonctionnalistes, se sont succédé au fil de « l’histoire du regard qui depuis des siècles n’a cessé de rétroagir sur les sociétés africaines ». Au terme de cette saga rocambolesque et tragique, Fauvelle met en évidence les conditions d’une réappropriation par les plus réprouvées et offensées des populations du Sud de l’Afrique d’une part de leur dignité emblématisée par le retour de la dépouille de Sarah Baartman sur sa terre.
Ainsi, écrit l’historien, « retrouver les Khoekhoe, ce ne peut pas être un retour en arrière comme si de rien n’était. Retrouver les Khoekhoe, c’est en passer par l’histoire des métamorphoses d’un peuple oniricide, victime à la fois de son devenir social et de ses représentations, à la fois abîmé et imaginé pour être retranché du monde, et par là même laisser cours à la définition de notre humanité ». Fauvelle nous fait franchir les écrans de fumée savants et cheminer tant bien que mal jusqu’à l’ethnie des Khoekhoe telle qu’elle aurait pu exister si un docte chercheur l’avait rencontrée à l’orée de son apparition sur nos cartes. Et l’analyse décapante de cet ouvrage de remonter jusqu’aux récits de voyages de Johann Schreyer, un Allemand de Thuringe, soldat puis médecin-chef au Cap, qui accompagne des expéditions chez les Khoekhoe de 1868 à 1876. Fauvelle s’appuie sur ses écrits et sur quelques autres de la même époque pour constituer un vrai-faux « carnet de terrain » qui sacrifie à toutes les rubriques de la monographie la plus conventionnelle : « Troupeau, Campement (organisation), Maison de nattes, Pipe, Économie (division sexuelle du travail), Vaches, Graisse (buchu), Le pur et l’impur, Contenu d’une petite sacoche d’homme, Pratiques médicinales, L’ordre du repas, Danse, Chasse, Peau de léopard, Changement d’état, Festins mémorables, Mariage, Position politique, Guerre, art martial, Les invisibles. » Il met là en série, dans son dernier chapitre, les bribes de savoir permettant de dresser un portrait convenu des Hottentots. Ses notations livrent non sans humour l’esquisse du « sauvage idéal » objectivé tel que l’ont rêvé aussi bien les gardiens de la colonie que les ethnologues eux-mêmes, lorsqu’ils se sont laissé aller à extraire leurs observations de l’histoire de leur recollection.
François-Xavier Fauvelle est donc parti des bords des déserts ou des mers d’où les Blancs guettent la venue du rêve dont ils se sont enivrés, celui de supposés barbares qu’il faudrait empêcher d’atteindre les avant-postes de la non moins hypothétique « civilisation » et repousser si possible encore plus loin. Et à l’horizon de cette attente agressive et morbide – encore d’actualité dans l’Europe contemporaine – surgit l’histoire des disparitions et errances de ceux que les dominants avaient bannis de leurs territoires comme pour mieux les réinventer au loin.
L’auteur d’emblée avait averti son lecteur. Il entendait lui donner « le sentiment de lire deux livres, l’un sur la disparition d’un peuple, l’autre sur l’enquête pour le retrouver ». Pari tenu avec cet ouvrage d’un bout à l’autre passionnant parce que questionnant.







![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)




