Le pouvoir est un roman dystopique qui pose entre autres la question des rapports entre les hommes et les femmes. Dans cette fiction à la fois contemporaine et historique, les femmes du monde entier se découvrent un pouvoir qui leur donne l’ascendant sur les hommes. Quel nouveau visage pour l’humanité dans ces conditions ? Écrit en 2016, avant le déferlement des accusations de violences faites aux femmes dans les médias et sur les réseaux sociaux, le roman de Naomi Alderman ne recule pas devant la complexité des enjeux de pouvoir.
Naomi Alderman, Le pouvoir. Trad. de l’anglais par Christine Barbaste. Calmann-Lévy, 396 p., 21,50 €
Le roman de Naomi Alderman est présenté comme le manuscrit d’un certain Neil Adam Armon, un « roman historique » envoyé à une certaine Naomi. Le livre comporte quelques illustrations, des objets présentés comme historiques, attestant de l’existence de la force électrique chez la femme, d’un culte de la puissance féminine, d’un asservissement de l’homme. La correspondance de Neil et Naomi ouvre le livre et le clôt, avec la suggestion faite à Neil de publier son livre, pour être pris au sérieux, sous un pseudonyme… féminin. Neil et Naomi vivent dans un monde dominé par les femmes, et un monde dominé par les hommes leur semble quelque chose d’irréel : Naomi peine à croire que des civilisations dirigées par les hommes aient pu exister en-dehors de quelques peuplades marginales, alors que Neil a envie d’y croire tout en les idéalisant : « Quelques-uns des pires excès commis à l’encontre des hommes ne furent jamais – du moins d’après moi – perpétrés à l’encontre des femmes avant le Cataclysme. Il y a trois ou quatre mille ans, on estimait normal de procéder, à la naissance, à l’extermination élective de neuf garçons sur dix. Et aujourd’hui encore, en certains endroits du monde, on « bride » le pénis des bébés de sexe masculin – quand on les laisse naître ! Les filles n’ont pas pu connaître un tel traitement dans les époques qui ont précédé le Cataclysme. Nous évoquions précédemment la psychologie évolutionniste. En termes d’évolution, à quoi rimerait pour des civilisations de sacrifier des fœtus féminins à large échelle, ou de mutiler leurs organes reproducteurs ! »
Le livre de Naomi Alderman est donc un miroir : on s’y reconnaît et pourtant l’image qu’on y voit est « à l’envers ». Le manuscrit retrace l’émergence du pouvoir féminin dans un monde masculin, fiction qui part d’un monde familier au lecteur pour y introduire de l’étrange. Mais du point de vue de son auteur (Neil ou Naomi, la question reste ouverte), c’est une projection de ce qui a pu exister avant l’avènement du monde tel que lui (ou elle) le connaît. Cet enchâssement de fiction dans la fiction permet à Naomi Alderman de brouiller les pistes et de faire perdre au lecteur ses certitudes.
Dans ce monde qui vacille devant la puissance nouvelle des femmes, des révoltes éclatent partout, notamment dans les pays où les femmes ont subi une domination masculine forte : en Inde, en Arabie Saoudite. Tunde, un jeune Nigérian, filme ces événements, parfois au péril de sa vie, et diffuse ses vidéos sur Internet ou les vend aux médias. Allie, une jeune Américaine en cavale parvient à créer une nouvelle religion : exit Dieu le père, Dieu est en réalité la Mère. Roxy, une jeune Anglaise, dotée d’une force électrique hors du commun, tente de mettre sa connaissance des milieux du crime au service de la cause féminine. Margot, maire d’une ville américaine, s’empare de la question du contrôle du pouvoir électrique pour sa propre carrière politique. Les yeux du monde se braquent sur un nouveau territoire, en Moldavie, où l’exploitation sexuelle des femmes a donné une vigueur particulière au mouvement indépendantiste. Tous les protagonistes s’y retrouvent et les intérêts collectifs et individuels s’entremêlent : les femmes sont rattrapées par leur histoire personnelle et Tunde, le personnage masculin principal, laisse aussi des plumes dans la bataille. Il n’y a pas de victoire, pas de triomphe.
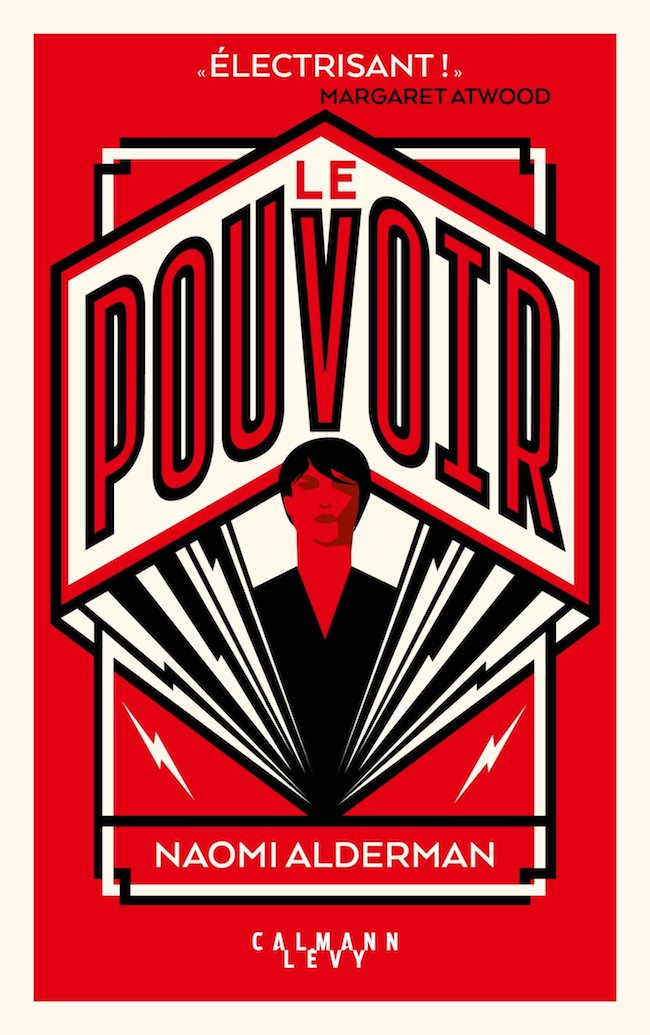
« Ce n’est ni vraiment de l’histoire, ni vraiment un roman, plutôt une « novélisation » de ce que les archéologues s’accordent à reconnaître comme étant l’hypothèse la plus plausible. J’ai inclus quelques planches illustrées relatives à des découvertes archéologiques que j’espère parlantes, mais libre au lecteur de les sauter – ce que beaucoup feront, je n’en doute pas. » Voilà ce qu’on lit à la première page, sous la plume de Neil écrivant à Naomi. Le lecteur aurait tort de « sauter » les planches illustrées (l’auteur elle-même souligne leur importance dans les remerciements) : non seulement elles reflètent la violence croissante du « roman historique », mais elles interrogent l’interprétation du passé. La chronologie des objets représentés (du plus récent au plus ancien), plus ou moins aberrante ou crédible, suggère-t-elle que l’accession au pouvoir des femmes génère une violence généralement associée aux âges très anciens, dits « barbares » ? Ou bien indique-t-elle la primauté ancestrale de la domination féminine ? Le culte de la Mère a-t-il influencé l’interprétation de l’usage ou de la symbolique des objets, ou bien les objets ont-ils été manipulés pour mieux correspondre à son idéologie ?
Elles s’accompagnent également de quelques clins d’œil : « L’analyse du socle, bien qu’il soit fortement érodé, a révélé qu’il était à l’origine gravé du motif du Fruit Mordu. On retrouve des objets frappés de ce motif un peu partout dans le monde de l’Ère du Cataclysme, dont l’usage fait débat. […] Cet artefact Fruit Mordu présente, comme souvent, un assemblage de métal et de verre. » Le lecteur aura reconnu un objet courant de notre époque et un logo aisément identifiable. Au jeu du miroir, la satire n’est jamais loin : Neil se défend de toute intention pornographique quand Naomi indique sur un ton badin que la perspective d’une société dominée par les hommes a de quoi exciter des femmes habituées à un autre rapport de domination. Le soldat, version masculine de l’Amazone, est alors un mythe et un fantasme.
À l’heure de #balancetonporc, il est intéressant de s’interroger sur la violence entre les sexes : si les femmes avaient le dessus en terme de puissance physique, n’y aurait-il pas de nombreux hommes traités comme des objets sexuels ? Plus largement, en termes de pouvoir, la religion et la politique mèneraient-elles moins à des guerres si les femmes prenaient les décisions ? Est-ce que les individus de sexe féminin seraient, au fond, moins manipulateurs, moins malhonnêtes, moins impitoyables que leurs homologues masculins ? Il est permis d’en douter. Le roman livre une galerie de personnages féminins plus enclins à donner la mort que la vie. Leur évolution suggère que le plus important n’est pas de savoir qui est victime ou bourreau, dominé ou dominant, mais plutôt que faire du pouvoir une fois qu’on l’a. Le pouvoir, comme l’électricité (rappelons que les deux se disent « power » en langue anglaise, d’où un titre original percutant), doit être manié avec précaution.
Le roman examine toutes sortes de corollaires : quel statut donner aux hommes qui développeraient ce pouvoir électrique au départ réservé aux femmes, aux femmes qui en seraient privées ? Sous quelles formes la résistance masculine se manifeste-t-elle ? Il a le mérite de mettre en lumière l’aspect collectif, indispensable à l’ère des réseaux sociaux, inséparable des révolutions, tout en jouant sur l’imaginaire lié aux collectifs féminins ; Amazones hostiles aux hommes, Ménades capables de les déchiqueter vivants, sorcières de Salem. Ce récit mené tambour battant, avec des scènes parfois très violentes, est aussi une parabole qui ne manque pas de subtilité, servie par une langue faussement simple, qui sait jouer sur différents registres, bien restituée dans la traduction.







![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)




