Il y a une vingtaine d’années que Judith Hermann s’est fait un nom en Allemagne parmi les auteurs de nouvelles. Ses œuvres ont immédiatement été traduites en français (aux éditions Albin Michel). Son style novateur lui a valu d’emblée la reconnaissance du public, et plusieurs prix littéraires. Un style original, qu’on qualifie volontiers de « minimaliste » : une écriture retenue, mais forte, qui permet au lecteur d’insérer, dans les creux du récit, sa propre expérience de la vie.
Judith Hermann, Certains souvenirs. Trad. de l’allemand par Dominique Autrand. Albin Michel, 192 p., 19 €
Après un premier roman publié en 2014 et traduit en 2016, Judith Hermann revient ici à la forme courte qui a fait son succès. Les dix-sept nouvelles qui composent ce recueil sont autant de morceaux de vie arrachés au temps, qui tout à la fois se délitent et flottent dans un espace incertain où tout reste possible. Un rien suffit, un événement si ténu qu’on pourrait ne pas y prendre garde, mais qui provoque d’un coup le retour de souvenirs passés et pèse sur l’avenir. Une révélation subite, fulgurante, qui au-delà de la souffrance permet l’écriture, car « il y a bien des choses qu’on n’est capable de dire que lorsqu’elles sont irrémédiablement passées » (« Charbon »).
Interrogée sur ces moments parfois brefs, évanescents, qui sont au cœur de ses nouvelles, Judith Hermann répond qu’elle focalise en effet son attention sur « ces tout petits instants où la complexité du quotidien se condense en une image courte, précise et poétique. Flamboie et s’éteint à nouveau » [1]. Un équilibre précaire et fugace s’instaure, comme dans la nouvelle « Avions en papier » où l’avion, lancé au moment propice, abolit brièvement la pesanteur – mais finira quand même par retomber sur le sol. Des petits riens qui n’en sont pas en disent plus sur les êtres, sur les relations qu’ils entretiennent entre eux, qu’un long développement. Chaque scène contient en filigrane tout ce qui a déjà été dit, ou pas, et tout ce qu’il est inutile d’ajouter. Mais ce présent éphémère est fort capable de réorienter toute une vie. Un instant cristallise les dimensions du temps : il existe bien un avant, parfois révélé au lecteur, mais pas toujours, et un après qui reste en suspens : « elle a soudain le sentiment qu’elle est vouée à attendre, pour tout, dans l’absolu » (« Fétiche »).
Un tel livre espère beaucoup de son lecteur, le fil narratif est si ténu qu’il faut le suivre avec délicatesse, en prenant garde au moindre mot, au moindre silence. Mais on y trouve à la fois le plaisir et la liberté de la lecture, une liberté surveillée, il est vrai, par la discrète présence de l’autrice qui nous guide habilement à travers son propre cheminement, bien servi ici par la traduction française qui le suit au plus près. Le point de vue narratif change. Tantôt c’est une narratrice extérieure à l’intrigue qui raconte à la troisième personne ce que font et disent les personnages, tantôt la narratrice elle-même est impliquée dans l’histoire. Une seule fois, le point de vue est celui d’un homme (« Lettre »), il s’agit sinon de figures féminines qui parlent, soit au présent, soit au passé, de ces événements qui peuvent sembler anodins, mais dont l’apparition ou la résurgence modifie d’un coup le cours de leur vie. Un « point limite », à peine perceptible, qui contraint un être à changer et le projette dans une autre direction, sans retour possible : « Il regarde Deborah mettre un verre d’eau dans les mains de l’enfant, et il voit, au regard qu’elle lui lance pendant que l’enfant boit, qu’ils ont atteint une limite, une croisée des chemins où il va curieusement être contraint une fois encore de prendre une décision. Bien qu’il ait dit la vérité. Même s’il a dit la vérité. Pour cette raison précisément » (« Cerveau »).
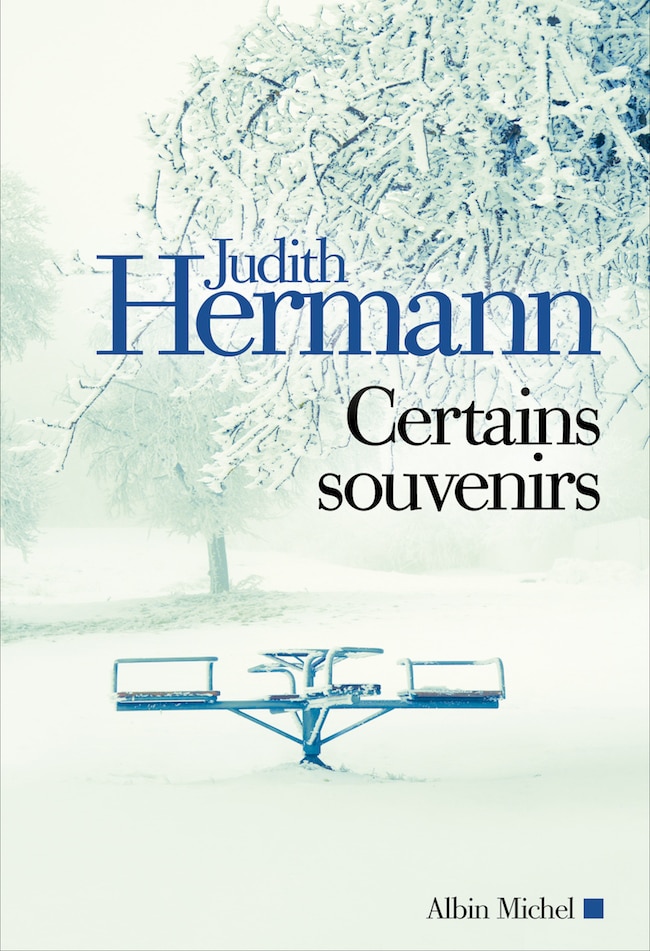
Judith Hermann ne nous dit pas tout, mais chacun de ses mots, soigneusement pesé, est à sa place dans un ensemble qui dépeint des femmes ou des hommes empêtrés avec eux-mêmes, leurs familles, leur passé. Celui-ci était-il plus heureux, ou ne découvrent-ils qu’aujourd’hui l’illusion sur laquelle ils ont vécu ? « Le champagne est glacé et il transforme l’après-midi en quelque chose qui fait mal à Ada derrière les oreilles, qui lui fait mal à des endroits de son corps où, suppose-t-elle, se cache le bonheur. » (« Solaris »)
Les femmes que Judith Hermann met en scène sont rongées, parfois à leur insu, par la question de leur vieillissement, de leur solitude. Comme Ella qui, dans « Fétiche », se retrouve assise seule, à attendre quelqu’un qui ne vient pas et qui reste désespérément loin. Il y a aussi le désir de maternité : certaines femmes ont des enfants, d’autres pas, l’une d’elles recourt à l’adoption (« Cerveau »), mais c’est l’arrivée de l’enfant qui révèle, plus qu’elle ne la provoque sans doute, la fêlure dans le couple, la « limite » évoquée plus haut. Mères ou pas, ces femmes menaient, jusqu’au moment où Judith Hermann les place sous son microscope, une vie banale, avec leurs relations, leur tissu familial où elles sont plus ou moins mal insérées. Dans plusieurs nouvelles paraissent, outre de jeunes enfants, des aînés, parents ou non, dont la vieillesse interroge et déroute. Les corps sont fatigués, l’esprit peut faiblir, mais quels souvenirs, quels secrets renferment donc ces vies finissantes, qu’en reste-t-il, jusqu’à quel point les a-t-on partagés ? Une jeune femme, au terme d’une conversation avec sa logeuse, conclut : « On dirait, pense Maude, que Greta est arrivée à entrer dans son souvenir. Dans son passé. Ou bien qu’elle se débarrasse de ses souvenirs ? Comme de feuilles, comme d’une peau. » (« Certains souvenirs »).
L’autrice soulève délicatement des questions qui préoccupent aussi bien les femmes que les hommes, une génération aux prises avec elle-même et avec le passé de la génération précédente, perplexe devant un futur qui se dérobe. On cherche la cohérence, la continuité de sa personnalité, dans le temps comme dans l’espace, dans le regard des autres comme à ses propres yeux. Tess, personnage d’« Avions en papier », formule ainsi son désarroi : « parfois j’aimerais pouvoir tout démonter, et réassembler autrement ». Jusqu’où peut aller par exemple la proximité avec un autre être ? S’il y a des instants de connivence totale (« il y a une étrange liaison entre sa tête et ma tête », dit la narratrice de « Retour »), la persistance de ce sentiment est problématique et mystérieuse. On ne reconnaît plus les photos anciennes ; une femme rêve qu’elle est devant la tombe de son amie (« Îles ») ; une autre que son amie devient si petite qu’elle peut la mettre dans sa poche (« Rêves ») : mais celle qui dans les deux cas se retrouve en fâcheuse posture n’a pas besoin de rechercher une interprétation, car « on peut très bien vivre avec ». Ce qui compte, ce n’est pas la tristesse ou le désespoir que la condition humaine peut inspirer, mais le regard qu’on porte sur les choses pour en extraire ce qui pourrait s’appeler la vérité poétique. Écrire, c’est peut-être apprendre à regarder, car même si « l’œil est aussi fragile qu’un vase Ming » (« Lettre »), la littérature permet de passer outre : « Mais en fait c’est encore mieux de fermer les yeux et de ne pas regarder dehors. Le mieux, c’est quand il suffit de savoir ce que tu pourrais voir si tu voulais le voir », dit le personnage de Ricco dans « Retour ».
Dans ces récits où chaque mot compte, on est tenté de s’attarder un instant sur les noms des lieux et des personnages, sur les auteurs des livres qui parfois traînent « incidemment » sur le coin d’une table, car ils nous disent quelque chose sur le projet de celle qui écrit… même s’il serait hasardeux d’en tirer des conclusions trop définitives. Par-delà le clin d’œil de l’autrice, faut-il y voir de menus signes plus chargés de sens qu’on ne pourrait le croire de prime abord, un contenu implicite, dissimulé ? Sam Shakuski par exemple (« Lettipark ») rappelle le jeune garçon du film de Wes Anderson et Roman Coppola, Moonrise Kingdom. Le docteur Gupta, psychanalyste de « Rêves », évoque une ancienne dynastie de l’Inde, mais ce nom est aussi porté par plusieurs célébrités, un artiste plasticien, un neurochirurgien, trois frères qui firent récemment scandale en Afrique du Sud, etc.

Judith Hermann © Ulf Andersen/Getty Images
Simple amusement de Judith Hermann ? Ou a-t-elle choisi ces noms pour suggérer la diversité d’une personnalité, mal abritée derrière le patronyme que lui attribue l’état-civil ? Et que lit, par-dessus le marché, le docteur Gupta ? Oblomov, Julia Kristeva, Truman Capote – et pour couronner le tout (et piquer notre curiosité) « un livre de Bounine ». Il se trouve que Bounine est le nom d’un grand écrivain russe (Ivan Alexeïevitch, Prix Nobel 1933), mais aussi celui d’un praticien auteur d’une « méthode osthéo-thérapique » (Nicolas). Gageons que Gupta préfère lire le premier ! On voit en tout cas ce que peut cacher un psychanalyste paresseux, blasé, mais sans doute perspicace… On découvre ailleurs, furtivement mentionné dans « Fétiche », le nom de l’écrivain libertaire et aventurier B. Traven : que fait ici son livre Le vaisseau des morts ? Au lecteur de répondre – ou pas !
L’une des nouvelles s’intitule « Solaris », d’après une pièce jouée par deux des protagonistes : hommage au roman éponyme de Stanislas Lem [2], sans doute, mais sans verser dans la science-fiction, Judith Hermann nous entraîne en effet jusqu’à une frontière de notre monde. Dans l’entretien déjà évoqué, alors que son interlocuteur s’étonne d’apprendre que « Lettipark », titre d’une autre nouvelle, est bel est bien le nom que les Berlinois donnent à l’un de leurs parcs, elle a cette réponse révélatrice : « C’est un nom qui existe en effet. Mais c’est une appellation courante et on n’est pas obligé de le savoir. En fait, ce parc peut aussi se trouver tout autre part. Je l’ai choisi avant tout pour sa belle consonance, il sonne agréablement à mon oreille et j’ai toujours pensé que ça pourrait aussi bien être un parc en Finlande, par exemple ».
On « n’est pas obligé de le savoir » : si le nom vaut d’abord pour sa musicalité, si les lieux les plus réels accèdent dans l’espace littéraire à une vérité différente qui prend définitivement le pas, il en va sans doute de même pour tous les noms dont Judith Hermann se sert dans ses nouvelles. Plus que des clefs, elle a disposé dans ses récits de simples jalons, de menus indices qui peuvent aussi nous renseigner discrètement sur ses goûts et ses curiosités, comme les dédicaces au poète irlandais Matthew Sweeney (« Témoins ») et au traducteur Helmut Frielinghaus (« Lettre »). Le lecteur qui le souhaite n’aura guère de mal non plus à identifier les poèmes dont Judith Hermann cite les premiers vers dans « Poèmes ». Mais c’est à lui qu’est laissé le soin de décider si c’est nécessaire ou pas, car c’est à lui, là encore, que revient le dernier mot. Tout ce qui est entrelacé dans le récit en fait désormais partie, sans hiérarchie.
La jeune femme qui habite chez la vieille Greta dans la nouvelle « Certains souvenirs » fait cette remarque étrange : « elle avait l’impression que la pièce, les livres et Greta avaient la même structure, comme un tissu, un treillis fait d’un matériau pour lequel il n’y avait pas de nom ». L’écriture selon Judith Hermann est justement là pour tenter de nommer cet innommable qui compose la trame de nos vies : le paradoxe consiste à se servir des mots et des silences pour traquer ce qui ne se désigne pas, de trouver un langage pour l’indicible. Chaque récit reste ouvert, les réponses aux questions, s’il y en a, se trouvent dans un au-delà du texte, dans un futur qui n’existe pas encore – ou peut-être nulle part. Mais on peut très bien vivre sans, ou trouver un arrangement qui permet de continuer son chemin. À l’instar de ce vieux père qui, interné dans un asile psychiatrique, « s’exerçait à supporter des poèmes » (« Poèmes ») : car la littérature n’est pas toujours consolante.
-
Deutschlandfunk, Kulturbeitrag, interview réalisée par Joachim Scholl, 24 mai 2016.
-
Ce roman, publié en 1961, a inspiré le réalisateur Andreï Tarkovski, mais aussi plus récemment l’Américain Steven Andrew Soderbergh, dont un personnage de la nouvelle « Croisements » porte justement le nom, à peine modifié en Steven Gonzales Soderberg. Solaris, c’est encore un opéra de Dai Fujikura créé à Paris au Théâtre des Champs-Élysées en 2015.












