Rares sont les philosophes du XXe siècle à s’inscrire sans conteste dans la longue histoire intellectuelle de l’Europe. Jürgen Habermas en fait indiscutablement partie : digne héritier de Kant, rénovateur de la notion émancipatrice d’Aufklärung avec des concepts comme « l’espace public » et « l’agir communicationnel », le philosophe, né en 1929 à Düsseldorf, ne s’est pas contenté de construire un système, ou plusieurs systèmes successifs à partir de Marx, de Hegel et des philosophes américains. Il n’a cessé d’intervenir dans la vie intellectuelle, artistique et politique de l’Allemagne fédérale. Avec passion.
Stefan Müller-Doohm, Jürgen Habermas. Une biographie. Trad. de l’allemand par Frédéric Joly. Gallimard, 652 p., 35 €
Habermas a commencé sa carrière comme journaliste dans les années cinquante. Si ses œuvres majeures sont écrites dans un style que l’on peut qualifier d’austère et de complexe, dans ses contributions dans les grands journaux comme Die Zeit ou la Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans ses lettres ouvertes, c’est sans ambiguïté qu’il prend position. Cet intellectuel sans charisme particulier, cet universitaire infatigable est aussi un polémiste. Il aime la castagne. C’est le mérite de cette biographie que de nous le rappeler en abondance.
Pourtant – cela peut surprendre – l’un des premiers intérêts pour un lecteur français de cette biographie substantielle, très approfondie – saluons d’emblée le travail considérable du traducteur – est de nous plonger dans les dédales de l’institution universitaire allemande, avec ces doctorants qui vont de ville en ville, selon le prestige des professeurs, avec ces Privatdozente non rémunérés, sans beaucoup de perspectives d’emploi, avec ces assistants sans chaire condamnés à rester dans l’ombre ou à trahir, avec cette tradition solennelle de la « leçon inaugurale ». Machine à promouvoir l’excellence, assurément, mais système impitoyable, qui a brisé – disons-le en caricaturant – des intellectuels marginaux comme Nietzsche ou Benjamin.
Pour Habermas lui-même, assez conscient de ses talents, de sa force de travail, de son engagement, la route a été longue et parsemée d’obstacles, depuis le doctorat de 1954 sur Schelling, à Bonn, sous la direction d’un certain Erich Rothacker, un mandarin à l’ancienne compromis avec le régime nazi, jusqu’à la première chaire à Francfort en passant par différentes bourses de recherche, l’Institut de recherche sociale, une habilitation à Marbourg et quelques années heureuses à Heidelberg. Enfin vient Francfort avec la leçon inaugurale de juin 1965, intitulée « Connaissance et intérêt », qui introduit la notion d’ « espace public », d’Öffentlichkeit. Le livre majeur Connaissance et intérêt, qui, à côté des sciences de la nature et des « sciences de l’esprit », distingue un troisième « intérêt » critique sous l’influence de la lecture de Freud et de Marx, sera publié en 1968. Il résume une époque.
Peu importe le détail des manœuvres universitaires fastidieuses, et pourtant décisives, de ce philosophe sociologue qui s’intéresse à Marx, auteur scandaleux ou négligé dans l’Allemagne fédérale. La présentation très fouillée de Stefan Müller-Doohm met en évidence un trait bien connu du caractère très décentralisé, voire multipolaire, de l’univers académique et de la vie culturelle en Allemagne. La description précise des enjeux, des stratégies, des demi-victoires et des fausses défaites du philosophe, en quoi peut-elle nous intéresser, nous Français ? Parce qu’elle explique le prestige considérable du titre de Professor et permet de mieux comprendre l’aura fatale d’un Heidegger dans les années vingt. Habermas lui-même a été très influencé par le Heidegger penseur de la technique et de la raison instrumentale : quand il critique violemment son silence après guerre dans un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung de 1953 (« Penser avec Heidegger contre Heidegger »), il cherche encore à sauver l’œuvre philosophique. Il assistera muet à un séminaire de Heidegger à Heidelberg, « vieux monsieur à l’allure autoritaire ». Il est vrai que le père de Habermas, un économiste, avait été lui-même un fonctionnaire nazi et un commandant de la Wehrmacht…
Ce processus académique a un coût, psychologique et social, humain. Dans certains cas, comme dans la relation avec Adorno (auquel Stefan Müller-Doohm a également consacré une biographie) une amitié semble naître : à l’Institut de recherche sociale, de 1956 à 1959, Adorno défend Habermas contre les attaques de Horkheimer et Habermas défend contre les attaques des « adultes » le sensible Adorno, qui, comme il est dit gentiment, a gardé le contact avec les expériences de l’enfance. Habermas entretient aussi d’excellentes relations avec l’épouse de celui-ci, Gretel Adorno avec laquelle il parle de Benjamin, sans pour le moment avoir compris « l’actualité » de ce dernier. Mais en regard de cela que d’amitiés troublées ou brisées – celle avec Martin Walser par exemple – par l’exigence sans concession de la norme morale. Sa famille – il s’est marié avec Ute Wesselhoeft en 1955 – en est un peu oubliée, tant il sacrifie tout au travail, aux cours, aux séminaires et, de plus en plus, aux voyages (aux États-Unis notamment) et enfin et surtout aux polémiques.
Habermas n’avait cessé de réfléchir à la démocratisation de l’université allemande, et, dès ses premiers travaux à l’Institut de recherche sociale, il avait déploré le désintérêt des étudiants pour la politique ; on aurait pu penser qu’il se serait reconnu dans les mouvements d’étudiants de 1968. Mais le dialogue tel que Habermas le conçoit, avec ses conditions de validité exigeantes, ne pouvait aller jusqu’à intégrer le chaos d’une contestation antiautoritaire. Stefan Müller-Doohm rapporte une anecdote significative.
En juin 1967, lors de violentes manifestations d’étudiants, Habermas appelle à ne pas « transformer par des provocations la violence subliminale des institutions en violence manifeste ». Rudi Dutschke, le leader du mouvement étudiant, se prononce au contraire en faveur d’actions radicales n’excluant pas la violence. Habermas s’effraie de ces propos, sans d’abord réagir : « Ce n’est que plus tard, bien après minuit, alors qu’il est déjà sorti et se trouve sur le parking (“j’étais déjà dans ma voiture ” dit-il) qu’il se ravise et retourne dans la salle des congrès pour reprendre la parole et poser des “questions à Rudi Duschke” à propos d’une idéologie appelée en 1848 “socialisme utopique“ mais qui, selon lui, dans les circonstances présentes, relève d’un “fascisme de gauche” ». « Fascisme de gauche » : la formule, on s’en doute, suscita des mouvements divers.
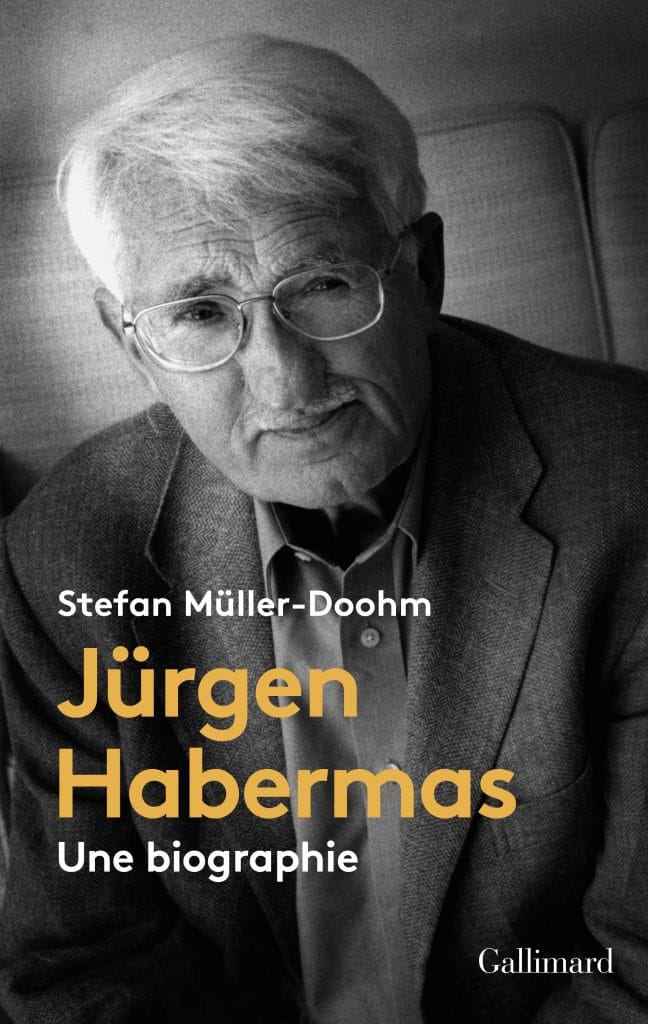
Une page se tourne donc quand meurt Adorno, à l’été 1969. Habermas publie une nécrologie émouvante dans Die Zeit, qui déplace le projet même de sa propre philosophie : la théorie critique à ambition sociologique défendue par Adorno doit devenir une théorie de la modernité avec ses potentialités et ses pathologies, ce qui passe désormais, non plus par une théorie de la connaissance, mais par une théorie du langage. C’est un véritable tournant, « linguistique » : « Son objectif ? Élucider les règles de la pratique quotidienne de la communication et mettre au jour les conditions de la critique (…), la capacité de trouver les meilleurs arguments permettant d’aboutir à une décision raisonnable ». Il s’agit d’affronter maintenant les questions mêmes de l’existence, du « monde vécu », la culpabilité, la solitude, la maladie, la mort, auxquelles la sociologie ne peut donner de réponse.
En 1971 il quitte l’université de Francfort pour devenir directeur du Max-Planck Institut de Starnberg, en Bavière, institut consacré à l’étude des conditions de vie dans le monde technico-scientifique, dans le cadre d’une réflexion nouvelle sur les conditions d’existence du « Spätkapitalismus », du capitalisme « avancé » (Raison et légitimité, 1973). Habermas porte alors sur Walter Benjamin et son sauvetage de l’enfance et de la tradition un regard neuf. Il poursuit l’œuvre de la « théorie critique » par de nouvelles voies : libérer l’être humain de formes modernes de la réification.
En 1981, lassé des querelles personnelles, il démissionne de la direction de l’Institut et publie Théorie de l’agir communicationnel, livre « monstre » de 1000 pages qui cherche dans la communication par le langage un objectif d’« intercompréhension réciproque », d’argumentation sans contrainte. Habermas est nommé à la même époque professeur de philosophie titulaire à la Wolfgang-Goethe-Universität de Francfort et donne une leçon inaugurale intitulée « Théorie de la modernité ». Il publie Le Discours philosophique de la modernité en 1985 dans lequel il se confronte aux penseurs français (Foucault, Derrida), en même temps qu’il initie le public allemand aux penseurs américains à la suite de John Dewey, Richard Rorty, John R. Searle, etc.
Il devient difficile, à partir de ces années-là, et jusqu’à aujourd’hui, de suivre le philosophe dans la rhapsodie des hommages qu’il reçoit : membre de différentes académies, docteur honoris causa de multiples universités (de Paris 8 à l’Université hébraïque de Jérusalem), visiting professor, prix Leibniz, lectures à Berkeley, à Baltimore, à New York, à Evanston, voyages en Chine, en Corée, au Japon, conférences dans des amphithéâtres pleins, prix des Libraires, du Land de Hesse, prix Érasme, médailles diverses, avec, chaque fois, un discours, une laudatio (un éloge public), etc. La liste est interminable mais ne saurait dissimuler le fait que la personnalité de Habermas, « grand donneur de leçons », « fils hypermoral d’un père nazi », suscite aussi dans son propre pays des réactions d’hostilité, de haine et de hargne. Il représente une figure d’intellectuel engagé bien différente de celle que nous avons pu connaître avec Sartre et Camus, d’une certaine manière plus radicale, car Habermas ne cherche pas les médias (il fuit la télévision) et intervient par l’argumentation écrite dans « l’espace public » abstrait des journaux. Il est lui-même, comme il qualifie Ronald Dworkin, « philosophe, polémiste et citoyen ». Mais cela n’exclut pas la virulence du propos.
« Querelle du positivisme » en 1961, « querelle des historiens » en 1986, manifestations contre le réarmement et l’arme nucléaire dans les années cinquante, le terrorisme en 1971, discussions autour de l’éducation morale, doutes sur la réunification de 1989 et le transfert de la capitale à Berlin, défense du mémorial juif, incertitudes au sujet de la bioéthique et de la génétique, débat avec la coalition rouge-verte du SPD et des Grünen, la défense de l’Europe et du dépassement constitutionnel de l’État-nation, pour finir avec la critique d’Angela Merkel, personnalité dépourvue, dit-il, de « dimension normative ». Tant de polémiques, de controverses, de débats, d’interventions. Lire la biographie d’Habermas – « vigie de la critique » – est aussi une manière de renouer avec soixante années mouvementées d’histoire allemande.
Une œuvre reconnue, donc, consacrée mondialement, mais qui donne le sentiment d’être toujours ouverte, en devenir, de sans cesse intégrer, dans un débat exigeant, rude, sans ménagement, les pensées autres, qu’il s’agisse du pragmatisme anglo-saxon ou du structuralisme français. À cet égard il y aurait une belle étude à consacrer à l’impossible et pourtant magnifique dialogue avec Derrida. Les divergences entre eux (au sujet de Heidegger) sont bien connues mais l’un et l’autre se trouvent à New York au moment du 11 septembre et engagent une réflexion sur « fondamentalisme et terreur ». Derrida saluera le 75e anniversaire d’Habermas, et ce dernier publiera à la mort du Français un article dans Libération du 13 octobre 2004 (« Présence de Derrida »).
Sans conclure, on pourrait dire, comme le fait Stefan Müller-Doohm, que cette œuvre de premier plan s’inspire de la belle formule méthodologique de Goethe dans Poésie et vérité : « nihil contra Deum nisi Deus ipse », « Personne contre Dieu, si ce n’est Dieu ». Entendre : « seule la raison est en mesure de guérir les plaies qu’elle a elle-même infligées ».












