Cette chronique aura quelque chose de particulier que le lecteur voudra bien accepter : il se trouve que je suis mêlé, directement ou non, aux événements relatés avec fougue par Pierre Peuchmaurd, et que Boris Gobille, dans ses analyses, me cite à plusieurs reprises. Dans toute la mesure du possible, je vais tenter de contourner les aspects « ancien combattant » de cette situation pour mieux faire comprendre aux amis d’En attendant Nadeau de quel Mai-68 il sera ici question, sachant que celui-ci risque d’être assez différent de celui que nombre d’ouvrages et de reportages vont commémorer de conserve. En effet, un grand malentendu s’est installé avec le temps, qui masque la vérité.
Pierre Peuchmaurd, Plus vivants que jamais. Journal des barricades. Préface de Joël Gayraud. Libertalia, 128 p., 8 €
Boris Gobille, Le Mai 68 des écrivains. Crise politique et avant-gardes littéraires. CNRS Éditions, 400 p., 25 €
L’Utopie est le moteur de l’Histoire ; si l’homme n’avait jamais rêvé de voler comme un oiseau, il n’aurait pas non plus inventé l’avion. Le rêve nourrit et se nourrit de l’imaginaire qui, selon André Breton, « tend à devenir réel ». Or, Mai-68 a mis en marche la forme la plus élaborée de l’utopie : l’utopie-critique. Par une sorte d’intuition révolutionnaire relevant de la spontanéité poétique, ceux qui allumèrent le feu en ce joli mois de mai retrouvèrent, comme par hasard, l’insoumis La Boétie qui déclare, dans le Discours de la servitude volontaire : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres ». Le concept d’utopie-critique doit être envisagé à deux niveaux différents : d’une part, il s’agit de se servir de l’utopie comme moyen critique de l’état présent du monde et de la société ; d’autre part, il faut pratiquer la critique de l’utopie dans le moment même où on la pense, dans le mouvement de l’esprit qui l’accompagne, afin de ne jamais se leurrer quant aux chances de réalisation qu’elle recèle. Dans les deux cas, la lucidité doit mener le jeu – la lucidité spontanée, non le calcul mesquin –, le champ du possible ne devant jamais s’ouvrir sur l’illusion, mais toujours sur la perspective. Des convictions, certes, mais jamais de certitudes. Examinons de plus près l’hypothèse.
Ceux qui ont voulu voir dans Mai-68 l’échec d’une révolution ont tout faux. Ils font l’erreur, volontaire, de confondre en un même moment les deux volets temporels de la grande insurrection populaire : mai et juin. Pourtant, les objectifs en étaient radicalement différents ; d’un côté, en mai, il s’agissait d’annuler le pouvoir en ignorant ses structures, en lui substituant une autre manière de vivre et de penser ; de l’autre, en juin, c’est l’espoir, politiquement vain, de prendre le pouvoir qui dominait, appuyé sur de vieux schémas épuisés, où la notion de « parti » l’emportait encore du fait d’un aveuglement militant que la noria des « groupuscules » trotsko-maoïstes agitait mécaniquement, de manière pavlovienne. Toutefois, si le gigantesque mouvement d’émancipation amorcé par les étudiants en sociologie de Nanterre et la verve utopique qui l’accompagnait perdent de leur virulence fin mai, il faut néanmoins prendre en compte le fait que des millions d’ouvriers et de salariés divers poursuivront encore la grève générale durant les premières semaines de juin ; et là, ce ne sont pas les manipulations des partis et des syndicats qui sont à la manœuvre, mais bel et bien ce quelque chose de l’esprit barricadier du peuple qui demeure vif et actif.
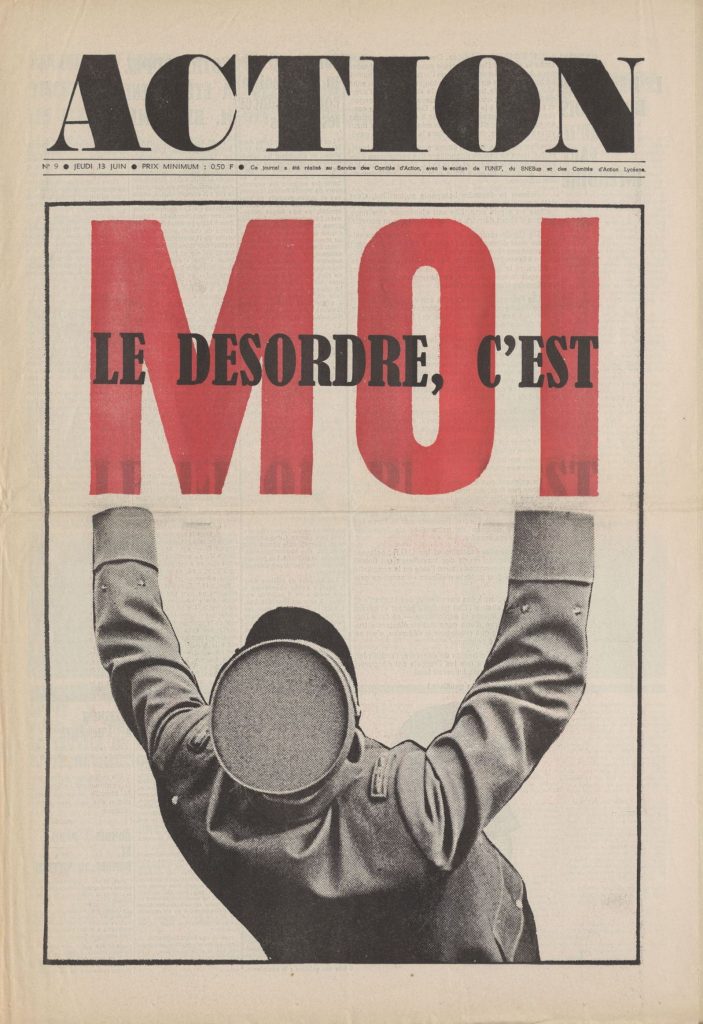
On signale que, dès l’automne 1968, on comptait déjà 124 livres répertoriés à propos de Mai-68 ! Ici, j’ai choisi de mettre en lumière le seul de ces livres, paru dès novembre 1968, totalement voué aux « événements », au jour le jour, à la nuit la nuit, qui permet de suivre sur le terrain, comme si vous y étiez, les émotions lucides qui menèrent aux barricades. Il s’agit du livre de Pierre Peuchmaurd que l’on vient de rééditer, Plus vivants que jamais, sachant qu’une préface de Joël Gayraud vient à point nommé mettre l’accent sur son auteur, l’un des meilleurs poètes des dernières décennies, aujourd’hui disparu. Et quand je dis « comme si vous y étiez », c’est à moi que je pense d’abord, car les moments, les lieux, les actions décrits par Peuchmaurd sont très exactement les mêmes que ceux que j’ai alors vécus, et il est plus que probable que certains pavés sont passés des mains de l’auteur aux miennes, dans le feu de l’espoir, alors que je ne connaissais pas encore le poète qui deviendrait plus tard l’un de mes très chers amis !
« Alors quand cela a-t-il commencé ? Il y a la rue et il y a ceux qui descendent dans la rue. La rue, il y avait longtemps que nous la regardions d’un drôle d’œil, avec comme l’idée d’y ‟machiner les pavés” ». Peuchmaurd a vingt ans cette année-là, et si, absent de Paris, il « rate » les premières manifestations des 1, 2, 3, 4 et 5 mai – la faculté de Nanterre fermée par le doyen Grappin, la police pénétrant dans la cour de la Sorbonne pour embarquer 527 personnes, la décision de fermer aussi la Sorbonne, les premières barricades qui s’élèvent au Quartier latin, Georges Marchais qui, dans L’Humanité, déclare : « Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car, objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes », Cohn-Bendit, l’un des leaders du Mouvement du 22 mars, interrogé vingt heures durant par la police judiciaire –, en revanche il est bien là le 6 au soir, quand la ville commence à vraiment s’embraser, et que l’odeur des lacrymogènes, « cette odeur de pomme qui aurait trahi », lui saute au nez du côté du carrefour Sèvres-Raspail. C’est parti…
Flash-back : avant de suivre plus en détail le déroulement des nuits de mai, rappelons que le Mouvement du 22 mars est né de l’occupation, à cette date, d’un amphithéâtre de Nanterre, par des militants anarchistes, des membres des comités Vietnam, de ceux qu’on appelait déjà les « enragés », largement sous influence situationniste, et des libertaires du département de sociologie où Daniel Cohn-Bendit jouait un rôle capital d’animateur au sourire malicieux. Au fur et à mesure qu’il se consolidera, ce mouvement revendiquera le fait de n’être ni une organisation de masse, ni une avant-garde révolutionnaire, estimant qu’il n’y avait pas de « modèle » en la matière ; pour ses membres, il s’agissait d’opérer une coupure radicale avec les schémas de type bolchevique selon lesquels il fallait intégrer le camp « socialiste », autrement dit le camp stalinien, afin d’arracher le plus de pays possible au camp « capitaliste », soit par le révisionnisme (pour le très sage Parti communiste français), soit par la violence (pour les groupuscules trotskystes ou maoïstes). Cette façon de poser le problème était originale, rafraîchissante et lucide, et pouvait déboucher sur un anti-impérialisme conséquent. On verra que le Parti, et sa courroie de transmission syndicale, la CGT, feront tout pour saborder l’énorme contestation qui s’annonce, dont la jeunesse étudiante et ouvrière sera le fer de lance !

Le 7 mai, alors qu’une partie de la manifestation du jour passe par la rive droite – c’est le mot ! –, Peuchmaurd écrit : « Si pressés d’en finir avec les beaux quartiers qu’on en oublie l’ambassade américaine. Même chose pour l’Élysée, l’Assemblée nationale. On a déjà perdu trop de temps avec l’Arc de Triomphe. On ne peut pas s’arrêter à toutes les urnes funéraires de ce pays, on n’en finirait plus ». Clairement, à ce stade, le mouvement confirme déjà que c’est en « ignorant » les structures et édifices du pouvoir que l’on a le plus de chances de le voir vaciller ; cette « ignorance » relève d’ailleurs de la spontanéité, de l’intuition révolutionnaire, non d’un calcul politique obsolète. Plus tard, on s’apercevra que seuls des symboles du « vrai » pouvoir, celui qui s’exerce à l’ombre des instances politiciennes, en ce moment où se fige le gaullisme, seront délibérément mis à mal durant cette période, c’est à dire : occupation de la Sorbonne, lieu où le savoir enseigne à penser dans l’ordre et la mesure afin que rien ne change, car l’esprit critique est l’ennemi ; occupation du Théâtre de l’Odéon, lieu où une certaine culture spectaculaire se mire dans son propre miroir avec satisfaction ; incendie de la Bourse, lieu où le capitalisme financier se remplit allègrement les poches, au mépris de l’économie réelle, vrai vecteur d’amélioration sociale.
On notera, c’est important, que les étudiants ne sont pas seuls à affronter les forces de l’ordre ; dès le 3 mai, les fiches d’interpellation des archives de la préfecture de police permettent un petit inventaire : « Parmi les personnes arrêtées, on compte beaucoup d’ouvriers, ainsi que des techniciens, des coursiers, des plongeurs de restaurant, des serveurs de café, des soldats du contingent… », signale Ludivine Bantigny dans L’Obs du 4 janvier dernier. La volonté d’interrompre la reproduction de l’ordre social est largement partagée, et le pouvoir se sait en danger, d’autant qu’il ne va pas tarder à perdre pied.
Le 9 mai, la journée est lourde ; la veille, l’ordre de dispersion de la manif a été donné par un membre de la FER, sous-produit de l’OCI, autrement dit l’organisation trotskyste du sieur Lambert, qui donnera plus tard à la France des « vedettes » comme Jospin, Cambadélis ou Mélenchon ! « Ce n’est que le début d’une longue trahison », note Peuchmaurd. Pour le même jour, il note encore : « De bon après-midi, Aragon descend dans la rue. Tout seul, comme ça. Rien dans les mains et le Comité central dans les poches. Il proteste de son innocence, de sa jeunesse. Nous, on veut bien. Et puis d’ailleurs non, on n’en veut plus ».

Relatant le même incident dans son livre Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme (Seuil, 1968), non réédité à ma connaissance, Cohn-Bendit précise : « Celui qui glorifia le Guépéou et le stalinisme venait faire une cure de jouvence parmi cette jeunesse qui, sûrement, ‟lui rappelait la sienne”. Un groupe le reconnaissant, l’accueillit aux cris de ‟Vivent le Guépéou et Staline notre père à tous !” » Ainsi, le niveau de politisation des manifestants leur permet de refuser le paternalisme des représentants officiels du PC, et si le « poète » du culte de la personnalité ne peut se faire entendre, c’est parce qu’il n’a rien de commun avec ce qui est à l’œuvre : on ne peut se déclarer « avec la jeunesse » tout en trônant au comité central, alors que le mouvement s’affirme de plus en plus comme violemment opposé au parti qui trahit régulièrement le monde ouvrier, sous prétexte de « responsabilité ». Aragon avait pourtant là l’occasion d’agir honnêtement au moins une fois dans sa vie en se désolidarisant de ses maîtres, mais c’était au-dessus de ses maigres forces ! Rideau.
S’annonce maintenant LA nuit des barricades, celle qui va bouleverser la distribution des cartes ; je ne vais pas entrer dans le détail de cette nuit dont Peuchmaurd donne une vision à la fois exaltée, lucide et sereine. Quelques passages, cependant, pour en saisir le ton : « Nous envoyons valdinguer un peu plus toute organisation, fût-elle des nôtres, au nom de la spontanéité de la base. Ce sera cela, la révolution de mai […] Denfert, 18 h 30 […] Les toits sont noirs de monde […] Le lion, son grand corps vert taché de rouge est avec nous […] Les surréalistes sont là, ça fait diablement plaisir. Pour la première fois, je pense à Breton dans tout ça. Je commence à entrevoir que ç’aurait été là SA révolution. Il est un peu amer de l’imaginer la crinière blanche fièrement portée, l’œil en projection, marchant parmi nous, avec nous, et de ne pouvoir que l’imaginer […] Le Quartier est à nous […] Et tout se fait sans qu’on sache bien comment, sans qu’on cherche à savoir. Une barricade ça sort de terre plus vite que le blé. Il suffit de semer l’espoir ».
Plus tard, dans la nuit, sont évoquées les barricades de la rue Gay-Lussac, les plus grandes, celles qui résisteront jusqu’à l’aube : « Un mur couvert de tuiles. L’aubaine. On s’y attèle. Passe une bonne femme causante, du genre malheureux-vous-ne-savez-pas-ce-que vous-faites-là ! Paraît que ce qu’on fait, c’est d’abîmer un couvent de bonnes sœurs. ‟Raison de plus”, lui dis-je pour en rester là. ‟Vous n’avez donc aucune morale ?” Si, madame, la liberté. »
Pendant ce temps, les pouvoirs publics négocient avec Geismar et Cohn-Bendit. On se regroupe autour des transistors (je dis « on » parce que j’étais là), « les nôtres et ceux que les gens nous tendent à leur fenêtre […] Et puis aussi on parle. Les gens descendent pour ‟comprendre”, disent-ils. La révolution est à l’ordre du jour, nous inventons demain […] 1 h 50. Cohn-Bendit parle à la radio. Les négociations ont été bidon à souhait. Nous ne bougerons pas du Quartier. Voilà. 2 h 15. Ils attaquent ». La nuit la plus longue va s’étirer jusqu’à 5 h 30, quand Dany appelle à la dispersion. Pluies de grenades, voitures en flammes, chasse à l’homme, soutien des riverains qui arrosent le feu, les flics et les gaz lacrymogènes depuis leurs fenêtres ; barricade après barricade, il faut lâcher du terrain, se replier sous les tirs, sans panique toutefois. « Nous ne savons pas encore que nous avons gagné », écrit Peuchmaurd. Tout son livre relève de ce que j’appelle subobjectivité, c’est-à-dire la faculté de transmettre avec la plus grande objectivité toute la subjectivité du ressenti, laquelle ne saurait évidemment être de même nature que celle du CRS en vis-à-vis.

Le lendemain, samedi 11, la grève générale est décidée à partir de lundi, les syndicats, tout fringants, venant de découvrir avec ingénuité la terreur policière. Ils ont la mémoire courte, mais bon. Je crois bien, d’ailleurs, que Cohn-Bendit l’avait suggéré avec insistance, à la radio du petit matin blême. De retour d’un voyage au pays des Mille et Une Nuits, Pompidou rouvre la Sorbonne. Il va être surpris. Le 13 mai, c’est près d’un million de personnes qui vont défiler, travailleurs, lycéens et étudiants réunis, en dépit des tentatives de récupération syndicales, le service d’ordre de la CGT cherchant à disperser à tour de bras, en hurlant qu’il fallait le faire « dans le calme et la dignité ». Les grandes manœuvres du Parti commencent, il y va de sa survie ; pour cela, sa connivence avec le pouvoir gaulliste va s’affirmer de jour en jour, tandis que la grève s’étend à tout le pays ; on comptera bientôt dix millions de travailleurs à l’arrêt. Quant à la Sorbonne, en ce soir du 13 mai, elle est libre « pour la première fois de son histoire », ce qui deviendra rapidement les comités d’action s’y installant comme chez eux. Leur rôle est considérable pour ce qui vient.
Mais avant d’analyser pourquoi juin sera très différent de mai, il faut encore rappeler que la nuit du 24 mai fut exceptionnellement chaude, une nouvelle forme de combat de rue surgissant, qui impliquait « le harcèlement des cordons de flics par petits groupes, cent à deux cents types. La guérilla urbaine ». C’est ce soir-là que la Bourse fut incendiée, et que Paris était à prendre. Panique à bord, mais le ver du dogmatisme était déjà à l’œuvre, glissé dans le fruit de l’utopie libertaire par les fameux « groupuscules » dont la liste laisse rêveur : pas moins de quatre organisations trotskystes se tirant dans les pattes (les lambertistes de la FER, les frankistes de la JCR, les pablistes non affiliés à la IVe Internationale, et Voix Ouvrière, bandapartiste), deux organisations maoïstes (PCMLF, UJCML) qui s’enrichiront de deux autres au fil du temps (MSLP et Mao-Spontex – les moins cons), qui revendiqueront chacune la « bonne » lecture du Petit Livre rouge ; d’autres encore, que j’oublie, bref, de quoi faire éclater le mouvement de l’intérieur, ce qui évidemment ne pouvait manquer d’en réduire la portée.
Car que veulent ces différents groupes ? J’emprunte au périodique Rouge, alors rédigé par des journalistes et militants frankistes, un programme valable pour tous ces braves gens, par des méthodes différentes, cela va de soi ! Au menu : création d’un nouveau parti d’avant-garde d’une grande homogénéité théorique, d’une grande cohésion politique et d’une grande rigueur organisationnelle, en s’appuyant sur les principes léninistes d’organisation, seuls capables de produire un parti répondant à ces critères. C’est effectivement la meilleure des recettes pour cuisiner ce plat historiquement indigeste que toutes les gargotes de la Révolution s’obstinent à inscrire en tête de leur carte sous le nom de « parti ». De plus, par la bande, cela redonnait du poil de la bête au PCF !
Tout au contraire, c’est la spontanéité du mouvement déclenché en mai par les étudiants qui a entraîné des millions de travailleurs à faire l’expérience de la grève générale avec occupation des entreprises, en dépit du PC et des syndicats qui, le moment venu, tronquèrent sournoisement la nature des revendications les plus radicales en négociant avec le patronat « une victorieuse reprise du travail » en forme de Waterloo ; et c’est ainsi que Georges Séguy, grand patron de la CGT, se fera copieusement conspuer par les ouvriers en grève de chez Renault, lorsqu’il viendra, le 27 mai au matin, tenter de défendre le « protocole d’accord » signé la veille avec le CNPF, sous la houlette de Pompidou. Voyez caisse !
La leçon utopique de Mai-68, c’est que les comités d’action, les comités de base, le double pouvoir au niveau syndical, la révocabilité permanente des responsables, la libre circulation des idées et la lutte contre toutes les formes de la hiérarchie – patronale ou bureaucratique – feront plus pour l’émancipation des travailleurs que tous les catéchismes pseudo-révolutionnaires.
Afin de clore cette partie de ma chronique consacrée au livre de Pierre Peuchmaurd, voici deux citations qui n’y figurent pas, mais qui me semblent synthétiser analogiquement l’esprit qui y règne. D’abord, Rosa Luxembourg, dans Grève générale, parti et syndicat : « Si l’élément spontané joue dans les grèves de masse en Russie un rôle si prépondérant, ce n’est point que le prolétariat russe est insuffisamment ‟éduqué”, mais que les révolutions ne se laissent pas diriger comme par un maître d’école ». Pour mémoire. Ensuite, une déclaration de Dany Cohn-Bendit, bel exemple d’utopie-critique, figurant dans le numéro 4 de la revue surréaliste L’Archibras daté du 18 juin 1968 [1] : « L’important, ce n’est pas d’élaborer une réforme de la société capitaliste ; c’est de lancer une expérience en rupture complète avec cette société, une expérience qui ne dure pas, mais qui laisse entrevoir une possibilité : on aperçoit quelque chose fugitivement, et cela s’éteint. Mais cela suffit à prouver que ce quelque chose peut exister ». La fugacité des situations insurrectionnelles relève, en effet, de l’expérience poétique, donc révolutionnaire.

Dans son livre Le Mai 68 des écrivains, Boris Gobille analyse en détail le comportement des avant-gardes littéraires qui se mobilisèrent en cette période. Cependant, dès les premières lignes, il situe bien quel était le véritable objectif de la lutte engagée : « Il ne s’agit pas toujours, et même très rarement, de penser les moyens de prendre le pouvoir d’État ; il ne s’agit pas seulement d’avancer des revendications catégorielles ou de réclamer des augmentations de salaires ; il s’agit d’interrompre un fonctionnement social fondé sur la division sociale du travail : la division verticale qui produit hiérarchies et domination, et la division horizontale qui cloisonne et sépare les mondes sociaux. Redéfinir une société en somme, hic et nunc, par la parole et dans les pratiques mêmes ».
On voit que cela recoupe lucidement mon propos, mais je mettrai un bémol sur son « très rarement » qui fait l’impasse trop belle sur le rôle dissolvant des groupuscules – on l’a vu –, comme sur les tentatives, partiellement réussies, des syndicats et du Parti communiste français, destinées à faire « rentrer dans le rang du raisonnable » la fureur émancipatrice des travailleurs, las des dogmes paralysants assénés par leurs dirigeants [2].
La première manifestation d’un collectif d’avant-garde en faveur de ce qui commence, et contre la répression qui déjà s’installe, sera celle des surréalistes, note Gobille, en citant le tract « Pas de pasteurs pour cette rage ! », édité dès le 5 mai 1968. Rédigé à plusieurs, sur la base d’une proposition d’Annie Le Brun (et non de Jean Schuster, comme l’indique l’auteur), en voici quelques extraits : « La révolte ne s’apprend pas. Elle s’organise en révolution, à partir de la spontanéité de la jeunesse […] Elle s’apprête à liquider toutes les institutions, tous les appareils d’une civilisation d’ores et déjà passée par profits et pertes […] la bourgeoisie traditionnelle, assoupie par la tranquillité que lui laisse le parti communiste, retrouve ses réflexes répressifs. Bien plus, le parti communiste et l’UEC réalisent avec les paras d’Occident, les gorilles de De Gaulle et les épiciers lecteurs de « l’Aurore », l’unité de la répression contre la jeunesse révolutionnaire ». En conséquence de quoi, le tract appelle à « la destruction simultanée des structures bourgeoises et pseudo-communistes parfaitement imbriquées ».
La refonte totale de l’Entendement humain, qui implique le passage de la certitude au doute actif, puis à la négation absolue de l’organisation sociale établie, est un mot d’ordre récurrent du mouvement surréaliste, ce qui « témoigne de la vision commune qui unit les surréalistes et le mouvement critique, en particulier les groupes libertaires et anarchistes avec lesquels ils sont d’ailleurs liés », écrit Boris Gobille, qui ajoute, en effet : « Les surréalistes ne peuvent que se reconnaître, parce qu’elle est la leur de longue date et qu’elle est constitutive de leur ethos, dans l’idée que la révolution n’est véritable que si elle est aussi révolution permanente des structures mentales, disponibilité radicale à la nouveauté de l’événement, et créativité généralisée ». On voit que les données sont clairement posées dès l’origine de la crise, ce qui ne sera pas le cas chez certaines des avant-gardes analysées dans ce livre. Voyons cela.

Séquencé en douze chapitres, le livre de Boris Gobille retrace les luttes des avant-gardes entre elles pour s’affirmer comme seules détentrices d’une « vérité » qui se voudrait révolutionnaire. On verra ainsi s’affronter la Comité d’action étudiants-écrivains (CAEE) qui se crée le 18 mai à la Sorbonne, où l’on retrouve Jean-Pierre Faye, Alain Jouffroy, Maurice Roche et Jacques Roubaud, notamment, et l’Union des écrivains (UE) qui, suite à l’occupation du siège de la Société des gens de lettres, se fonde le 21 mai ; s’y côtoieront un temps ceux du CAEE et des membres de Tel Quel, aux côtés d’anarchistes qui dénoncent les revendications corporatives de l’union ayant primauté sur les objectifs révolutionnaires ; comme Philippe Sollers et son équipe, en pleines noces avec le Parti communiste et la CGT, exigent que l’on vote une motion déclarant : « Toute révolution ne peut être que marxiste-léniniste », l’éclatement est inévitable et, au soir du 24 mai, c’est fait.
Attardons-nous un moment sur l’itinéraire « burlesque » de Sollers et des telquelistes. Avant les événements de mai, la théorie développée par ces messieurs s’appuie sur une « science de l’écriture textuelle », elle-même sous-tendue par un structuralisme de circonstance, le tout devant faire surgir la vérité révolutionnaire de l’entreprise ; pas de révolution hors le « texte » : je résume. Très vite, cependant, c’est la soumission aux exigences du Parti communiste français, et à l’action de la CGT, qui s’impose à leurs yeux, on vient de le voir. Bientôt, ce sera le maoïsme intégral qui guidera fermement leurs pas sur le chemin radieux de la révolution culturelle. Au terme de ce parcours hasardeux, dans un entretien avec Maurice Clavel, en 1977, l’ébouriffant Philippe Sollers finira par avouer son désarroi idéologique lors de cette période « héroïque » : « C’est que j’ai vu le Parti Communiste, j’ai vu la gauche, je me suis vu moi-même en train de ne rien comprendre à ce qui arrivait. Comme idéologue, je ne comprenais pas… ». J’allais le dire… Plus tard, on le verra logiquement se prosterner aux pieds du pape, mais ceci est une autre histoire !
Au fil des chapitres, Boris Gobille traitera du prophétisme sans prophète, de la rhétorique de guerre civile en temps de paix, du retour du refoulé social ou du rôle de l’ « écrivain-travailleur », voire des vertus de la parole anonyme ; ou encore de la lutte fratricide entre Tel Quel et Change pour une suprématie intellectuelle sur le concept d’avant-garde, tout cela avec beaucoup de justesse, de savoir-faire et d’informations.
À ce propos, je me dois de lui rendre hommage. Depuis très longtemps, une version de la « fin » officielle du groupe surréaliste se répand dans les milieux des commentateurs littéraires et des universitaires « spécialisés ». Or, cette version est fausse. En 2001, Maurice Nadeau a bien voulu publier un livre [3] où je donnais, appuyé par nombre de documents, un éclairage aussi précis que possible de la réalité de ce qui s’était effectivement passé, réalité où certains événements politiques avaient joué un rôle essentiel, et notamment ceux de Mai-68. Pour la première fois, à ma connaissance, Boris Gobille traite objectivement de cette question dans un chapitre entier consacré aux « fils perdus d’André Breton », et cela en s’appuyant sur de larges extraits de mon livre, comme sur mon interprétation des faits. Merci. Il note enfin que « le langage profond de mai » pourrait bien être celui du surréalisme, raison pour laquelle Philippe Sollers tenait absolument à « liquider » celui-ci par tous les moyens de la mauvaise foi rhétorique, son arme favorite [4]. Bouffon !
-
Ce numéro sera poursuivi pour offense au président de la République, pour apologie du crime et pour diffamation envers la police. Seule l’amnistie générale qui suivra les événements permettra d’éviter le procès.
-
Cf. La révolution trahie de 1968, d’André Barjonet, secrétaire du Centre d’études économiques et sociales de la CGT, démissionnaire, éditions John Didier, juin 1968.
-
Alain Joubert, Le mouvement des surréalistes ou le fin mot de l’histoire, Maurice Nadeau, 2001.
-
Pas moins de deux numéros de Tel Quel furent alors entièrement consacrés à une entreprise de démolition du surréalisme, qui tentèrent, en vain, de le disqualifier comme « idéalisme » ; les gros sabots, quoi !




![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)







