Est-ce un signe des temps ? Ce n’est plus académicien que l’écrivain ou l’intellectuel aspire de nos jours à devenir, mais professeur au Collège de France. C’est plus chic que l’habit vert. Adrien Delcourt, le héros gidien de L’interruption, est un chercheur en philosophie à l’EHESS, proche de la soixantaine, mais, de son propre aveu, « d’une increvable jeunesse ». Il se laisse convaincre de postuler à une chaire de morale du Collège de France, pour succéder au sociologue Jean Lewinsky. Ce n’est pas gâcher l’intrigue que d’indiquer que cette démarche mal engagée n’aura pas l’issue escomptée.
Dominique Noguez, L’interruption. Flammarion, 232 p., 18 €
Elias Canetti, Le livre contre la mort. Trad. de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 489 p., 25 €
Paul Claudel, dans les années 1930, avait donné le récit vachard de ses visites académiques, l’Académie lui ayant finalement préféré en 1935 l’officier de marine Claude Farrère. Dominique Noguez, pour sa part, prend un plaisir que l’on devine malin à décrire le microcosme parisien dans lequel va s’insérer la candidature de l’auteur d’un Traité des faiblesses.
Autour de lui s’agite tout un petit monde : un ami normalien qui travaille dans l’édition, fin gourmet, et mauvaise langue, capable d’éreintements critiques dévastateurs ; une jeune maîtresse, Aurélie, une élève avec laquelle il entretient une relation sexuelle ambiguë, plus ou moins tarifée (par jeu ?), et éphémère ; un couple d’amis universitaires, « spiritualistes », catholiques. Plus d’autres personnages, figurants plus ou moins grotesques du monde de l’édition, dont les manœuvres brutales au sein de la maison « Villemain » seront fatales aux publications d’Adrien.
Il a été marié, avec une certaine Véronique, emportée par un cancer, qui fut – et quelle douceur dans l’évocation mélancolique d’une époque révolue – « la plus belle fille du cours d’Yvon Belaval sur Leibniz à la Sorbonne ». Mais c’est une brève mais intense relation homosexuelle avec un Sébastien qui demeure comme une révélation cachée, relation inaugurée ironiquement une nuit, dans l’ombre d’un arbre exotique proche du Collège.

Dominique Noguez © Astrid di Crollalanza
Quelques événements, si c’est le mot qui convient, un pot de thèse au Café de Cluny, un déjeuner aux Fins Gourmets, des rencontres avec des universitaires étrangers, vont ponctuer ce parcours décevant. Avec une certaine audace – mais qu’a-t-il à redouter ? –, Dominique Noguez décrit les visites du candidat sans même prendre le soin de recourir à des pseudonymes (y compris pour Armand de Ricqlès…) : d’où des portraits discrètement ironiques, sans méchanceté, tendres presque, de certains professeurs du Collège : l’historien de la Chine Pierre-Étienne Will, le physicien Serge Haroche, le poète anglais Michael Edwards, le linguiste Claude Hagège, le médiéviste Michel Zink… En tout, quarante visites. Tous courtois, attentifs, souvent, mais prudemment en arrière de la main.
Mais, quand il s’agit des philosophes « contemporains », Adrien/Noguez a la dent dure : Baudrillard ? Un « escroc ». Derrida ? Un « grand rhétoricien » (rhétoriqueur ?) qui n’aurait rien pensé d’important. Onfray ? Un « gourou pour les nains de l’audiovisuel ». Badiou ? Formaliste. Et ainsi de suite. Échappent à l’exécution Vladimir Jankélévitch, à l’éternelle jeunesse, Lacoue-Labarthe, qui écrivit jadis à Adrien une lettre magnifique sur la « camaraderie agitée » de la khâgne et l’apprentissage de la philosophie, quelques autres encore, dont Roland Barthes, vigoureusement défendu.
« Il avait tout raté. » L’échec de la candidature est un rude coup, Adrien s’était pris au jeu, et cette péripétie l’oblige à faire retour sur lui-même, à déménager, à trier dans ses papiers, sa correspondance, ses souvenirs, ses désirs. Appelons cela un auto da fé. Comme – par une facilité de romancier que se donne Dominique Noguez – il vient d’hériter d’une petite maison au fin fond de la Creuse (on se croirait chez Pierre Michon), il va y chercher refuge, y faire le deuil de ses ambitions et de son désir de vivre. Il comprend qu’il doit cesser d’espérer être toujours « dans la grâce des autres », qu’il doit en finir avec les ego. Pris d’un « engourdissement apaisant », il s’apprête à « rendre son tablier », à « tout plaquer », à arrêter la comédie : c’est « l’interruption » du titre. Si l’humour est la politesse du désespoir, Dominique Noguez est d’une exquise courtoisie. Il fait sourire avec le récit malicieux et informé de ce ratage, grâce à son « goût irrépressible de l’humour noir ». À sa manière, cette sobre chronique d’une candidature de 2003 est beaucoup plus datée, elle évoque, au plus près des souvenirs, les années 1960 et 1970. Elle suscite la curiosité, mêle potins et « aphorismes sombres », alimente la nostalgie.
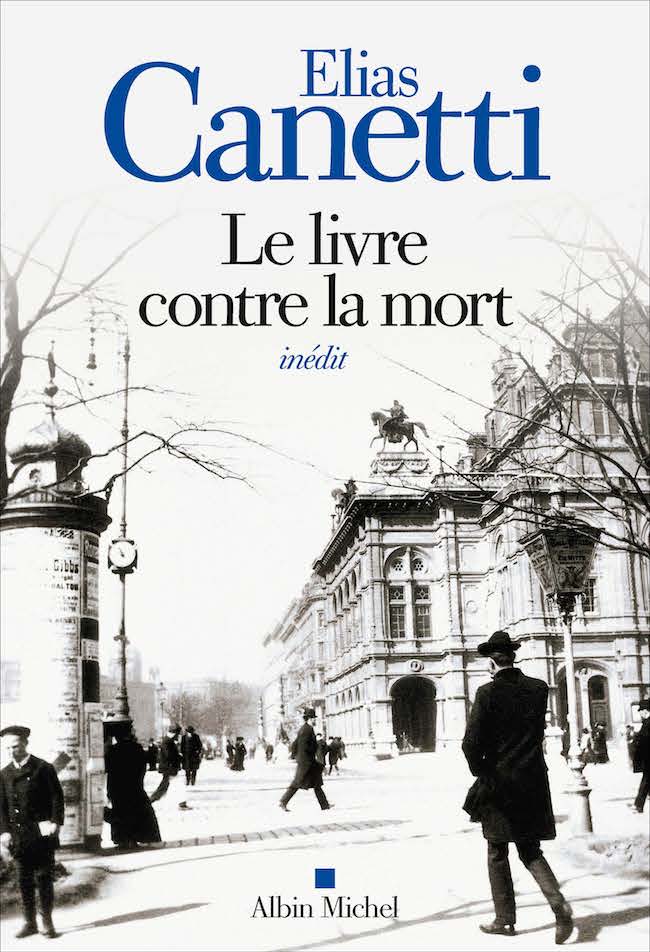
Il y a mieux que le Collège de France : le prix Nobel, qu’Elias Canetti a reçu en 1981 et qui nous revient ici avec (lui aussi) des « aphorismes sombres ». Autant Dominique Noguez est léger, ironique et parisien, autant Elias Canetti est un penseur grave, savant et d’une indéfinissable identité européenne. Né en Bulgarie en 1905, dans une famille juive séfarade – donc sujet de l’Empire ottoman –, éduqué à Vienne, réfugié à Londres, il acquiert la citoyenneté britannique en 1952 et meurt à Zurich, en 1994. Il est enterré non loin de Joyce, comme il le souhaitait.
La mort : c’est l’objet unique, obsessionnel, de cet ensemble de notes et d’observations, de citations anthropologiques et d’anecdotes cruelles, destiné à faire pendant à l’inoubliable Masse et puissance, mais qu’Elias Canetti n’est pas parvenu à composer. Qui peut s’en étonner ? Il ne s’agit nullement ici d’une méditation propédeutique à la manière de Montaigne ou d’une consolation stoïcienne. La mort pour Canetti est un scandale qu’il ne peut pas se résoudre à accepter, un adversaire qu’il veut combattre, une ombre qu’il veut empoigner. Il a connu très jeune le deuil, en perdant son père à 7 ans, et ce fut la succession des disparitions – sa mère en 1937, sa première épouse en 1963 –, sans parler de toutes les morts anonymes d’un siècle barbare. Il ne se résigne pas face à elle. Comme Goethe, qui emploie à dessein un terme administratif (statuieren), il pourrait dire : « je n’en prends pas acte ». Omniprésente, « elle ne signifie pourtant rien ». Nulle complaisance, dans ces notes indignées, pour la mort romantique, qui s’insinue dans la musique wagnérienne ou la poésie d’un Novalis ou d’un Rilke, pour la mort philosophique, vocation du Dasein chez Heidegger. Il rejette toutes les pensées dialectiques comme celle de Hegel, qui veulent faire croire à un dépassement, à un renversement positif, à un progrès futur. La mort est stérile et univoque. C’est en cela qu’elle est haïssable.

Elias Canetti © Jerry Bauer
Pourtant, « je traine un lourd fardeau, j’aime vivre », note-t-il, en avouant qu’il « hait la haine » ; il se présente comme un « défenseur inconditionnel de la vie », avec malgré tout cette mauvaise conscience bien connue du survivant. Comme si vivre, continuer à vivre, à aimer, à rire et respirer était un devoir, ne serait-ce que pour témoigner qu’existe autre chose que la Camarde. Mais il ne suffit pas de rejeter la mort inéluctable, il faut aussi prendre la mesure du scandale accru que représente « l’homicide », l’homo necans, pour reprendre le titre du livre de Walter Burkert : alors que les animaux eux-mêmes (les éléphants…) semblent aussi s’émouvoir de la perte d’un des leurs et veiller à l’enterrer, les hommes semblent prendre plaisir à s’entretuer sans raison, ce qui redouble les motifs de s’indigner. Comme s’il ne suffisait pas que l’âge, la maladie, les accidents emportent les êtres, il faut que les hommes, depuis l’humanité primitive, s’acharnent à se massacrer (et à massacrer les animaux). « Je suis chaque maison où dorment des enfants », écrit Canetti, qui règle quelques comptes avec les belliqueux : Hemingway, dont il souligne la « bêtise » – pour avoir dit que « quelqu’un qui n’a pas tué n’est pas un homme » –, Nietzsche dont il se méfie parce que ce dernier ne comprend pas « le sentiment inexpugnable, au-delà de toute morale, du caractère sacré de toute vie » –, les Allemands en général, pour leur obstination à fabriquer des gaz industriels, l’Électre de Sophocle et toute sa famille de meurtriers, les « alliés » américains de la guerre du Golfe, etc. Nous pourrions aisément ajouter des noms à cette liste interminable. C’est sur un paradoxe amer que le Prix Nobel clôt ses riches annotations – mais que peut la culture ici ? – et tire le bilan de ses expériences historiques : « J’en suis arrivé au point de finir en simple Juif ». En même temps, il trouve l’énergie, dans sa défense de la vie, d’inventer cette jolie formule : « le papillon est le fantôme de la chenille ».












