Des colonies ou implantations israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, on connaît surtout la réalité médiatique de l’actualité et celle de documentaires comme Les colons de Shimon Dotan ou plus anciennement Pourquoi Israël ? de Claude Lanzmann. En littérature, si l’on s’en tient aux œuvres traduites en français, la dénonciation de l’occupation des territoires a largement contribué à forger l’image d’un écrivain israélien contemporain, homme de gauche, engagé et pacifiste, tel David Grossman, rendu célèbre par son essai Le vent jaune, dans lequel il dénonce les souffrances imposées aux Palestiniens par l’occupation de l’armée israélienne. Auteur de trois recueils de poésie, grâce auxquels il est devenu le plus jeune lauréat du prestigieux prix Yehuda Amichai, Yonatan Berg fait œuvre nouvelle dans un premier roman ambitieux, où il invente un imaginaire de la colonie autour de deux personnages, Bnaya et Yoav, qui se détachent chacun à sa manière de la voie traditionnelle que leurs parents leur avaient tracée en les faisant naître dans une colonie, et dont les parcours montrent, au-delà du politique, de l’éthique ou de la morale, qu’être chez soi est une idée tout à fait paradoxale.
Yonatan Berg, Donne-moi encore cinq minutes. Trad. de l’hébreu par Laurence Sendrowicz. L’Antilope, 512 p., 23,50 €
La colonie qu’invente Yonatan Berg ne porte pas d’autre nom que générique. « L’Implantation » se définit par sa position dominante en haut d’une colline « balayée par les vents » qui surplombe « l’Agglomération » arabe. Quelques mètres à peine les séparent. D’un côté, le béton brut et le sol « jonché de sacs plastique emportés par le vent » ; de l’autre, les maisons « où flotte un drapeau blanc arborant une étoile d’Israël », organisées en cercles concentriques autour de la synagogue, avec aux premiers rangs les villas des anciens, et aux derniers les préfabriqués de leurs enfants : « Quelques-uns sont restés là par conviction idéologique, d’autres parce qu’ils recherchent une meilleure qualité de vie, un environnement calme et un loyer modéré. Les jeunes couples ne sont pas facilement admis et doivent d’abord prouver leur réel attachement au lieu. Toute demande d’emménager dans une maison en dur est méticuleusement examinée. »
Pour ceux qui ont choisi de rester dans l’Implantation, la vie en communauté a ses douceurs, avec un quotidien qui se déroule au rythme des repas, des offices et des événements familiaux qui sont autant d’occasions de se réunir. Chaque semaine, à la synagogue, on accueille en chantant « l’obscurité qui annonce l’arrivée du shabbat ». « Les mains se joignent, une ronde se forme, menée par le rabbin, autour de l’estrade du chantre, personne ne reste hors du cercle », tandis que, dans la galerie des femmes, « les regards se croisent et s’encouragent […] pas une ne chante plus fort que l’autre, petits filets de notes délicates, d’où s’élève une mélodie qui reste en suspens, s’éteint, puis s’élève à nouveau ». Puis, dans chaque maison, on partage « la table du shabbat, les chants, la douce lumière des bougies ».
Cependant, cet espace envisagé par ceux qui l’ont conçu comme une « concrétisation de la victoire », une « terre promise », ou encore la « vigne d’Israël », condense les tensions propres à un endroit fermé, recroquevillé sur lui-même et constamment menacé. Au-delà des barbelés et des guérites, l’Agglomération, autre de l’Implantation, avec ses constructions denses et anarchiques, constitue un « là-bas » menaçant, « où rien ne bouge, ni voitures, ni habitants, du moins c’est ce qu’ils voient de là où ils se trouvent : une entité hermétique et menaçante, un tsunami de béton et de pierre en suspens qui n’a pas encore choisi le moment où il se déversera sur les plages de l’Implantation et la submergera ».

Yonatan Berg © Dina Guna
Mais c’est surtout la décision prise à Jérusalem de démanteler la colonie qui divise l’Implantation entre ceux qui se battent pour l’intégrité du pays et ceux qui capitulent, ceux qui sont enfermés dans leurs valeurs spirituelles et les pragmatiques. Noam crée le scandale en proposant l’organisation d’une seconde prière qui privilégierait la ferveur et l’exaltation plutôt que la « routine efficace qui se garde de toute émotion ». Sa femme, Sarith, dénonce une réalité étouffante, « les ragots incessants dans la galerie des femmes, trop de promiscuité et la sensation que tout le monde sait tout sur tout le monde ». Parce qu’ils considèrent l’évacuation prochaine comme l’occasion à saisir d’un renouvellement des idéaux communautaires, qu’il faut préparer en douceur, Noam et Sarith voient se déchaîner contre eux la violence d’un groupe de jeunes séduits par l’extrémisme. Alors que les rabbins préconisent de « s’engager sans compter contre l’évacuation […], en évitant bien sûr une violence exagérée ou incontrôlée », les femmes défendent un lieu de vie et de bon voisinage, à l’instar de Yaël qui s’indigne : « Vous savez quoi ? Je me fiche complètement de ces palabres autour du Retour volontaire, du Grand Israël ou de ce qu’on peut lire dans la presse. Ce qui compte, c’est que les gens se comportent correctement autour de moi, peu importe où j’habite, telle est ma responsabilité ! ». Quant à Gaby, un ancien de la première génération, il déplore sans capituler : « C’est nous, ma génération, qui avons scié la branche sur laquelle nous nous étions construits. À force de nous barricader. » Dans la fracture de ces voix discordantes, se pose la question de l’avenir de l’Implantation : l’idéologie peut-elle définir un ancrage au monde qui se transmettrait de génération en génération ? Ou bien est-elle vouée à créer de la violence, les barbelés scellant le destin tragique de l’Implantation et sa destruction inévitable ?
Autour de ce thème, Yonatan Berg construit en contrepoint les trajectoires de Yoav et Bnaya, en utilisant l’alternance des chapitres. Bnaya a choisi de faire sa vie en restant dans l’Implantation. Marié et père de deux enfants, il enseigne les textes anciens dans un lycée de Jérusalem. Écartelé entre les exigences de la religion et le quotidien de sa vie familiale, entre le déni de la présence palestinienne et une certaine compassion, il est pris dans un figement interne, « presque autiste, comme si la foi se résumait en une quête intérieure et spirituelle, bâtie sur la rêverie et l’émotion, imperméable à un monde où il existerait des rues, des voitures, des stations-essence et des gens affamés ». Il se traîne dans « la morne routine quotidienne, celle du lycée, de chez lui, des dîners, des prières, des repas de shabbat. Depuis des mois, voire des années, il reste assis sur des chaises, des canapés, en salle des profs, à la synagogue ou chez lui, depuis des mois, voire des années, il s’endort lourdement et se lève fatigué, réveillé par les enfants ». Loin de se reconnaître dans l’idéologie de l’Implantation, il l’envisage comme une limitation, une angoisse insupportable au point de devenir repoussante et hostile s’il n’y avait la peur du déracinement : « Il ne ressent aucune sympathie pour ce lieu, aucune solidarité, aucune sollicitude envers les autres. Même ce terme de sollicitude le laisse perplexe. […] Seule la vue qui s’amorce par la porte d’entrée ouverte – enchevêtrement de branches et de feuillage, pelouse qui s’étend jusqu’à la route étroite – le rattache aux grands mot d’‟implantation” et de ‟Judée-Samarie”. Il est incapable de s’imaginer ailleurs qu’au sein de cette nature-là, tout autre paysage envisagé est aussitôt rejeté ».
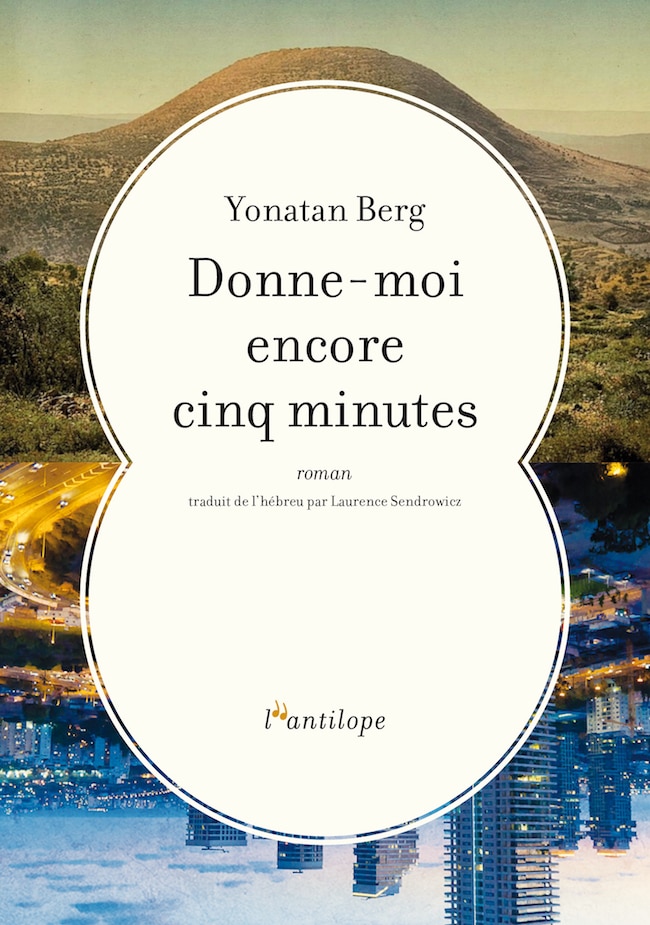
Quant à Yoav, qui a quitté la colonie en même temps qu’abandonné la religion pour vivre à Tel Aviv, « une ville étrange, pleine de jeunes, d’excitation, de bars et de boîtes, mais dénuée de joie », il découvre qu’il ne suffit pas de s’éloigner pour rompre avec l’idéologie de l’Implantation, car tout « ce qui lui est extérieur fond et se dissipe. Les rues de Jérusalem se déversent dans les vallées, continuent jusqu’aux villages et aux implantations alentour, bientôt elles résonnent des lamentations des chacals qui errent dans ces zones frontalières, puis ce sera le désert et la mer Morte. Vaste lac sombre ». S’il parvient à dissoudre provisoirement ses attaches dans la drogue et les voyages en avion, son passé le rattrape lorsque, drogué à l’acide, il revit la violence fratricide d’une expédition à laquelle il a participé durant son service militaire. La figure de Segal, son chef d’escadron, revient le hanter tout autant que celle du terroriste palestinien dont il a recouvert le visage de terre. Condamné à la solitude, englué dans une immobilité fulgurante, Yoav ne parvient pas à dépasser la différence malheureuse de son origine : « – Je suis né dans une Implantation. Il a beau avoir fait cette réponse une infinité de fois, il ne sait toujours pas ce qui s’en dégage : de la fierté, de la honte, de la culpabilité ? Sans doute un peu des trois, mais ce qui prévaut, c’est l’affirmation d’une origine singulière, voire exotique. Pas uniquement à cause de l’image que ça renvoie, celle d’une vie dans une communauté germée en haut d’une colline isolée, mais aussi à cause de ce qui a poussé une partie de la population de ce pays à s’installer de l’autre côté de la ligne verte : le sacrifice et le partage. Deux notions qui l’avaient envoûté dans son enfance puis lui avaient fait honte. […] À la surprise mêlée de rejet distant succède de la bienveillance, voire de la compassion. Ils comprennent qu’il vient de loin. Comme si en mentionnant ce mot d’implantation, il avait inclus dans sa réponse le jeune homme qu’il était aujourd’hui, vêtu d’un jean, mal coiffé et mal rasé, sans kippa : une silhouette incarnant le long chemin qu’il avait dû parcourir pour en arriver là ».
Entre la Cisjordanie et Tel Aviv, Yonatan Berg fait de l’Implantation un lieu tragique que l’on habite sans jamais être chez soi et que l’on quitte sans jamais s’en délivrer. L’idéologie reçue en héritage est un fardeau qui étouffe le quotidien et désespère ceux qui rompent avec elle. Pour s’en libérer, Yoav et Bnaya doivent renoncer au temps infini de leur enfance, c’est-à-dire à la vision « d’un monde stable inscrit dans la durée offrant l’image immuable du wadi qui conduit à la mer Morte et des collines qui se hissent vers Jérusalem ».
« Malheur à celui qui n’a pas de chez-soi », écrivait Rilke. Pour ceux qui sont nés dans un monde qui se défait sans cesse, l’absence de chez-soi devient un destin. Plus qu’une perte ou un déracinement, elle ouvre la possibilité d’une quête, celle d’un lieu qui résonnerait juste, grâce à des liens choisis à l’espace, aux choses et aux personnes. Dans une écriture que la traduction de Laurence Sendrowicz rend précise et puissante, Yonatan Berg s’attaque à la colonie comme à un bloc de matière qu’il entame petit à petit par différents angles. Grâce à une construction romanesque admirablement musicale, qui repose sur le contrepoint, les résonances et les effets d’écho, il brouille les différences et fait surgir les ressemblances là où on ne les attend pas. Face à la « vérité esclave du texte, belle, blanche, sans malice », comme la décrit Mahmoud Darwich, il fait scintiller la polysémie de la vie et interroge le sens de notre rapport au monde dans un temps un instant suspendu.












