La ballade silencieuse de Jackson C. Frank est la biographie subjective d’un musicien de folk dont le talent finit par s’évaporer comme le brouillard au-dessus d’un lac : à force d’immobilité. Cette destinée abîmée dessine comme l’envers obscur de la trajectoire puissante de Bob Dylan. Par la grâce d’une écriture concentrée en images sur le corps et les sensations, Thomas Giraud arrive à nous rendre lumineuse une silhouette fragile, et à représenter la musique comme couleurs, odeurs et formes.
Thomas Giraud, La ballade silencieuse de Jackson C. Frank. La Contre Allée, 176 p., 17 €
L’enfance de Jackson C. Frank (1943-1999) prit fin brutalement : la chaudière de sa classe de musique explosa quand il avait quinze ans. L’accident fit quinze morts, lui laissant de graves brûlures au front et à la poitrine qui nécessitèrent des greffes de peau et de longs mois d’hôpital. La peau des greffes fut découpée sur sa cuisse, ce qui provoqua – on était en 1954 – une raideur permanente de sa jambe gauche.
Thomas Giraud part de l’hypothèse que cet événement fut à l’origine de la vocation de Jackson. Non seulement par le don d’une guitare qu’un oncle lui fit pour occuper les longues journées d’ennui à l’hôpital, non seulement par le choc psychologique, mais surtout par les transformations du corps. La faiblesse nouvelle de sa jambe : « Il ne peut plus grimper aux arbres, danser, s’asseoir en tailleur, aller à la piscine, courir sur une piste d’athlétisme, ni même courir tout court. Son corps n’est plus modifiable, ses limites sont déjà connues, fixées. Il ne pourra que faire à la marge, et le plus souvent sans le corps, avec des astuces. Une grande raideur, figée, s’est installée », tandis que son visage changé lui confère une double étrangeté : « Il lui faut aussi adopter ce presque nouveau visage, cette partie trop tendue de sa peau sur le haut de son front. Cette couleur un peu plus claire de la peau de la cuisse qui a moins connu le soleil. Faire comme il peut avec cette nouveauté de lui-même, oublier le plus possible le regard des autres sur cette partie de peau qui chauffe, jaunit et rosit de manière disgracieuse quand elle est regardée ».
Ces altérations vont dans le sens de la timidité de son caractère, le vouent un peu plus à l’ombre. Comme sur cette photo des enfants blessés dans l’accident où on l’a relégué au fond, parce que l’Amérique des années 1950 préfère voir des visages souriants plutôt que des stigmates, suppose Thomas Giraud. Le texte frôle cette silhouette, ce corps, sa façon d’occuper l’espace, de trouver des moyens de se tenir droit.

Thomas Giraud © Jérôme Blin
Les blessures, le traumatisme, lui valent cependant des compensations encourageant son goût naissant pour la musique : une guitare neuve, une visite de la maison d’Elvis Presley. Il existe une autre photo de Jackson où on le voit de nouveau « dans l’ombre », cette fois l’ombre du solaire Elvis. Car le jeune garçon a eu la chance de passer une après-midi avec le chanteur, de jouer sur ses guitares, de bénéficier de ses conseils. Tout concorde. Son destin semble tracé. L’accident l’a conduit du côté de la musique. Il sera artiste, puisque même l’espace américain qu’il traverse lui est donné par le biais de la musique folk, « les plaines des chansons traditionnelles » : « Jackson expérimente à travers le pare-brise des paysages qu’il ne connaît pas mais qui pourtant lui sont familiers. Ressentir, comme l’aurait chanté Woody Guthrie, que This Land Is Your Land ».
Pour trouver sa voie, il lui faut maintenant inventer ses propres chansons, découvrir plus qu’un style : une structure. Thomas Giraud imagine qu’un tableau de Rothko constitué de deux rectangles orange et jaune lui révèle « la nécessité d’une forme géométrique, bien délimitée, pas trop grande pour encadrer et rassurer ses chansons », du côté d’une certaine sobriété, d’une économie aussi qui caractérisera ses compositions. Mais la blessure, la greffe, est encore ce qui détermine Jackson dans sa recherche d’une expression artistique : « Orange and Yellow ressemble à ce qu’il croit voir de son bout de peau lorsqu’il essaie d’en comprendre les contours en partant de l’intérieur de lui-même : il lève la pupille gauche vers le haut de son œil, et lit, sous son front, la forme de peau changée. Le bout de peau et les formes du tableau réussissent à aplanir toute fragmentation et font avancer et reculer la couleur, toujours dans ce dégradé d’agrumes. Au pied de la lettre, c’est une révélation. »
L’auteur parvient à exprimer à la fois précisément et poétiquement le lien entre l’extérieur et l’intérieur, entre le corps et l’esprit, entre la biographie et l’œuvre. Depuis l’incendie, Jackson garde en lui l’odeur de la suie, le goût de la cendre. Les senteurs de l’eau, cet élément qui combat le feu, qui dans le livre est du côté de la stagnation, de la permanence, reviennent aussi souvent. Le jeune musicien va chercher à exprimer dans ses morceaux « ce que l’on ne chante pas. Dire des peines profondes, sourdes, effroyables parfois, parler du feu dont Je sens les braises froides, de la peau déplacée. Il voudrait raconter même si ce n’est pas bien clair dans son esprit ».
Toutes les fées semblent se pencher sur son berceau. À sa majorité, il touche une indemnisation non attendue, une fortune qui lui permet de vivre comme il veut, d’acheter les voitures de luxe qu’il aime. De partir pour Londres où, après Elvis, il rencontre un second parrain musical, Paul Simon, qui produit son unique album. Il sort avec Sandy Denny, une chanteuse qui va faire d’une de ses chansons un succès.
Mais à partir de là, la machine se grippe, s’enraie, la belle histoire ralentit, s’arrête. Le disque n’a pas d’audience. Si les compositions de Jackson ont la mélancolie intemporelle et la perfection close sur elle-même qui vont faire de « Blues run the game », « Milk and Honey » ou « My name is Carnival » des classiques, il leur manque ce qui commence à caractériser l’époque (on est en 1965) : l’innovation, l’expérimentation, l’excitation.
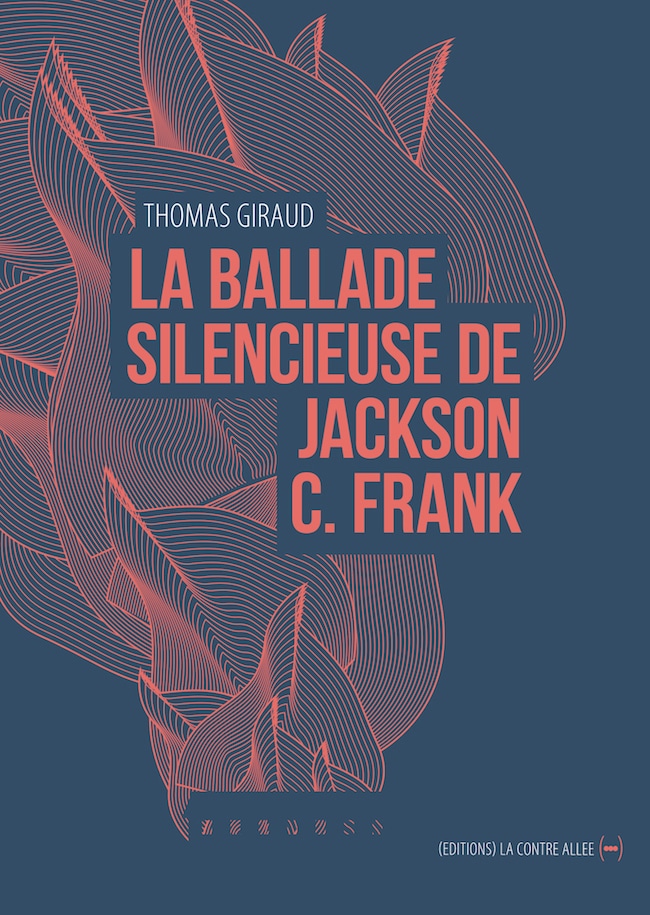
Ici apparaît celui qui semble partout précéder Jackson, être toujours en avance sur lui. Celui qui ne fait du jeune homme brûlé qu’un double, une ombre. Bob Dylan a deux ans de plus que Jackson. Celui-ci va l’entendre, et le choisit d’emblée comme aune à laquelle se mesurer : « Jackson est séduit et sûr de lui, Je veux faire la même chose. En beaucoup mieux. Ce qui pour lui veut dire chanter de manière plus appliquée, poser sa voix, être plus juste, plus en rythme, plus droit. Que la musique ne soit pas si oscillante. » Mais c’est justement parce que Dylan oscille qu’il y a dans sa musique « une promesse de choses en mouvement que l’on ne sent pas chez Jackson alors que tout le monde n’attend que ça ». L’autre, le rival, a enregistré Highway 61 revisited quelques mois avant l’album de Jackson, ce qui rend celui-ci obsolète avant même sa sortie.
Il y a de la raideur chez Jackson. Pas de mouvement. Pas le souffle de l’époque en marche. Il passe de plus en plus de temps au bord des lacs du nord de l’Angleterre, à ne rien faire, à retrouver l’atmosphère humide de sa ville natale, Buffalo, coincée entre les lacs Ontario et Érié, « ces odeurs qui fermentent, cette impression de renoncement du lac, ce vieillissement tranquille ». Il ne compose plus, rentre aux États-Unis. Par une ironie du sort, c’est à Woodstock qu’il s’installe. Au début des années 1970, on le voit passer « des heures, la nuit, devant le seul feu de signalisation de Woodstock à guetter le fugace passage à l’orange qui lui fait faire, à chaque fois, un petit saut ». Toujours sur place. Paradoxalement encore, c’est dans Times Square, au cœur de New York, ville-phare de l’art, qu’il touche le fond et devient SDF.
Thomas Giraud n’essaie pas d’expliquer ce ralentissement, cet enlisement après un départ vibrant. Il le raconte à travers une écriture brillante de clarté à force d’être concrète, donnant à percevoir les couleurs, les odeurs, le poids des matières et des gestes. La beauté du livre tient à la proximité qu’il établit avec la trajectoire d’un homme blessé, sans jamais le juger, en le montrant. Et tient aussi au fait qu’il tente de représenter ce qui peut difficilement être cerné : le processus de la création artistique.












