Prospérité, progrès, paix, tels étaient les bienfaits qu’allait offrir la liberté de la presse dans une société responsable, promettait Jean Schwœbel en 1968. Cinquante ans après, c’est l’histoire d’une bataille perdue que raconte la réédition de La presse, le pouvoir et l’argent, celle d’une lutte acharnée pour l’indépendance financière de l’information.
Jean Schwœbel, La presse, le pouvoir et l’argent. Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 368 p., 23 €
Publié à l’époque avec une préface de Paul Ricœur, le livre plaidait pour un « service d’intérêt public », détaillant les propositions des sociétés de rédacteurs. Aujourd’hui, l’avant-propos d’Edwy Plenel ouvre un nouvel horizon de combat : en se guidant sur les propositions de Schwœbel, construire une indépendance économique garantie par le soutien des lecteurs et contrôlée par les équipes rédactionnelles, inventer les réponses qui nous manquent pour y parvenir.
Ricœur appelait les enseignants à reconnaître aux journalistes un statut d’intellectuels et un rôle complémentaire du leur en matière d’éducation permanente : « L’informateur de presse a ainsi la charge de l’instruction généralisée de l’homme-d’après-le travail. » Les journalistes ne sont pas des salariés ordinaires, ils coopèrent à la production de l’information, aussi convient-il de les associer à la gestion des entreprises de presse, comme le propose Schwœbel. Depuis, les dangers contre lesquels tous deux mettaient en garde – confiscation des médias, presse commercialisée, dépolitisation, égoïsme collectif des pays nantis, préjugés de la foule – sont largement advenus. Pourtant, les conditions souhaitées par Schwœbel ont été en partie satisfaites ; la fin du monopole de l’État sur l’ORTF, les aides publiques aux journaux, la multiplication des sociétés de journalistes, n’ont pas suffi à empêcher le déclin annoncé.
À l’époque où il écrit son livre, Schwœbel vient de fonder avec une petite équipe la Fédération française des sociétés de journalistes, lesquelles se multiplient, sur le modèle créé par les journalistes du Monde en 1951, relayés dans les années 1960 par ceux du Figaro et de Ouest-France. Une contre-offensive intitulée Presse, argent, liberté paraît en 1969, les accusant de « détourner de la presse les capitaux nécessaires à son expansion, peut-être même à sa survie ». L’auteur du brûlot, Philippe Boegner, avait redressé un Paris Match au bord de la faillite en payant au prix fort un reportage exclusif de la conquête de l’Annapurna, pour un tirage à 320 000 exemplaires qui assurera au magazine un succès durable. Les lignes de bataille sont tracées. À la tête pendant vingt et un ans de la Société des rédacteurs du Monde, Schwœbel livre, selon un historien du journal, une « guérilla institutionnelle » visant à accroître leurs prérogatives : un conflit permanent l’oppose au directeur, Jacques Fauvet, à tel point que Hubert Beuve-Méry, « excédé par les textes de Jean Schwœbel, vient exceptionnellement porter secours à son successeur [1] ». Un de ces textes a provoqué la démission collective du conseil d’administration. Une commission de la Société des rédacteurs décrit un mauvais fonctionnement de ladite société en dépit de l’attachement des rédacteurs à son principe, et juge que le conflit entre le directeur du journal et le président de la société « a un caractère personnel ». L’année suivante, Schwœbel ne demande pas à renouveler son mandat d’administrateur.
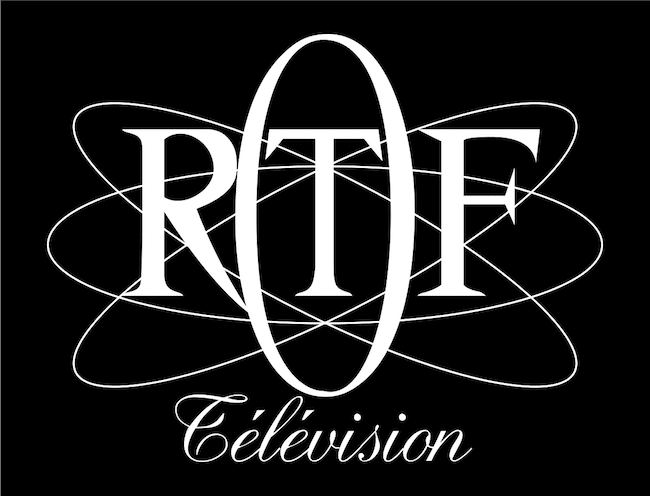
Que vaut aujourd’hui son diagnostic ? Quel est l’intérêt d’une telle réédition, qui d’ailleurs a été « complétée », sans qu’on sache trop par qui, et dans quelles proportions. Certains paragraphes en italique ont été rédigés par l’auteur lors de l’édition allemande de son ouvrage, indique une note, mais les pages sur la crise du Figaro en 1971, par exemple, ou une phrase comme « depuis que M. Pompidou est devenu chef de l’État » – le 20 juin 1969 – laissent perplexe. Le paysage de la presse a radicalement changé depuis 1968, pour des raisons que Schwœbel n’avait pu prévoir. La baisse du lectorat a commencé vers la fin des années 1970, avant l’expansion des nouvelles technologies, avant les quotidiens gratuits, avant l’apparition des réseaux sociaux, entraînant la baisse des recettes publicitaires, l’entrée au capital d’actionnaires industriels, et la baisse de qualité de l’information : manque d’argent pour les reportages, manque de temps pour mener les enquêtes et analyser les sujets sensibles. Le problème aujourd’hui comme jadis reste le nerf de la guerre ; nous en sommes bien conscients à En attendant Nadeau, qui subsistons grâce à une rédaction bénévole, aux dons des lecteurs et au partenariat avec Mediapart.
Ce qui reste d’actualité, c’est l’horizon visé par Schwœbel. On aimerait que la presse ressemble au modèle esquissé dans ce livre, comme on aimerait croire qu’elle y travaille dans sa majorité, soucieuse de qualité et de rigueur, consciente de ses responsabilités dans une société où la complexité croissante du monde fait du droit à l’information une nécessité absolue. Le modèle rêvé ici, c’est celui qui a failli exister à la Libération, et qui a inspiré Le Monde dont la refondation sous l’égide de Beuve-Méry a montré « ce que pouvait être un quotidien moderne : parfaitement indépendant, et obsédé de qualité ». Après avoir attribué les biens des anciennes presses aux quotidiens issus de la Résistance, les gouvernants auraient dû en préserver l’esprit en faisant voter, comme ils l’avaient promis, un statut de la presse qui l’aurait soustraite au contrôle exclusif de l’argent. Mais les projets de statut ont été enterrés les uns après les autres par la commission de la presse de l’Assemblée nationale, où les directeurs de journaux étaient dominants.
Or la presse a une mission, martèle sans relâche Schwœbel : informer, éduquer. Elle a le devoir d’inquiéter, de mettre les lecteurs en face de leurs responsabilités. De troubler leur tranquillité en les éveillant à tous les dangers qui menacent la planète : famines, distorsion croissante entre pays riches et pays pauvres, exaspération des nationalismes, course aux armements, impératifs de profit… La course à la manne publicitaire entraîne une série de maux et de contraintes contradictoires : offrir du sensationnel, mais ne choquer personne, ménager les intérêts des annonceurs, privilégier le divertissement et l’évasion. Les directeurs, pris dans un étau, font face à des coûts de plus en plus élevés. Certains sont devenus « impérialistes par nécessité ou par tempérament », sans voir qu’ils y perdaient l’idéal dont ils étaient animés à leurs débuts. Faute de moyens, la plupart des journaux n’ont pas d’économistes dignes de ce nom ni de spécialistes des questions sociales, politiques, diplomatiques, pas de correspondants à l’étranger, et donnent la priorité aux nouvelles locales, aux faits divers. Le printemps 1949 marquait la victoire du communisme en Chine, mais la presse a concentré ses meilleurs journalistes et ses ressources à la couverture du mariage d’Ali Khan avec Rita Hayworth dans le Midi.
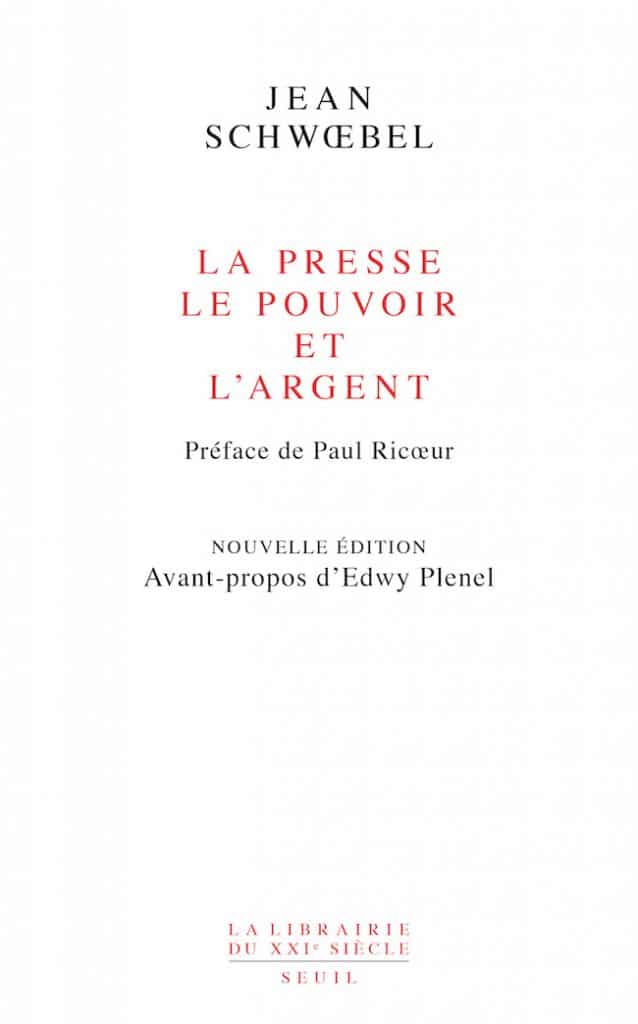
Différents systèmes sont envisagés pour trouver le juste équilibre entre « apporteurs de capitaux » et « apporteurs d’idées », « capital argent et capital talent » : nationalisation, copropriété, coopérative, cogestion. La seule solution, selon Schwœbel, c’est une société commerciale à but non lucratif ou, de façon plus réaliste, à lucrativité limitée, susceptible d’éloigner les spéculateurs en tout genre et d’attirer des hommes « de qualité et d’action, heureux de contribuer, en association avec les journalistes, au bon fonctionnement du “service public” de l’information ». Ces hommes devraient être choisis pour « leur dévouement à la chose publique, leur vocation pour les questions de presse », et leurs responsabilités de gestion et de contrôle ne pas se transmettre automatiquement à leurs héritiers comme dans les entreprises classiques. Seule une coopération « étroite et confiante » avec les « apporteurs d’idées » peut « garantir que la mission d’information prédominera toujours au sein de cette entreprise en dépit de sa nature commerciale ». Hélas, leur antinomie joue presque fatalement en faveur du mercantilisme : l’expérience l’a prouvé, les nécessités techniques et financières l’emportent généralement sur les exigences d’un service d’information de qualité. Cinquante ans après, ce triste constat reste d’actualité.
Schwœbel proposait une Fondation nationale de l’information qui aurait pour responsabilité de discipliner la profession, et qui rétablirait les conditions d’un véritable pluralisme des opinions en louant à bas prix les équipements les plus modernes à des équipes de journalistes offrant les garanties désirables de qualité. Et réclamait que l’État, au lieu de maintenir son emprise sur l’ORTF, « donne son plein appui législatif et financier à l’effort qu’il convient d’entreprendre pour soustraire l’information, autant que faire se peut, aux lois du marché et du profit ». Sont signalées au passage les « pratiques malthusiennes » de la corporation du livre, qui impose un suremploi croissant malgré les progrès des outils de fabrication, et freine l’introduction de techniques nouvelles destinées à réduire le prix de revient d’un journal. Mais on n’arrête pas le progrès. Naguère, après six années d’apprentissage, un bon artisan pouvait produire jusqu’à cent cinquante lignes de plomb par heure : une machine IBM, plus de trente mille. Dans les imprimeries les plus modernes, fini le plomb, les lumitypes crachent une ligne de copie à la seconde.
Les nostalgiques des ateliers à l’ancienne pourront les retrouver dans les images virtuoses de Pentagon Papers, dont la sortie coïncide avec cette réédition, apportant un soutien imprévu au propos de Schwœbel. Nous sommes en 1971. Le New York Times est contraint par ordonnance judiciaire d’interrompre la parution d’un rapport secret sur la guerre du Vietnam. Le Washington Post entend le publier, malgré les pressions exercées à la fois par le gouvernement de Nixon et les banquiers partenaires du journal, au moment de son entrée en bourse. Ce rapport, commandé par McNamara, ministre de la Défense, fuité par un membre de la RAND Corporation, ancien Marine, révèle que quatre présidents successifs ont continué à envoyer des troupes fraîches au Vietnam alors qu’ils savaient depuis des années que les États-Unis ne pouvaient gagner cette guerre, aucun ne voulant assumer l’humiliation d’une telle défaite. C’est le New York Times qui avait sorti le scoop, ses journalistes actuels le rappellent avec aigreur, furieux de s’être fait voler la vedette, mais ce n’est pas le scoop qui compte en priorité dans le film de Spielberg, c’est le courage de le publier. Le Post, incarné par sa fragile et forte directrice, Kay Graham, y risquait sa survie.
-
Patrick Eveno, Histoire du journal “Le Monde”, 1944-2004, Albin Michel, 2015, qui reprend et prolonge “Le Monde“ : Histoire d’une entreprise de presse, 1944-1995, Odile Jacob, 1996. À noter que Schwœbel n’apparaît nulle part dans Le Journal “Le Monde” : Une histoire d’indépendance, Odile Jacob, 2001, du même historien.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)




