Le Golestān (La Roseraie) et le Bustān (Le Verger ou simplement Le jardin) sont les deux chefs-d’œuvre de Sa‘dī, tous deux achevés à Shirâz au milieu du XIIIe siècle (Le Verger en 1257 ; l’année suivante pour La Roseraie). Chacun est un florilège de conseils pour bien mener sa vie.
Sa‘dī, Le Jardin des roses et des fruits. Libretto, 768 p., 12,80 €
La composition de ces deux textes est analogue : selon la méthode des Orientaux, Sa‘dī préfère à l’exposé didactique un subtil composé d’historiettes, de sentences sapientales, d’exhortations solennelles. La proportion de ces ingrédients n’est pas la même ici et là : plus d’historiettes, plus vivement contées dans La Roseraie, plus de discours dans Le Verger. Bien nommés, un traité a l’éclat chatoyant des fleurs, l’autre quelque pesanteur, qui sied aux fruits mûrs. En réitérant le même contenu dans deux registres, Sa‘dī a démontré la souplesse de son talent rhétorique. Dans le monde de Sa‘dī, comme dans beaucoup de civilisations traditionnelles, on aime l’éloquence qui redit bellement des pensées déjà connues.
Le Verger est écrit entièrement en vers, tandis que La Roseraie mêle vers et prose. Ce point peut échapper au lecteur, puisque l’éditeur n’a pas jugé utile de l’informer que les deux textes ici réunis sont des traductions en prose d’originaux partiellement ou totalement en vers. La traduction de La Roseraie est celle de Charles Defrémery (et non Defrémy comme indiqué en quatrième de couverture), publiée en 1858. La traduction du Verger est due à Charles Barbier de Meynard, elle a été publiée en 1880. Les éditions originales de ces deux traductions sont disponibles sur Gallica, précédées d’introductions substantielles, encore utiles. Avant de dire combien il est nécessaire de lire Sa‘dī, il faut prévenir le lecteur que cette réédition, bien que pratique, n’est pas sans défauts. Non seulement les introductions ont disparu mais aussi la plupart des notes, ce qui rend parfois le texte difficilement compréhensible pour qui ignore la civilisation persane médiévale. Or cette édition n’est-elle pas destinée au grand public ? Qui, dans ce public, a sous la main un dictionnaire persan, pour comprendre ce que signifie « un compagnon de kédjâweh » ? Qui, s’il n’est pas familier du Coran, comprendra pourquoi la vue d’un beau jeune homme conduit ses admirateurs à se couper les doigts (p. 175), ou encore ce que signifie être « vorace comme la verge de Moïse » ? Les notes supprimées éclaircissaient ces difficultés et bien d’autres. Il y a pire : on trouvera plusieurs mentions de « la casbah », là où il faudrait « la Ka‘ba », ce que confirme un rapide coup d’œil au texte persan ; mais comment le savant Defrémery a-t-il pu commettre une pareille bourde ? Contrôle sur l’édition de 1858 : Defrémery n’avait commis aucune bourde, mais l’éditeur moderne n’a pas su le recopier sans faute.
On doit regretter que Libretto ne donne aucune information sur l’origine des traductions, car il est significatif que Sa‘dī ait été traduit au XIXe siècle par des éminences de l’orientalisme. L’Orient des lettrés européens était alors littéraire et historique. Il enchantait par le pittoresque des situations, des métaphores, des sentences. Ce ne sont plus des mêmes auteurs que nous nous nourrissons. Pour nous limiter aux natifs de Shirâz, le plus commenté aujourd’hui en Europe est probablement le difficile et passionnant philosophe Mullā Ṣadrā Širāzī (dont, sauf erreur, aucun texte n’était traduit en langue occidentale il y a une soixantaine d’années) et plus du tout l’aimable Sa‘dī. En schématisant, on pourrait dire que le XIXe siècle a cherché en Iran l’exotisme, tandis que le XXe y a cherché la métaphysique. Qu’y chercherons-nous maintenant ? Pourquoi relirons-nous Sa‘dī ?
Charles-Henri de Fouchécour fut probablement le premier à proposer une nouvelle approche : « les deux écrits complémentaires de Sa‘di (…) ont magistralement exprimé pour de nombreuses générations ce qui était vécu à l’intérieur d’une culture commune » écrit-il dans ses Notions morales dans la littérature persane du 3e/9e au 7e/13e siècle [1]). En effet, Sa‘dī, styliste et conteur délicieux, mais penseur peu original, vaut précisément par son absence d’originalité : il nous donne à entendre ce que fut l’éthique d’une civilisation.
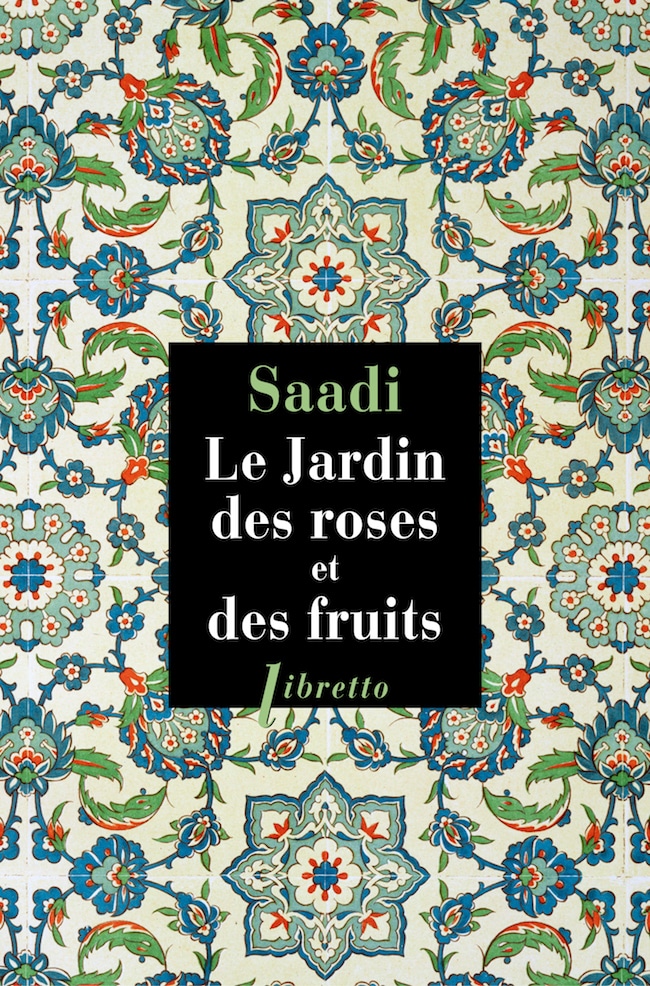
La morale de Sa‘dī est tout entière placée sous l’éclairage d’une mystique. Pour Sa‘dī et son temps, la bonne conduite n’est pas une fin en soi, il ne s’agit pas de s’admirer en juste. Rien de plus vigoureux que sa condamnation des dévots qui se croient justifiés par leurs dévotions : « Ne t’acharne pas à la poursuite de la pureté parfaite, c’est un dessein démesuré et coupable (…). Le pécheur plein de la crainte de Dieu l’emporte sur le juste qui fait parade de sa dévotion. » « Quiconque a renoncé à la concupiscence, afin de gagner l’approbation des gens, est tombé de la concupiscence licite à la concupiscence illicite. » C’est absolument le contraire du moralisme des modernes qui, depuis l’aube du capitalisme (si l’on comprend ainsi Weber) jusqu’au post-historique « Empire du bien », vise à conforter l’homme de bien dans l’estime qu’il s’accorde. Pour Sa‘dī, la discipline morale n’est qu’un entraînement au don de soi, à l’oubli du moi, à l’amour (peu importe si dans l’amour on perd dignité et raison). Aussi voyons-nous, dans les chapitres consacrés à cette affection, s’effacer le moraliste modéré devant le Sa‘dī mystique, annihilé dans l’amour : « Près de toi ma vie s’est anéantie et ton amour a effacé de moi le sentiment de l’existence. »
Pour Sa‘dī, la morale n’est pas un absolu, elle est la porte d’un absolu. Les préceptes moraux n’ont de valeur que relative. Aussi Sa‘dī ne cherche-t-il pas à effacer ses contradictions, recommandant ici d’être impitoyable envers les méchants et là de tout leur pardonner, faisant tour à tour l’éloge de l’ascèse ou de la vie équilibrée sans privations excessives : ces contradictions rappellent que nous sommes dans le monde de l’incertitude, que le bien pur ne s’y trouve pas. Les contradictions sont si nécessaires à cette éthique que le poète les met volontiers en scène dans des débats rhétoriques qui ne concluent rien (ainsi, le long débat sur les mérites de la richesse et de la pauvreté). Est-il si peu sérieux ce Saadi, qu’il mêle la joute poétique à la recherche du bien ? C’est précisément parce que son éthique est sérieusement orientée vers un au-delà, que l’incertitude et l’humour y sont des vertus : en somme, c’est le sens de l’absolu qui fonde le relativisme.

Mausolée de Sa‘dī, à Shiraz
Ce relativisme n’empêche que le moraliste tienne très fermement certaines positions. Avant tout, ce qu’avec un anachronisme éhonté, je suis tenté d’appeler son anticapitalisme. Le capitalisme ne naît pas avant que ne l’emporte cet étrange désir : accumuler la richesse plutôt que d’en jouir. Or, pour Sa‘dī, la richesse n’est en rien condamnable, à la condition que le riche dépense. Il peut même dépenser jusqu’à se ruiner, ce qui n’a rien de honteux. Il est préférable qu’il dépense en aumônes, mais s’il veut dépenser pour ses plaisirs ce n’est pas un crime : « un gai viveur qui répand l’aisance autour de lui l’emporte sur le dévot qui jeûne toute l’année. » « Ne récite pas les prières sur cet être de rien qui n’a rien fait ; car il a employé sa vie à acquérir des richesses et n’en a pas joui. » « Un homme généreux et libertin, qui jouira de ses biens et fera des libéralités, vaut mieux qu’un dévot qui observera le jeûne, ne jouira pas de ses richesses et les accumulera. » L’économie et la morale économique reposent sur la dépense et la circulation des biens, ce qui a quelque coloration maussienne (Mauss ne citait-il pas le Coran dans la conclusion de l’Essai sur sur le don ?)
Ainsi Sa‘dī, généralement porté à l’indulgence, oublie toute modération pour condamner ces deux vices : se complaire à sa propre moralité, et désirer la richesse plutôt ce qu’elle procure. Or, ce sont ces deux vices dont le capitalisme naissant (si l’on en croit Weber), par un singulier retournement, a fait les fondements de la nouvelle morale.
Ouverture de l’éthique vers un au-delà de l’éthique, économie du don et de la dépense, faiblesse de la structuration politique, mais puissance de la parole qui enseigne, édifie, réprimande, voici quelques traits où nous pressentons quelque chose de la cohérence d’une culture. Sa‘dī peut encore satisfaire le goût de l’exotisme mais il a plus à nous donner : en le lisant, il se peut qu’on saississe quelque chose de la civilisation de nos intrigants voisins.
-
1986 ; ce livre fondamental est disponible dans une réédition de 2009, sous le titre Le Sage et le prince en Iran médiéval.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








