La publication des œuvres de Kierkegaard dans la Pléiade remplit un vide étonnant du catalogue de la collection, et permet de remettre à l’honneur un philosophe moins cité aujourd’hui qu’il ne le fut jusque dans les années 1960. Confiée à Régis Boyer, décédé en juin 2017, cette édition peine cependant à convaincre dans sa partie philosophique et cherche sans trop le dire à reconsidérer l’inscription philosophique de Kierkegaard dans le courant existentialiste : moins philosophe, plus littéraire et danois, ce Kierkegaard soulève bien des questions.
Søren Kierkegaard, Œuvres. Trad. du danois par Régis Boyer avec la participation de Michel Forget. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1 256 p. et 1 440 p., 62 € chacun
Ce pourrait être une occasion, un instant éditorial et intellectuel. Les œuvres de Kierkegaard sont moins commentées qu’elles ne le furent il n’y a pas si longtemps, leur accès au grand public lacunaire, et leurs traductions françaises parfois vieillissantes. Leur histoire dans la pensée française du XXe siècle a connu des cahots qui en font la complexité et l’importance, comme le rappelait Paul Ricœur dans son article « Philosopher après Kierkegaard » en 1963, qui rétrospectivement fait apparaître cet après comme celui d’un relatif oubli. L’entrée du penseur de Copenhague dans la Pléiade était l’occasion, d’abord, de saisir cet instant. La première surprise en découvrant cette édition est de constater l’absence ou la rareté des mentions de cette histoire, confinée aux scories de l’appareil critique pour l’essentiel.
Pour suivre les schémas scolaires, l’histoire dont il s’agit est celle qui relie tardivement le Danois au courant existentialiste : les premières références importantes à Kierkegaard interviennent à la fin des années 1920 par l’intermédiaire notamment de Jean Wahl et de Léon Chestov, qui acclimatent les œuvres de Kierkegaard au monde intellectuel et philosophique français de l’entre-deux-guerres à partir des traductions allemandes. Suivent dans les années 1930 des traductions erratiques, notamment celles de Paul-Henri Tisseau (qui consacra sa vie à cette entreprise, et est à l’origine des seules œuvres complètes de Kierkegaard en français, aux éditions l’Orante), et surtout l’importance croissante des références au philosophe dans une période marquée au sceau de l’anti-positivisme et d’une critique virulente des idoles philosophiques de la période antérieure. Kierkegaard innerve alors l’émergence de nouvelles figures philosophiques, notamment Gabriel Marcel dont l’oubli actuel masque l’importance décisive d’alors, mais aussi les jeunes penseurs réinvestissant le champ religieux (le jeune Levinas, Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont). Enfin, Kierkegaard est un pivot majeur dans l’introduction en France de la phénoménologie allemande, comme le montre le Kierkegaard et la philosophie existentielle (1936) de Chestov où celui-ci rappelle qu’il découvrit le penseur danois par le biais de Husserl. Dans le marigot bouillonnant du Paris intellectuel des années trente, la découverte de Kierkegaard agite large et remobilise vigoureusement, ce qui ouvre de nouvelles voies et tisse des liens entre différentes écoles de pensée. La synthèse de cette agitation, si l’on veut, se trouve dans l’éclosion du mouvement existentialiste, qui revendiqua régulièrement sa filiation danoise, de façon parfois abusive : Sartre, Heidegger (dès Être et Temps en 1927), Buber, Levinas, Mounier, Marcel : tous enrôlent Kierkegaard dans leur rapport à ce qu’on appelle l’existentialisme, rapport dont Ricœur conclut d’ailleurs qu’il n’existait pas et que la lecture de Kierkegaard qui y était associée était sujette à caution.

Søren Kierkegaard, par Luplau Janssen
La surprise est grande de ne voir, dans cette édition nouvelle, aucune mention explicite de ce contexte qui préside pourtant au rapport du public français à ces œuvres. Elle l’est d’autant plus lorsqu’on constate au détour d’une note ou d’une notice qu’il s’agit d’un parti pris intellectuel explicite pour lequel on ne donne pas au lecteur les moyens de comprendre les enjeux en cause. Ainsi de cette dénonciation de « ceux qui ont voulu voir en Kierkegaard le père de l’existentialisme », dont on comprend bien tardivement qu’ils constituent des opposants aux éditeurs de ces deux volumes de la Pléiade, lesquels expédient en un paragraphe de l’introduction le contexte philosophique rappelé ci-dessus. Si bien que la logique de l’édition ne se comprend que malaisément, presque à pas feutrés, et présente avec une clarté parcimonieuse les choix qui la sous-tendent – ceux à grands traits d’une révision de l’histoire philosophique et existentialiste de Kierkegaard, qui reste sa situation dominante aujourd’hui dans les milieux universitaires et intellectuels français.
Rien d’étonnant à cela, d’une certaine manière, puisque cette édition (traduction et appareil critique) a été confiée à Régis Boyer, le soin de conclure le travail ayant été confié à Michel Forget. Le premier, immense spécialiste des langues et civilisations scandinaves, s’est déjà illustré dans la collection de la Pléiade pour y avoir défriché les grands textes scandinaves (sagas islandaises, Andersen, Ibsen notamment). La décision de lui confier l’édition de Kierkegaard appartient ainsi à une logique interne à la maison Gallimard et à la collection, mais il n’en reste pas moins que le choix est lourd de faire éditer une référence éminemment philosophique dans l’histoire intellectuelle française par un non-philosophe ; d’autant plus lorsque cela n’est pas spécifié avec limpidité dans l’appareil critique. Ce manque de clarté est d’autant plus dommageable que ces deux volumes sont portés par un autre désir qui pâtit lui aussi de ce déficit d’explicitation : la volonté de saisir Kierkegaard dans toutes ses dimensions, en restituant les multiples volets de sa courte et productive carrière où il fut tout autant philosophe que polémiste, prêcheur, critique, chroniqueur de la vie intellectuelle de Copenhague, etc. Cette ambition, hautement nécessaire, n’aurait-elle pas elle aussi gagné à plus de transparence sur l’histoire de la réception philosophique des œuvres du Danois ? Les textes venant illustrer la partie autonyme [1] de l’œuvre permettent un aperçu assez inédit pour le grand public sur la dimension religieuse et édifiante de Kierkegaard, mais l’appareil critique restreint le plus souvent les liens avec le reste du corpus à des enjeux essentiellement biographiques – alors même que les traductions de Tisseau dans les années 1930 ont connu une fortune notable dans les milieux intellectuels protestants français et qu’il aurait été possible de raccrocher la démarche de ces volumes à une analyse plus poussée de la situation historique de l’auteur.
Les partis pris de l’édition sont donc nombreux et lourds de conséquences, et marquent ces volumes dès la curieuse première phrase de l’introduction par Régis Boyer : « Il n’est pas facile d’être un génie dans un petit pays. » Le défaut de clarté n’empêche pas de remarquer les indéniables et nombreux points forts de ces deux volumes qui témoignent d’une érudition remarquable dans la restitution du Copenhague artiste et intellectuel des années 1830 à 1850, dans lequel on n’avait sans doute jamais vu apparaître aussi clairement Kierkegaard et ses œuvres. Le dévoilement érudit des références de l’œuvre aux cultures danoise et scandinave est également l’une des réussites majeures de ce travail. Sur le plan philosophique, les notes et éditions critiques paraissent plus aléatoires quant à la contextualisation des propos de Kierkegaard dans le champ européen, germanique et danois de l’époque : l’opposition à Hegel englobe l’essentiel de la lecture qui est faite du corpus, dans une visée encore très biographique, qui gêne également l’inscription de l’œuvre dans une histoire antagoniste de la pensée occidentale du XIXe siècle – dont les études de Georg Lukács sur la destruction de la raison rappellent l’importance, et le fait que Kierkegaard fut aussi un pivot de la critique du matérialisme et de la théorie critique.

Søren Kierkegaard
Ainsi, c’est un Kierkegaard plus danois et moins philosophe qu’élabore cette édition, d’une façon convaincante, hormis la pesanteur du parti pris surplombant tacitement l’ensemble de l’appareil critique. Je peine personnellement à penser que ces deux volumes trouveront un large public, tant la figure du philosophe reste celle qui interpelle d’abord le lecteur français, et il faudrait la déconstruire de façon plus pleine et explicite pour proposer éventuellement une autre lecture. Cette considération personnelle paraît interroger le travail de la Pléiade, qui s’est de longue date distinguée pour ses éditions philosophiques polémiques – pour rester dans l’euphémisme. Car à vrai dire, passé la brièveté de l’introduction et de certaines notices, les notes souvent modalisatrices (« sans doute est-ce une référence à… »), les erreurs d’orthographe et autres coquilles [2], on est en droit de se demander si le prestige de la collection n’impose pas plus d’exigence éditoriale pour éviter ces reproches, qui viennent d’autant plus vivement à l’esprit que l’objet livre est aussi prestigieux qu’onéreux.
Cette parution réussit donc à remettre Kierkegaard au cœur des préoccupations actuelles, en révisant à bon droit l’histoire de sa réception, mais l’occasion est peut-être manquée de remettre en jeu les concepts et méthodes qui ont fait entrer cet auteur dans le champ intellectuel français : l’angoisse, l’instant dans une conception iconoclaste de l’histoire, le désespoir, les stades esthétiques, éthiques et religieux, la versatilité des références philosophiques et artistiques, etc. Ces concepts disparaissent parfois dans une traduction dont l’auteur de ces lignes ne peut, faute de compétence linguistique, juger le bien-fondé – ainsi du titre du Traité du désespoir qui est relégué à la notice.
Bénéficiant d’un contexte où la silhouette de l’auteur danois s’était quelque peu éclipsée et réduite aux spécialistes, cette édition a cependant des arguments pour nous donner tort et trouver un public qui s’éprenne de ce Kierkegaard-là, et remette en jeu ses pensées et ses textes dans la vie intellectuelle et littéraire contemporaine. À nos yeux, peut-être fallait-il pour cela crever plus directement les fantasmes et sacralisations d’un auteur hors norme et particulièrement complexe par sa pensée comme par l’histoire de ses lectures ; condition sine qua non pour philosopher après Kierkegaard.
-
Par opposition aux ouvrages écrits sous pseudonyme, qui sont le plus souvent de nature philosophique et sont les plus connus : Ou bien… ou bien, Miettes philosophiques, Le concept d’angoisse, etc.
-
Juste un exemple, p. 659 du premier tome : « mais il conserve toujours une différence qu’il ne veut pas anéantir, celle où il vie ».





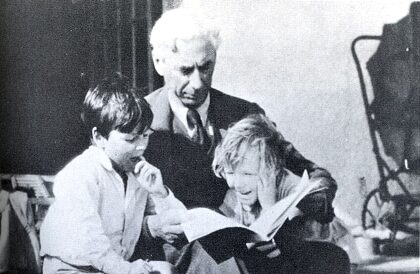



![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)


