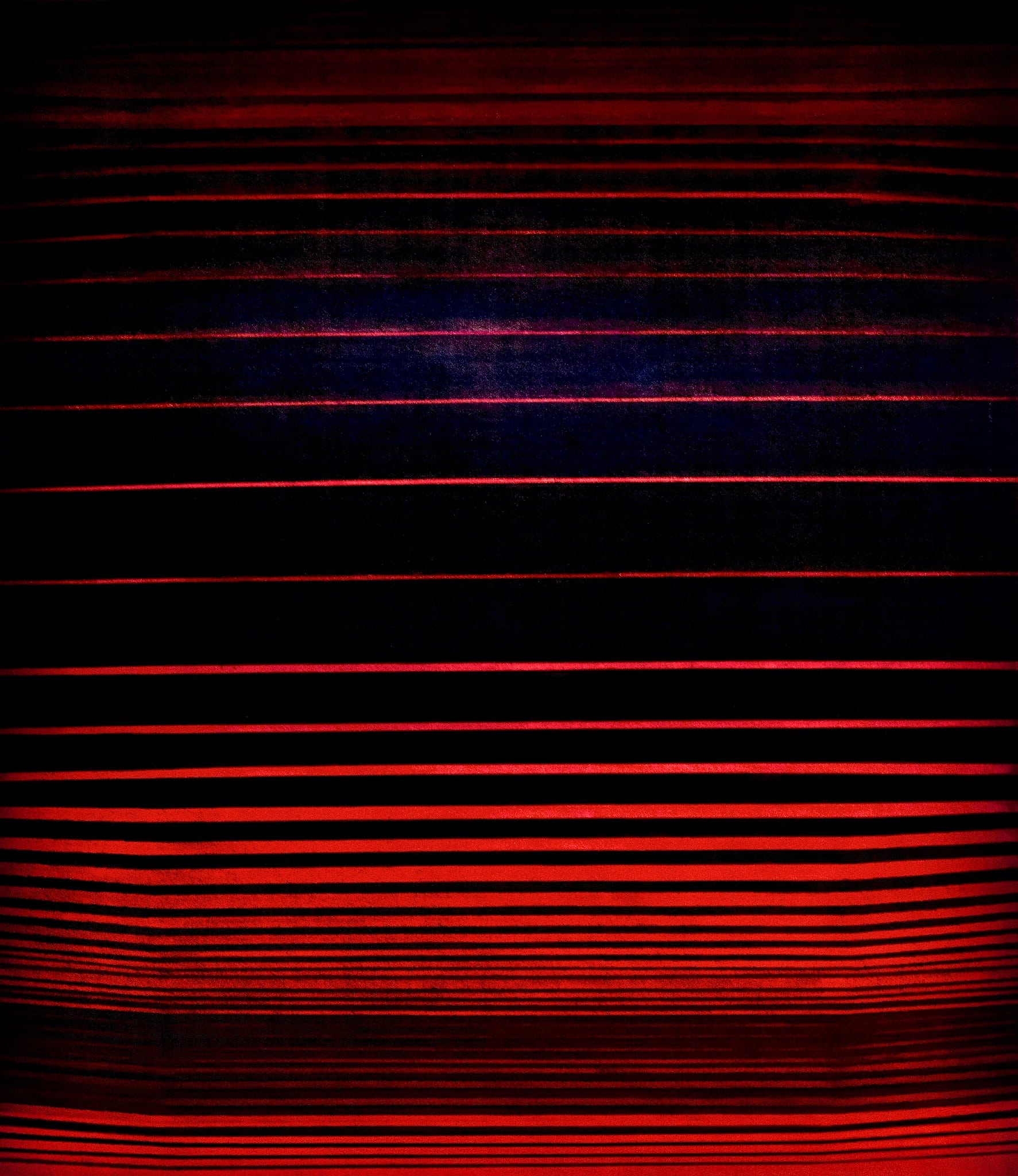Chez Flannery O’Connor la bêtise est grotesque, monstrueuse. Et pourtant, elle touche également au sublime. Quel paradoxe américain !
Chez Flannery O’Connor (1925-1964), les personnages sont laids, bêtes, et méchants. Hallucinés aussi parfois. Ces créatures grotesques, qui se confrontent les unes aux autres dans une trentaine d’extraordinaires nouvelles et deux romans, font rire jaune. Enrôlées au service d’une charge impitoyable contre le Sud arriéré et raciste des années 1950-1960 dans lequel l’écrivaine vivait, elles sont également actrices de la plus féroce des eschatologies chrétiennes. Le déroulement de l’action, le symbolisme ironique et les dénouements apocalyptiques ne laissent en effet aucun doute sur le double but poursuivi par O’Connor : une satire des mœurs et une prophétie (quasi) vétérotestamentaire sur l’imminence de la Catastrophe. L’insondable stupidité humaine et la destruction à venir sont pour l’écrivaine intimement liées mais, par un retournement ironique et paradoxal, elle les redéfinit et les change en leurs contraires tant il est vrai que pour elle « les derniers seront les premiers » et que l’anéantissement est avant tout promesse.
Mais d’abord les êtres de Flannery O’Connor sont essentiellement stupides parce que, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, habitants de la campagne ou de la ville (cas plus rare dans ses textes), ils ne cessent de prétendre à une supériorité intellectuelle, morale, sociale ou raciale qu’ils tentent en permanence d’exercer. Chaque nouvelle, chaque épisode romanesque est l’histoire d’une volonté de pouvoir. Celles des Blancs sur les Noirs, des fermiers sur leurs journaliers, des enfants instruits sur leurs parents ignorants, des géniteurs sur leur progéniture rétive, des esprits éclairés sur les cerveaux enténébrés, des athées sur les croyants, des progressistes sur les réactionnaires… Une libido dominandi qui se révèle à double sens puisque, et c’est là que O’Connor dérange, les « victimes » se rebiffent et font alors souvent preuve d’une volonté aussi stupide que ceux qui cherchent à leur faire plier l’échine.

Flannery O’Connor
Hormis les personnages qui luttent et sont remplis de fureur contre un monde peu désireux de reconnaître leur prééminence, existent aussi quelques imbéciles heureux jouissant béatement de l’excellente idée qu’ils se font d’eux-mêmes. Ainsi, dans « La révélation », Mrs Turpin se félicite-t-elle d’être une modeste et respectable fermière, d’avoir un bon tempérament et surtout de ne pas être née noire, ce dont elle remercie Dieu tous les jours du fond du cœur. Tandis que, dans « Tout ce qui s’élève converge », Julian, un jeune homme à l’esprit libéral qui a fait des études supérieures, se venge de l’univers médiocre dans lequel il végète et de sa mère optimiste, sotte et raciste, en s’asseyant systématiquement pour l’embêter à côté des passagers noirs des bus nouvellement « déségrégués ».
Être bête chez O’Connor, c’est ainsi être satisfait de soi, qu’on le soit rageusement ou paisiblement. Cette complaisance est blâmable non parce qu’elle empêcherait toute ouverture au bien et à la vertu ou la construction d’un monde humain moins mauvais mais parce qu’elle empêche la reconnaissance de ce qui seul est supérieur, le divin. La stupidité autocentrée détourne donc de l’unique besoin que l’être devrait ressentir, celui de la grâce. Le comique et la force de Flannery O’Connor résident pour une grande part dans le fait que son œuvre ne formule jamais les choses en ces termes, assez peu audibles évidemment pour la plupart de ses lecteurs, et que la charge contre la bêtise humaine occupe d’un point de vue narratif la place prépondérante.
Le divin, ou appelons-le – en termes peu o’connoriens – une force plus grande que l’humain, va pourtant s’imposer à la fin des histoires, toujours sous une forme bizarre et violente. C’est un taureau qui transperce la fermière de « Greenleaf », « le Désaxé » qui assassine la grand-mère des « Braves gens ne courent pas les rues », une vision inquiétante qui descend sur le malade de « Mon mal vient de plus loin », une crise cardiaque qui terrasse Mr Fortune dans « Vue sur les bois »… Cette force, contrairement aux idées chrétiennes modernes, n’est ni propédeutique ni apaisante et les personnages en font l’expérience à leur corps défendant, souvent au prix de leur vie. Ainsi, avant leur anéantissement psychique ou physique, les intellectuels libéraux, les propriétaires terriens avides ou dominateurs, les pharisiens de tous poils de O’Connor se retrouvent face à ce que les textes décrivent comme « une terreur purifiante », « sur le bord d’un monde de culpabilité et de chagrin »… Soit, selon O’Connor, dans la seule position souhaitable pour l’être humain, celle de la reconnaissance de son imperfection sans Dieu.

© Wilson Severino
Une seule catégorie de personnages échappe à la condamnation de O’Connor ; les fanatiques, les délirants, ceux qui se lamentent de l’absence du Seigneur ou de l’état de péché dans lequel eux et le monde vivent. Ils apparaissent dans ses pages sous les traits de fondamentalistes protestants, de forcenés, de tueurs. Ils souffrent passionnément du manque de Dieu, et, parfois persuadés que Satan les tient en son pouvoir, se déchaînent contre autrui. Mais ils portent sans toujours le savoir la parole divine car, chez O’Connor, il n’est de messager plus inspiré que le vengeur satanique ou le délinquant pervers. Ainsi, avant de partir en prison, Rufus, le diabolique jeune pied-bot des « Boiteux entreront les premiers », hurle, aux policiers qui l’ont arrêté mais en réalité à destination de l’homme qui l’a accueilli sous son toit et assiste impuissant à la scène (et à la ruine de ses efforts éducatifs) : « Je mens et je vole parce que je suis un bon menteur et un bon voleur. […] Les boiteux seront les premiers. Les infirmes seront rassemblés. Quand je serai prêt pour mon salut, Jésus me sauvera, mais pas cet athée dégueulasse et menteur ».
Les discours arriérés et aberrants contiennent donc plus de vérité pour O’Connor que les prises de position rationnelles ou vertueuses. Pour elle, l’imbécillité obscurantiste, c’est un monde organisé dans le refus de Dieu et de la révélation. L’imbécillité, c’est croire qu’on peut hic et nunc remédier à l’incomplétude ou au vice humain. L’imbécillité, c’est refuser de considérer l’univers comme lieu de désordre et de mal, imaginer se passer de Dieu et de sa Grâce foudroyante.
Et quelle sacrée énergie, quelle cruauté jubilatoire Flannery O’Connor met dans sa dénonciation ! Quelle renversante intelligence elle déploie dans sa détestation d’une humanité stupide !